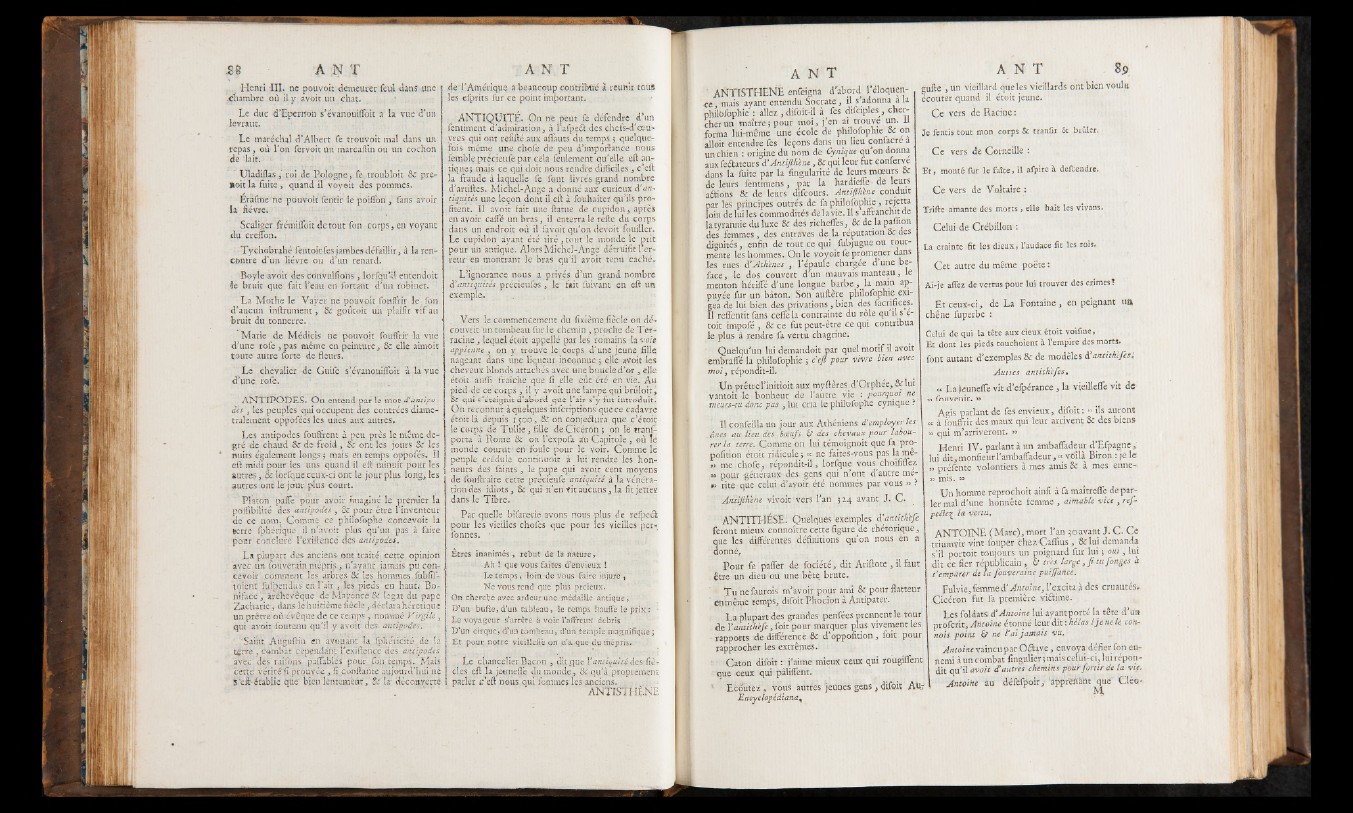
.86 A N T
•Henri -III. ne pouvoir-demeurer'feu! dans une
.cnambre où il .y avoit un chat.
Le duc d’Epernon s’ évanôuifloit a la vue d’un
levraut.
Le maréchal d’Albert fe trouvoit mal dans un
repas , où l’on fervoit un marcaflin ou un cochon
de lait.
Uladiflas roi de Pologne, fe troubloit 8c pre-
àoit la fuite, quand il voyoit des pommés.
Erafmé ne pouvoît fentir le poiflon, fans avoir
la fièvre.
Scaliger fréminoit de tout fon corps, en voyant
du creflon.
Tychobrahé fentok-fes jamhes défaillir , à la rencontre
d’un lièvre ou d’un renard.
Boyle avoit des cOnvulfions 3 lorfqu’41 entendoit
le bruit que fait l’eâu en fortant d’un robinet.
La Mothe le Vayer ne pouvoir fouffrir le , fon
d’aucun infiniment, & goûtoit un plaîfir v if au
bruit du tonnerre.
Marie de Médicis ne pouvoir fouffrir la vue
d’une rofe , pas même en peinture , & elle aimoit
toute autre forte de fleurs.
Le chevalier de Guife s’évanouifloit à la vue
d’une rofe.
ANTIPODES. On entend par le mot & antipodes
3 les peuples qui occXipent des contrées diamétralement
oppofées les unes aux autres.
Les antipodes fouffrent à peu près le même degré
de chaud & de froid 3 8c ont les jours 8c les
nuits également longs ; mais en temps oppofés. Il
eft midi pour les uns quand il eft minuit pour les
autres,, & lorfque ceux-ci ont le jour plus long, les
autres ont le jour plus court.
Platon pafle pour avoir imaginé le premier la
poflibilité des antipodes 3 & pour être l'inventeur
de ce nom. Gomme ce phiiofophe concevoir la
serre fphérique il n’avoit plus qu’un pas a faire
pour conclure Pexiftencë des antipodes.
La plupart des anciens ont traité; cette opinion
avec un fouverain mépris. n’ayant jamais pu concevoir
comment les arbres 8c les hommes fubfif-
toient fufpendus en l’air, les pieds en haut.- Bo-
fiifacê , ' âréhevêque de Mayéncé & légat du pape
Zacharie , dans le huitième nècle ,-déclaràhéretique
un prêtreoù'évêque de ce temps, nommé Virgile,
qui avait foutenu qu’il y avoit des- antipodes.
* 'Saint Atiguftin en avouant la fphéricité de la
ttfrre, Combat Cependant î’exifiençe des antipodes
avec: dés railons paflablés pouf;.. jKç,' temps. ’ Mais
cette vérité' fi prouvée , fî cohfiance aujourd’hui ne
5'eft-établie qüe" b jeu lentement, 8c la- découverte
A N T
de T Angélique a beaucoup contribué à reunir tous
les efprits fur ce point important.
AN T IQ U ITÉ , On ne peut fe défendre d’ un
fentiment a’admiration, à l’afpeél des chefs-d’oeuvres
qui ont refifté aux afiauts du temps ; quelquefois
même une chofe de peu d’importance nous
femble précieufe par. cela feulement qu’ elle eft antique;
mais ce qui doit nous rendre difficiles , c’eft
la fraude à laquelle fe font livrés grand nombre
d’artiftes. Michel-Ange a donné aux curieux à1 antiquités
une leçon dont il eft à fouhaiter qu’ils profitent.
Il avoit fait une fiatue de cupidon, âpres
en avoir caffé un bras, il enterra le refte du corps
dans un endroit où il favoit qu’on devoit fouiller.
Le cupidon ayant été tiré , tout le monde le prit
pour un antique. Alors Michel-Ange détruifit l’erreur
en montrant le bras qu’il avoit tenu caché.
L’ignorance nous a privés d’un grand nombre
d'antiquités précieufes, le fait fuivant en eft un
exemple.
Vers le commencement du fixièmefiècle on découvrit
un tombeau fur le chemin, proche de Ter-
racine , lequel étoit appellé parles romains la voie
appienne , on y trouve le- corps d’une jeune fille
nageant dans une liqueur inconnue ; elle avoit les
cheveux blonds attachés avec une boucle d’o r , elle
étoit aufli fraîche que fi elle eut été en vie. Au
pied-de ce corps , il y avoit une lampe qui brûloir^
8c qui s’éteignit d’abord que l’aiis s’y fut introduit.
On reconnut à quelques inferiptions que ce cadavre
étoit là depuis 1 jdô, 8t on conjeéhira que c’étoit
le corps de Tullie, fille de Çrcérôn ; on le transporta
à Rome 8c on l’expofa au Capitole, où le
monde courut * en foule pour le voir. Comme le
peuple crédule continu dit à lui rendre les honneurs
des faints, le pape qui avoit cent moyens
de fouftraire cette precieufe antiquité à la vénëra-
; tiondes idiots, & qui ri’en vit aucuns, la fit jetter
dans le Tibre.
i Par quelle bifarerie avons nous plus' de refpeéf
| pour les vieilles choies que pour les vieilles per-;
[ fonnes. •
Etres inanimés , rebut de la nature ,■
Ah ! que vous faites d’envieux 1
Le temps > -loin de vous faire injure ,
Ne vous rend que plus prciêux.
On cherché avec ardeur une médaille antique,
D’un- bufte, d'un tableau, le temps hauffe le prix:
Le voyageur s?arrête à voir l’affreux débris
D’un cirque, d’un tombeaii, d'un temple magnifique;
Et pour notre vieillefle on n’arque du mépris.
Le chancelier. Bacon , dit .que Y antiquité, des lié*
des eft.la. jeunefle du monde , Ôçqu’à proprement
parler c ’eft noiis' qui femmes les anciens.
ANTISTHËNE
A N T
ANTISTHËN E enfeigna d’abord l’éloquenc
e , mais ayant entendu Socrate, il s’adonna a la
philofophie : allez, difoit-il W. fes difciples 3 chercher
un maître ; pour moi, j’en ai trouve un. 11
forma lui-même une école de philofophie 8c on
alloit entendre fes leçons dans un lieu confacre a
un-chien : origine du nom de Cynique qu’on donna
aux feftateurs d‘Antijlhene, & qui leur fut conferve
dans la fuite par la Angularité de leurs moeurs &
de leurs fentimens, pat la hardiefle- de leurs
a&ions 8c de leurs difeours. Antifthene conduit
par les principes outrés de fa philofophie, rejetta
loin de lui les commodités delà vie. Il s’ affranchit de
la tyrannie du luxe 8c des richefles^ & de la paüion
des femmes, des entraves de la réputation 8c des
dignités, enfin de tout ce qui fubjugue ou tourmente
les hommes. On le voyoit fe promener dans
les rues d1 Athènes , l’épaule chargée d’une be-
face, le dos couvert dun mauvais manteau, le
menton hérifle d’une longue barbe, la main appuyée
fur un bâton. Son auftère philofophie exigea
de lui bien des privations, bien des facrifices.
Il reffentit fans cefîela contrainte du rôle qu il s e-
toit impofé , & ce fut peut-être ce qui contribua
le plus à rendre fa vertu chagrine.
Quelqu’un lui demandoit par quel motif il avoit
embrafie la philofophie ; ceft pour vivre bien avec
moi, répondit-il.
Un prêtre l’initîoit aux myItères d’Orphee, 8c lui
vantoit -le bonheur de l’ autre vie : pourquoi ne
rneurs-tu donc pas , lui cria le phiiofophe cynique ?
Il confeilla un jour aux Athéniens d’employer les
. ânes au lieu des; boeufs & des chevaux pour' labourer
la terre. Comme on lui témoignoit que fa'pro-
pofition étoit ridicule ; « ne faites-vous pas la mê-
„ me chofe,. répondit-il, lorfque vous choififlez
» pour généraux des gens qui n’ont d’autre mets
rite que celui d’avoir, été nommés par vous » ?
Antifthene vivoitvers l’ an 324 avant J. C .
ANTITHÈSE: Quelques exemples d’antitkéfe
feront mieux connoître cette figure de rhétorique,
que les différentes définitions qu’on nous en a
donné.
Pour fe pafîer de fociété, dit Ariftote, il faut
être un dieu ou une bête brute.
T u nefaurois m’ avoir pour ami & pour flatteur
en même temps, difoit Phocîon à Antipater.
La plupart des grandes penfées prennent le tour
de Yandthéfe, foitpour marquer plus vivement les
rapports de différence :8c d’ oppofition, foit pour,
rapprocher les extrêmes.
Caton difoit :i f aime mieux ceux qui rougiflent
que ceux qui pâliflent.
1 E c o u te z , . vous àuttfés jeunes g en s, difoit Au ;
Eîicyclopédiana,
A N T 8p.
gufte , un vieillard que les vieillards ont bien voulu
écouter quand il étoit jeune.
C e vers de Racine :
Je fends tout mon corps & tranfir & brûler.
C e vers de Corneille :
E t , monté fur le faîte, il afpire à defeendre.
C e vers de Voltaire :
Trifte amante des morts , elle hait les vivans.
Celui de Crébillon :
La crainte fit les dieux, l’audace fit les rois.
Cet autre du même poëte r
Ai-je affez de vertus pour lui trouver des crimes?
Et ceux-ci-, de La Fontaine, en peignant uft
chêne fuperbe :
Celui de qui la tête aux cieux étoit voifine,
Et dont les pieds touchoient à l’empire des morts.
font autant d’exemples 8c de modèles d antithefesi
Aunes antithefes»
« La jeunelfe vit d’efpérance, la vieillefle vit de
» fouvenir. »
Agis parlant de fes envieux, difoit: » ils auront
ce à fouffrir des maux qui leur arrivent 8c des biens
» qui m’arriveront. «
Henri IV. parlant à un ambafladeur d’Efpagne,
lui dit, mpnfieurl’ambafladeur , « voilà Biron : je le
» préfente volontiers à mes amis 8c à mes enne-.
n mis. «
Un homme reprochoit ainfi à fa maîtrefle de par-
1er mal d’une honnête femme , aimable vice , refpecle7L
la vertu.
AN TO IN E (Marc)j mort l’an joavant J. C . Ce
triumyir vint fouper chez Calfius , & lui demanda
s’il portoit toujours un poignard fur'lui ; oui, lui
dit ce fier républicain, & très large, fitufonges à
t'emparer de la fouveraine puijfattce.
Fulvie, femme à'Antoine, l’excita à des cruautés.
Cicéron fut fa première viétime.
Les foldats d’Antoine lui ayantporté la tête d’ ua
proferit, Antoine étonné leur dit : hélas !je ne le con-
nois point & ne l'ai jamais vu. ■
;Antoine vaincu par Oétave, envoya défier fon ennemi
à un combat fingulier ; mais celui-ci, lui répondit
qu’il avoir et autres'chemins pour forcir de la vie.
Antoine au déféfpoir,- ‘àppfeftânt que Cléo-
H