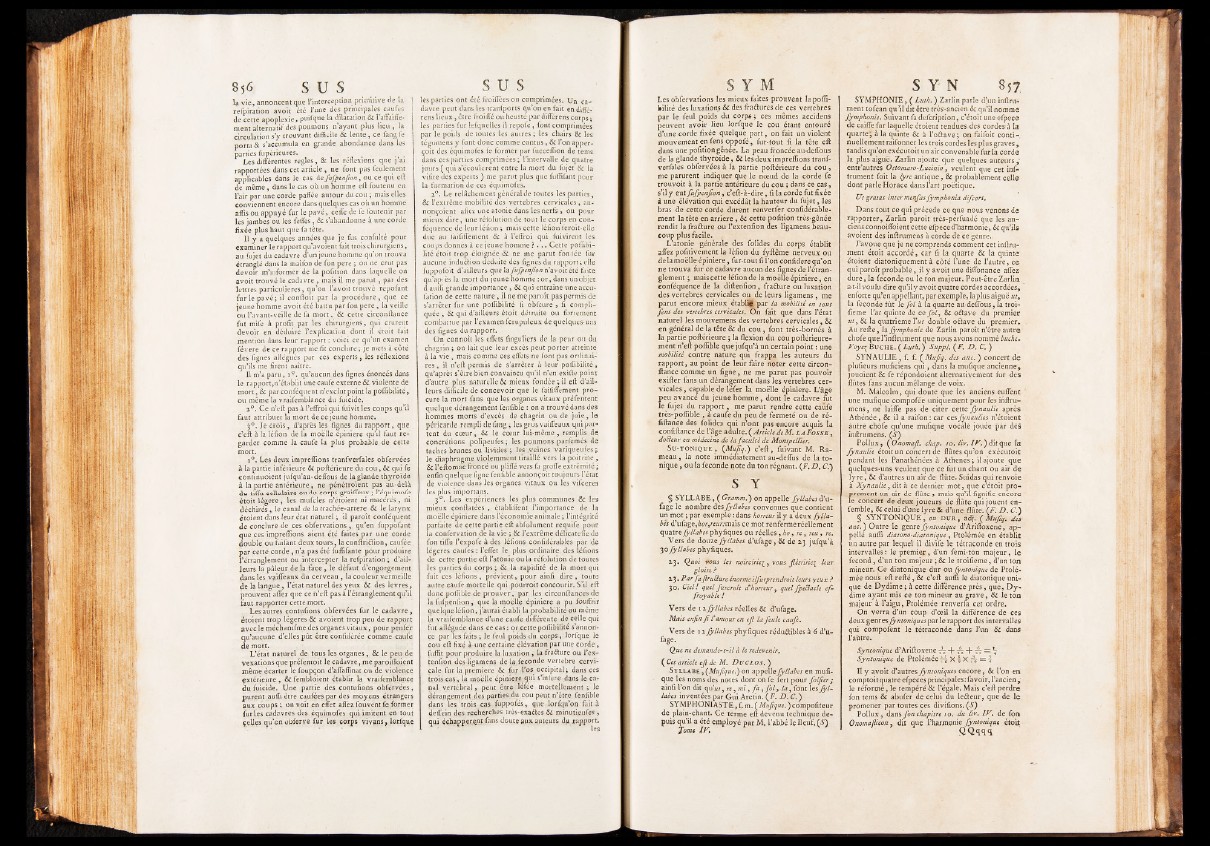
J
n
i
8 5 6 SU S
la vie, annoncent que l’interception prirnhive He îa
relpiration avoit etc l’une des priiicipales caufes
de cette apoplexie, puilqvie la dilatation 1 afFailie*
ment alternaul" des potimons n ayant plus lieu , la
circulation s’y trouvant difficile & lente , ce lang le
porta & s’accumula en grande abondance dans les
parties l'upérieures.
Les différentes réglés, & les réflexions que j ’ai
rapportées dans cet article , ne font pas feulement
applicables dans le cas d e , ou ce qui clt
de même, dans le cas oii un homme eff foutenu en
l’air par une corde paffée autour du cou ; mais elles
conviennent encore dans quelques cas oii un homme
aflis ou appuyé lur le pavé, celle de fc foutenir par
les jambes ou les feffes, 6c s’abandonne à une corde
Axée plus haut que la tête.
Il y a quelques années que je fus confulté pour
examiner le rapport qu’a voient fait trois chirurgiens,
au fiijet du cadavre d’un jeune homme qu'on trouva
étranglé dans la mailbn de fon pere ; on ne crut pas
devoir m’informer de la pofition dans laquelle on
avoit trouvé le cadavre , mais il me parut , par des
lettres particulières, qu’on l’avoit trouvé rcpolant
fur le pavé; il conlioit par la procédure, que ce
jeune homme avoit été baitu par fon pere , la veille
ou l’avant-veille de fa mort. 6c cette circonffance
fut mile à profit par les chirurgiens, qui crurent
devoir en déduire l’explicauv-n dont il ctoit tait
mention dans leur rapport : voici ce qu’un examen
févere de ce rapport me fit conclure ; je metb à coté
des figues allégués par ces experts, les réflexions
qu’ils me firent naître.
Il m’a paru, qu’aucun des fignes énoncés dans
le rapport,n’établit imecaufe externe 6c violente de
mort, ôc par conféquent n’cxclut point la poffibilité,
ou même la vraifemblance du fuicide.
2'^. Ce n’eft pas à l’effroi qui fuivit les coups qu’il
faut attribuer la mort de ce jeune homme.
3°. Je crois, d’après les fignes du rapport, que
c’efl: à la léfion de la moelle épiniere qu’il faut regarder
connue la caufe la plus probable de cette
mort.
1°. Les deux impreflions tranfverfales obfervées
à la partie inférieure 6c poflérieure du cou, & qui fe
continuoient jufqii’au-deffous de la glande thyroïde
à la partie antérieure, ne pénétroient pas au-delà
du tiffu cellulaire ou du corps graiffeux ; l’équimofe
étoit légère , les mufcles n’étoient ni macérés , ni
déchirés , le canal de la trachée-artere 6c le larynx
étoient dans leur état naturel ; il paroît conféquent
de conclure de ces obfervations , qu’en fuppofant
que ces impreflions aient été faites par une corde
double ou fdlfant deux tours, la conffriclion, caufée
par cette corde , n’a pas été fuffifante pour produire
l’étranglement ou intercepter la refplration ; d’ailleurs
la pâleur de la face , le défaut d’engorgement
dans les vailTeaux du cerveau, la couleur vermeille
de la langue, l’état naturel des yeux & des levres,
prouvent aile? que ce n’eff pas à l’étranglement qu’il
faut rapporter cette mort.
Les autres contufions obfervées fur le cadavre,
étoient trop légères 6c avoient trop peu de rapport
avec le méchamlme des organes vitaux, pour penfer
qu’aucune d’elles put être confidérée comme caufe
de mort.
L’état naturel de tous les organes, & le peu de
vexations que préfentoit le cadavre, me paroiffoient
même écarter le foupçon d’affaflinat ou de violence
extérieure , & fembloient établir la vraifemblance
du fuicide. Une partie des contufions obftrvées,
purent auffi être caillées par des moyens étrangers
aux coups ; on voit en effet afl'ez fouvent fe former
fu rie s cadrvres des équimofes qui imitent en tout
çeUes qu'en oüferve fur les corps vivans, iorfque
SUS
les parties ont été froilTées ou comprimées. Un cadavre
peut clans les tranlports qu’on en fait en diffe-
renslieux , être froiffé ou heurté par difterens corps;
les parties fur lefqiieUes il repole, font comprimées
par le poids de toutes les autres; les chairs 6c les
tegumens y Ibnt donc comme contus, 6c l’on apper-
çüit des équlmoi'es fe former par fuccelfion de tems
dans ces parties comprimées; l’intervalle de quatre
jours ( qui s’écoulèrent entre la mort du fujet 6c la
vilite des experts ) me partit plus que luffilant pour
la formation de ces équimoles.
1®. Le relâchement général de toutes les parties,
Sc l’extrême mobilité dos vertebres cervicales, an-
nonçoient aflcz une atonie clans les nerfs , ou pour
mieux dire, une réloluiion de tout le corps en con-
féc|iiencc de leur léfion ; mais cette léfion leroit-elle
duc au (aifiiremcm 6c à l’effroi qui luivircnt les
coups donnés à ce jeune homme ?. . . Cette pofilln-
iité étoit trop éloignée 6c ne me parut fon ice lur
aucune indiuff ion déduite des fignes du rapport ; elle
fuppofoii d’ailleurs que l a n ’avoit été faite
qu’ap'ès la mort du jeune homme : o r, dans un objet
cl aiilfi grande importance , 6c qui entraîne une accii-
fation de cette nature , il ne me paroît pas permis de
s’anêier fur une polTibilité fi cbfcure , fi compliquée
, 6c qui d’ailleurs étoit détruite ou foneinent
combattue par l’examen fcrupuleux de quelques-uns
des fignes tlu rapport.
On connoît les effets finguliers de la peur ou du
chagrin ; on lait que leur excès peut porter atteinte
à la vie . mais comme ces effets ne font pas ordinaires
, il n’cft permis de s’arrêter à leur polfibilité,
qu’après s’être bien convaincu qu'il n’en exille point
d’autre plus naturelle 6c mieux fondée ; il eff d’ailleurs
difficile de concevoir que le faififiement procure
la mort fans que les organes vitaux préfentent
quelque dérangement fenfible : on a trouvé dans des
hommes morts d’excès de chagrin ou de joie, la
péricarde rempli de fang ; les gros vaiffeaux qui partent
du coeur, 6c le coeur lui-même, remplis de
concrétions polipeufes; les poumons parfemés de
taches brunes ou livides; les veines variqueufes;
le diaphragme violemment tiraillé vers la poitrine,
6c l’effomac froncé ou plifi'é vers fa grolTe extrémité;
enfin quelque figne fenfible annonçoit toujours l’état
de violence dans les organes vitaux ou les vifeeres
les plus importans.
3°. Les expériences les plus communes 6c les
mieux conffaiées , établifl'ent l’importance de la
moelle épiniere dans l’économie animale ; rimégrité
parfaite de cette partie eff abfolument requife pour
la confervation de la vie ; 6c l’extrême délicatefic de
fon tiffu l’expofe à des léfions confidérables par de
légères caufes : l’effet le plus ordinaire des léfions
de cette partie eff l’atonie ou la réfolution de toutes
les parties du corps; 6c la rapidité de la mort qui
fuit ces léfions, prévient, pour ainfi dire, toute
autre caufe mortelle qui pourroit concourir. S’il eff
donc poffible de prouver, par les circonffances de
la fufpenfion, que la moelle épiniere a pu fouffnr
quelque léfion, j’aurai établi la probabilité ou même
la vraifemblance d’une caufe différente de celle qui
fut alléguée dans ce cas : or cette poflibiüté s’annonce
par les faits ; le feul poids du corps, Iorfque le
cou eff fixé à une certaine élévation par une corde,
fuffit pour produire la luxation , la fraélure ou i’ex-
tenfion des Hgamens de la fécondé vertebre cervicale
fur la premiere 6c fur l’os occipital; dans ces
trois cas , la moelle épiniere qui s’infere dans le canal
vertébral, peut être Icfée mortellement ; le
dérangement des parties du cou peut n’être fenfible
dans les trois cas fuppofés, que lorfqu’on fait à
deffein des recherches très-exa£lcs S i miniitieufes,
qui échappere.nî fans doute aux auteurs du rapport,
les
Il 1 ‘ ii'i! U t
! î
S Y M
Les obfervations les mieux faites prouvent la pofiî-
kilité des luxations S i des fraélures de ces vertebres
par le feul poids du corps ; ces mêmes accidens
peuvent avoir lieu Iorfque le cou étant entouré
d’une corde fixée quelque part, on fait un violent
mouvement en fens oppofé, fur-tout fi la tête eff
dans une pofitiongênée. La peau froncée au-defibus
de la glande thyroïde, & les deux impreflions tranf-
vei fales obfervées à la partie poftérieure du cou ,
me parurent Indiquer que le noeud de la corde fe
trouvoit à la partie antérieure du cou ; dans ce cas,
s’il y eut fu fp en lio n , c’eft-à-dire, fi la corde fut fixée
à une élévation qui excédât la hauteur du fujet, les
bras de cette corde durent renverfer confidérable-
ment la tête en arriéré , S i cette pofition très-gênée
rendit la fraêlure ou l’extenfion des ligamens beaucoup
plus facile.
L’atonie générale des foüdes du corps établit
aflbz pofitivement la léfion du fyftême nerveux ou
de la moelle épiniere , fur-tout fi l’on confidere qu’on
ne trouva fur ce cadavre aucun des fignes de l’étranglement
; mais cette léfion de la moelle épiniere, en
conféquence de la diftenfion, frafture ou luxation
des vertebres cervicales ou de leurs ligamens , me
parut encore mieux établie par la mobiUii tn tout
f i n s des vertebres cervicales. On fait que dans l’état
naturel les mouvemens des vertebres cervicales, 6i
en général de la tête & du cou , font très-bornés à
la partie poftérieure ; la flexion du cou pofférieure-
ment n’eff poffible que jufqii’à un certain point : une
mobilité contre nature qui frappa les auteurs du
rapport, au point de leur faire noter cette circonffance
comme un figne, ne me parut pas pouvoir
exiffer fans un dérangement dans les vertebres cervicales
, capable de léfer la moelle épiniere. L’âge
peu avancé du jeune homme, dont le cadavre fut
le fujet du rapport, me parut rendre cette caufe
très-pofllble , à caufe du peu de fermeté ou de ré-
fiftance des folides qui n’ont pas encore acquis la
confiffance de l’âge adulte. {A r t ic le de M . l a F o s s e ,
docteur en médecine de la fa c u lté de Montpellier.
Su-TONiQUE _, {M u fiq .) c’ eft, fuivant M. Rameau
, la note immédiatement au-delTus de la tonique
, ou la fécondé note du ton régnant. {F , D , C.)
S Y
§ SYLLABE, ( Gramm. ) on appelle fy lla b e s d’u-
fage le nombre des fy lla b e s convenues que contient
un mot ; par exemple : dans horreur \\ y a deux fy l la -
hès d’ufage,Aor,r«wr.-mais ce mot renfermeréellement
quatre fy lla b e s phyfiques ou réelles , h o , re , reu , re.
’Vers de douze fy lla b e s d’ufage, & de 13 jufqu’à
30 fy lla b e s phyfiques.
23. Q u o i vous Us noircinei_, vous flétririez leur
gloire ?
23. P a r faflruclure énorme ilfurpTtndroit leurs y eu x ?
30. C ie l ! quel fu rc ro it d'horreur, quel fp eÜacU effroyable
!
"Vers de ix fy lla b esv à C iX es S i d’ufage.
M a is enfin f i l'amour en ejl la fe u le caufe.
Vers de 12 fy lla b e s phyfiques réduélibles à 6 d’u-
fage.
Q u e ne demande-t-il à U redevenir»
( Cet article ejî de M . D u C L O s . )
Sy l lab e , (M/z/Tiyi/c:.) on appelle fy lla b e s en mufi-
que les noms des notes dont on fe fert pour fo lfier ;
ainfi l’on dit qu’i/r, re , m i , f a , f o l , l a , font les f y l labes
inventées par Gui Aretin. (F. D . C .')
SYMPHONIASTE,f. m. {M ofique. ) compofiteur
de plain-chant. Ce terme eff devenu technique depuis
qu’il a été employé jomt IF. par M, l ’abbc le Beuf. (^)
S Y N 857,
SYMPHONIE, ( L u th . ) Zarlin parle d’un inffru-
ment tofean qu’il dit être très-ancien & qu’il nomme
fymp honie. Suivant fa defeription, c’étoit une efpece
de caifTe fur laquelle étoient tendues des cordes à la
quarte; à la quinte S i à l’oélave; on faifoit continuellement
raifonner les trois cordes les plus graves,
tandis qu’on exécutoitun air convenable fur la corde
la plus aiguë. Zarlin ajoute que quelques auteurs
entr’autres O iiom a ro -L u c in io , veulent que cet inf-
trument foit la lyre antique , S i probablement celle
dont parle Horace dans l’art poétique.
U t gratas inter tnenfas fyrnphonia difeors.
Dans tout ce qui precede ce que nous venons de
rapporter, Zarlin paroît très-perfuadé que les anciens
connoifToient cette efpece d’harmonie, 6i qu’ils
avoient des inftrumens à corde de ce genre.
J’avoue que je ne comprends comment cet infiniment
étoit accordé, car fi la quarte S i la quinte
étoient diatoniquement à coté Tune de l’autre, ce
qui paroît probable, il y avoir une diflbnance afl'ez
dure, la fécondé ou le ton majeur. Peut-être Zarlin
a-t-il voulu dire qu’ily avoit quatre cordes accordées,
enforce qu’en appellant, par exemple, la plus aigue ut,
la fécondé fût le f o l à la quarte au-deffous, la troi-
fieme Vut quinte de ce f o l . S i oftave du premier
K/, 6c la quatrième double oftave du premier.
Au reffe, la fymphonie de Zarlin paroît n’être autre
chofe que I’inffrument que nous avons nommé bûche.
Voyez Bûche. ( L u th .') S u p p l. (F. D . C. )
SYNAULIE , f. f. ( Mufiq, des am . ) concert de
plufieurs muficiens q u i, dans la mufique ancienne,
jouoient S i fe répondoient alternativement fur des
flûtes fans aucun mélange de voix,
M. Malcolm, qui doute que les anciens enflent
une mufique compofée uniquement pour les inflru-
mens, ne lailTe pas de citer cette fy n a u lie après
Athénée , & il a raifon : car ces fyn a uU ss n’étoient
autre chofe qu’une mufique vocale jouée par des
inftrumens. ( S )
Pollux, {O n om a fi. chap. /o. AV. 7 F’. ) dit que la
fy n a u lie étoit un concert de flûtes qu’on exécutoit
pendant les Panathénées à Athènes; i! ajoute que
quelques-uns veulent que ce fut un chant ou air de
ly r e , S i d’autres un air de flûte. Suidas qui renvoie
à X y n a ii l ie , dit à ce dernier mot, que c’étoit proprement
un air de flûte, mais qu’il fignifie encore
le concert de deux joueurs de flûte qui jouent en-
femble, S i celui d’une lyre & d’une flûte. (F. D . C . )
§ SYNTONIQUE, ou d u r , adj. {M u f iq . des
a n c .) Outre le genrefy n to n iq u e d’Ariffoxene, appelle
auffi d ia ton o -d ia toniqu t, Ptolémée en établit
un autre par lequel il divlfe le tétraconde en trois
intervalles: le premier, d’un femi-ton majeur, le
fécond, d’un ton majeur ; S i le troifieme, d’un ton
mineur. Ce diatonique dur o\\ Jyntonique de Ptolé-
mée nous eff refté, Si c’eff auffi le diatonique unique
de Dydime ; à cette différence près , que, D y -
dime ayant mis ce ton mineur au grave, S i le toa
majeur à l’aigu, Ptolémée renverfa cet ordre.
On verra d’un coup d’oeil la différence de ces
deux genres^nro/z/^7/gjparle rapport des intervalles
qui compofent le tétraconde dans l’un & dans
l’aùtre.
Syntonique d’Ariftoxene ^ + À = V
Syntoniqiie de Ptolémée 77 X f X |
II y avoit d’autres fynton iqu e s encore, & l’on en
comptoit quatre efpeces principales : fa voir, l’ancien ,
le réformé, le tempéré S i l’égale. Mais c’eff perdre
fon tems 6c abufer de celui du leéleur, que de le
promener par toutes ces divifions. (F)
Pollux, dans fo n chapitre t o . du liv . I V . de fon
On omafticon, dit que l’harmonie fy n to n iq u t étoit
Q Q q q q
m: