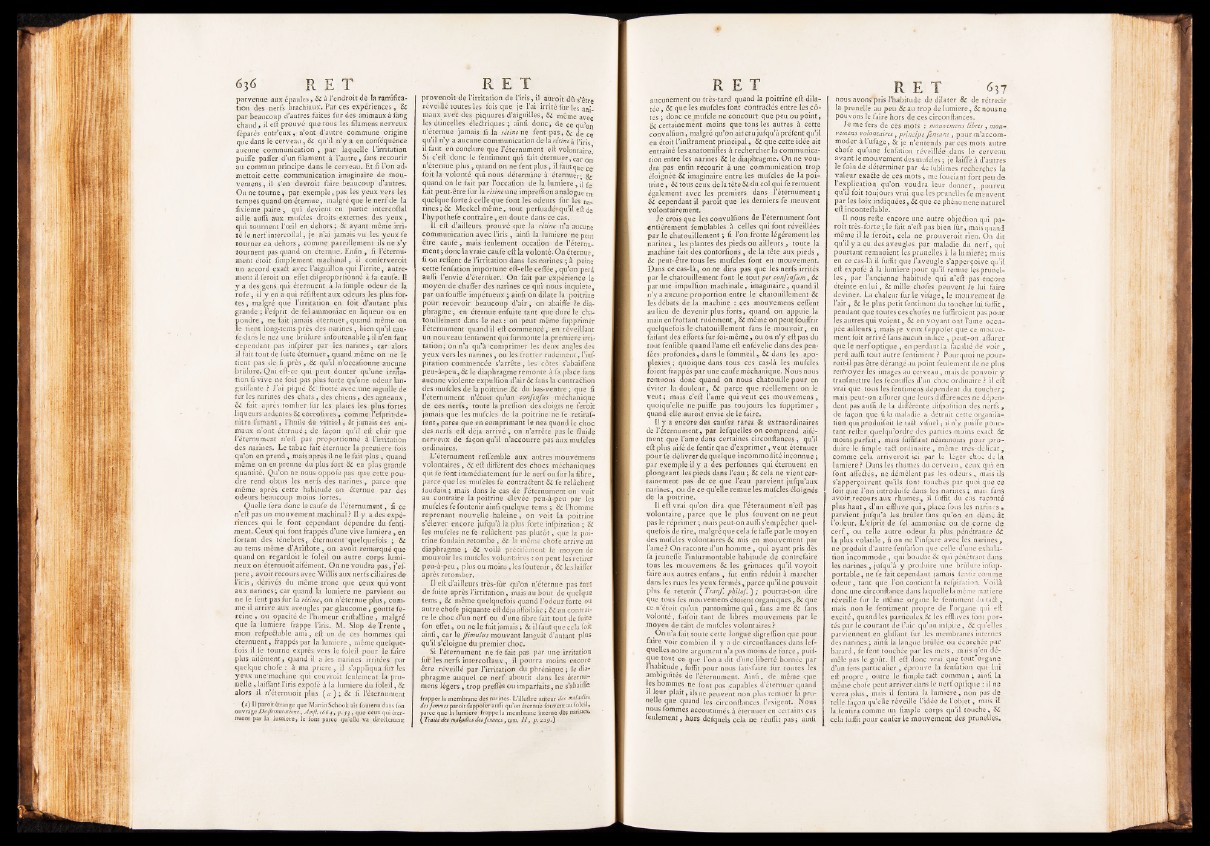
6 3 6 R E T
|,;ri
1 it
V
lin
. i
parvenue aux épaules, à l'endroit de la ramification
des nerfs brachiaux. Par ces expériences ,
par beaucoup d’autres faites lur des animaux à lang
chaud , il elt prouvé que tous les filamens nerveux
feparés entr’eux, n’ont d'autre commune origine
que dans le cerveau , & qu’il n’y a en conféquénee
aucune communication , par laquelle l ’irritation
puilTe pafTer d’un filament à l’autre, fans recourir
au commun principe dans le cerveau. Et fi l’on ad-
mettoit cette communication imaginaire de mou-
vemens, il s’en devroit faire beaucoup d’autres.
On ne tourne , par exemple, pas les yeux vers les
tempes quand on éternue, malgré que le nert de la
fixieme paire , qui devient en partie intcrcollal
aille aulTi aux mufcles droits externes des yeux,
qui tournent l’oeil en dehors; & ayant même irrité
ie nerf intercolial, je n'ai jamais vu les yeux fe
tourner en dehors, comme pareillement iis ne s’y
tournent pas quand on éternue. Enfin , fi i’éternu-
inent étoit fimplement machinal, il conl’erveroit
un accord exaét avec l’aiguillon qui l’irrite, autrement
il l'eroit un effet dilproporiionné à ia caufe. Il
y a des gens qui éternuent à la fimple odeur de la
rofe , il y en a qui réfiftent aux odeurs les plus fortes,
malgré que l’irritation en loit d’autant plus
grande ; l’elprit de fel ammoniac en liqueur ou en
poudre, ne fait jamais éternuer, quand même on
le tient long-tems près des narines , bien qu’il caille
dans le nez une brûlure infoutenable ; il n’en faut
cepc’ndant pas inljfirer par les narines, car alors
il fait tour de l'ulte éternuer, quand même on ne le
tient pas de fi près, 6c qu’il n’occafionne aucune
briilurc. Qui eft-ce qui peut douter qu’une irritation
fi vive ne loit pas plus forte qu’une odeur lan-
guiffante ? J’ai piqué 6c frotté avec une aiguille de
ter les narines des chats, des chiens, des agneaux,
&C fait apres tomber lur les plaies les plus fortes
liqueurs ardentes & corroiives , comme l’elprit-de-
niire fumant, l’huile de vitriol, jamais ces animaux
n'ont éternué; de façon qu’il cil cl.iir que
réternument n’elt pas proportionné à l’irritation
des narines. Le tabac fait éternuer la premiere fois
qu’on en prend, mais après il ne le fait plus, quand
meme on en prenne du plus fort en plus grande
quantité. Qu’on ne nous oppofe pas que cette poudre
rend obtus les nerfs des narines, parce que
même après cette habitude on éternue par des
odeurs beaucouj> moins fortes.
Quelle fera donc la caufe de réternument, fi ce
n’eff pas un mouvement machinal? II y a des exj)é-
riences qui le font cependant dépendre du fenti-
ment. Ceux qui font frappés d’une vive lumière , en
fortant des ténèbres, éternuent quelquefois ; 6c
au tems meme d’Ariffotc , on avoir remarqué que
quand on regardoit le foleil ou autre corps lumineux
on éternuoitaifement. On ne voudra pas, j’ef-
pcrc, avoir recours avec Willis aux nerfs ciliaires de
l’iris , dérivés du même tronc que ceux qui vont
aux narines; car quand la lumière ne parvient ou
ne fe lent pas fur la rétine, on n’éternue plus, comme
il arrive aux aveugles par glaucome , goutte fe-
reine , ou opacité de l’humeur criftallinc, malgré
que la lumière frappe l’iris. M. Slop de Trente ,
mon refpcélable ami, ert un de ces hommes qui
éternuent, frappés par la lumière, rnéme quelquefois
il fe tourne exprès vers le foleil pour le faire
plus aifément, quand il a les narines irritées par
quelque chofe ; à ma pricre , il s’appliqua fur les
yeux une machine qui couvioit feulement la prii-
ueilc , laifiant l’iris expofé la lumière du foleil, &
alors il n’éternuoit plus ( ) ; & fi l’étcrnumcnt
Q) Il parolt étrange que Martin Schook ait foiifemi dans fon
ouvrage Dejkrnuiiitione, 1664, }>■ JS, que ceux <|ui éternuent
par la luuiiere, le font parte qu'elle va tlircélciiieiu
R E T
provenoit de l’Irritation de l’iris, il aiiroit dû s’être
réveillé toutes les fois que je l’ai irrite fur les animaux
avec des piquures d’aiguilles, 6c meme avec
les étincelles cledlriqites ; ainfi donc, de ce qu’on
n’éternue jamais fi la rétine ne fent pas, 6c de ce
qu’il n’y a aucune communication de la rétine à pii-jj
il faut en conclure que réternument eff volontaire!
Si c'eff donc le lemiment qui fait éternuer,car on
n’éternue plus , quand on ne fent plus, il faut que ce
loit la volonté qui nous détermine h éternuer; 6c
quand on le tait j^ar l’occafion de la lumière , \[ fg
lait peut-être lur laré/i/2eiinc imprelfioii analogue en
quelque forte à celle que font les odeurs fur les narines
; (Sc Mcckelmême, tout perluadé-qu’il elt de
l ’hypothelc contraire, en doute dans ce cas.
11 ell d’ailleurs prouvé que la rétine n’a aucune
cominunicaiion avec l'iris, ainfi la lumière ne peut
être caille, mais leulement occafion de réternu-
ment; donc la vraie caufe cil la volonté. On éternue,
fi On relient de l’irritation dans les narines ; à peine
cette lenfation importune ell-elle cefiée, qu’on perd
aufli l’envie d’éternuer. On lait par expérience le
moyen de chaffer des narines ce qui nous inquiète,
par un foiiffie impétueux ; ainfi on dilate la poitrine
pour recevoir beaucoup d’air , on abaiflé le diaphragme,
en éternue enfuite tant que dure le chatouillement
dans le nez: on peut même fupjjrlmer
réternument quand il cil commencé, en réveillant
un nouveau lemiment qui furmonte la premiere irritation;
on n’a qu’à comprimer les deux angles des
yeux vers les narines, ou les frotter rudeineut ,rinf-
piration commencée s’arrête , les côtes s’abaiffent
peu-a-peu, 6c ie diaphragme remonte à fa place fans
aucune violente expullion d’air & fans la contraction
des imilcles de la poitrine .6i du bas-ventre ; que fi
l’éternument n’etoit qu’un confenfus méchanique
de ces nerfs, toute la prefiion des doigts ne feroit
jamais que les mufcles de la poitrine ne le retiraf-
fent, parce que en comprimant le nez quand le choc
des nerfs eff déjà arrivé , on n’arrête pas le fluide
nerveux de façon qu’il u’accourre pas aux mufcles
ordinaires.
L’éterniiment rcffcmble aux autres monvemens
volontaires , 6c eff différent des chocs méchaniques
qui lé font immédiatement fur le nerf ou fur la fibre,
parce que les mulcles lé contractent 6c le relâchent
loudain; mais dans le cas de I’ctcrnumenr on voit
au contraire la poitrine élevée peu-à-peu par les
mulcles fefoutenir ainfi quelque tems ; 6c l’homme
reprenant nouvelle haleine , on voit la poitrine
s’élever encore jufqu’à la plus forte infpirafion ; &C
les mulcles ne fe relâchent pas plutôt, que la poitrine
loudain retombe , 6c la meme chofe arrive au
diaphragme ; 6c voilà prccilé'mcnt le moyen de
mouvoir les mufcles volontaire,') : on peut les reiirer
peu-à-peu , [fins ou moins, les foutenir, 6c Icsiaiflér
aprc.s retomber.
Il eff d’ailleurs tres-fùr qu’on n’élcrnue jias tonî
de lutte après rirritation , mais au bout de quelque
tems , 6c même quelquefois quand l’odeur forte ou
autre chofe piquante eff déjà affoiblic; 6c au contraire
le choc d’un nerf ou d’une fibre fait tout de luite
fon effet, ou ne le fait jamais ; & H làut que ccl.i loit
ainfi, car le Jlimulus mouvant languit d’autant plus
qu’il s’éloigne du premier choc.
Si réternument no fe fait pas par une irritation
fur les nerfs intercoffaux , il pourra moins encore
être réveillé par l’irritation du phrénique ; le diaphragme
auquel ce nerf aboutir dans les érernu-
mens légers , trop preffés ou imjiarfalts, ne s’abaifle
fmppcrb membrane des narines. L’illiiftrc nUtciir Jes maLidic-i
des femmes paroit fup[)ofcr aiilfi rpi'on ctcrmic f p.ijxc que la liimicre frappe la mcmlirane inteorinivec dnCt ïa nn afioiulecisl,,
(^Trauides mMiidii.sdtijemmci yiÿin. I l ,
R E T
aucunement ou très-tard quand la poitrine eff dilatée
, & que les mulcles font contradés entre les côtes
; donc ce miifcle ne concourt que peu ou point,
6c certainement moins que tous les autres à cette
convulfion , malgré qu’on ait cru jufqu’à prélent qu’il
en ctoit i’inffrument principal, & que cette idée ait
entraîné lesanatomiftes à rechercher la communication
entre les narines 6c le diaphragme. On ne voudra
pas enfin recourir à une conimimication trop
éloignée 6c imaginaire entre les mulcles de la poitrine
, 6c tous ceux de la tête 6c du col qui fe remuent
également avec les premiers dans l’cternument ;
cependant il paroît que les derniers fe meuvent
volontairement.
Je crois que les convulfions de l’cternument font
entièrement femblables à celles qui font réveillées
par le chatouillement ; fi l’on frotte légèrement les
narines , les plantes des pieds ou ailleurs , toute la
machine fait des contorfions, de la tête aux pieds ,
6c peut-être tous les mufcles font en mouvement.
Dans ce cas-là, on ne dira pas que les nerfs irrités
par le chatouillement font le tout per conf-nfum, 6c
par une impulfion machinale, imaginaire, quand il
n’y a aucune proportion entre le chatouillement &
les débats de la machine : ces mouvemens ceffénr
au lieu de devenir plus forts, quand on appuie la
main en frottant rudement, 6c même on pcutfouffnr
quelquefois le chatouillement làns fe mouvoir, en
faifant des efforts fur foi-même, ou on n’y ell pas du
tout fenfible quand l’ame eff enfevelie dans des pen-
fées profondes, dans le fommeil, 6c dans les apoplexies
; quoique dans tous ces cas-là les mufcles
foient frappés par une caufe méchanique. Nous nous
remuons donc quand on nous chatouille pour en
éviter la douleur, 6c parce que réellement on le
veut; mais c’eff l’ame qui veut ces mouvemens,
quoiqu’tdle ne puiffe pas toujours les lupprimer ,
quand elle auroir envie de le faire.
Il y a encore des caufes rares & extraordinaires
de l'éterniiment, par lefqiielles on comprend ail'é-
ment que l’ame dans certaines circonffances , qu’il
eff plus aifé de fentirqiie d’exprimer, veut éternuer
pour fe délivrer de quelque incommodité inconnue ;
p.ar exemple il y a des perfonnes qui éternuent en
plongeant les pieds dans l’eau ; & cela ne vient certainement
pas de ce que l’eau parvient jufqu’aux
narines, ou de ce qu’elle remue les mufcles éloignés
de la poitrine.
Il eff vrai qu’on dira que l’éternument n’eff pas
volontaire, parce que le plus fouvent on ne peut
pas le réprimer ; mais peut-on aufli s’empêcher quelquefois
de rire., malgré que cela fc fafl'e parle moyen
des mufcles volontaires 6c mis en mouventent par
l’amc ? On raconte d’un homme , qui ayant pris dés
fa jcunefl’e l'infiirmomablc habitude de contrefaire
tous les mouvemens 6c les grimaces qu’il voyoit
faire aux avitrcs enfans , fut enfin réduit à marcher
dans les rues les yeux fermés, parce qu'il ne pouvoir
plus fe retenir {^Tranf. philof. ) ; pourra-t-on dire
que tous (es mouvemens étoient organiques ,& que
Ce n'etoit qu’un pantomime qui, fans amc 6c fans
volonté, finfüit tant de libres mouvemens par le
moyen de tant de mufcles volontaires?
ün n’a fait toute cotte longue digreflion que pour
faire voir combien U y a de circonffances dans Ic-f-
qucUcs notre argument n’a pas moins de force, puif-
que tout ce que l'on a dit d'une liberté bornée [)ar
1 habitude , ffiflit pour nous lati'-f.iire fur toutes les
ambiguités de réternument. Ainli, de meme que
les hommes ne font pas capables d'éternuer quand
il leur plaît, llsne peuvent non plus remuer la prunelle
que quand Rs circonffances l'exigent. Nous
nous fommes accoutumés à éternuer en certains cas
fiiulement, hors defquels cela «e réulfic pas; ainfi
R E 6;? nous avons pris l’habitude de dilater 6c de rétrécir
la prunelle au peu 6c au trop de lumière, 6c nous ne
pouvons le faire hors de ces circonffances.
Je me 1ers de ces mots : mouvemens. libres , mou~
vemens voLonudres , principe fenuini , pour m’accom-
moder à Uifage, & je n’entends par ces mots autre
chofe qu’une fenfation réveillée dans le cerveau
avant le mouvement des mufcles ; je laifl'e à d’autres
le foin de déterminer par de lubümes recherches la
valeur exadfe de ces mots, me foucunt fort peu de
l’explication qu’on voudra leur donner, pourvu
qu’il foit toujours vrai que les primcUes fe meuvent
par les loix indiquées, 6c que ce phénomène naturel
eff inconteffable.
Il nous relie encore une autre objeélioa qui paroît
très-forte ; le fait n’eff pas bien fiir, mais (|uand
même il le feroit, cela ne proiiveroit rien. On dit
qu’il y a eu des aveugles par m.iladie du nerf, qui
pourtant remiioient les i)riincllesà la lumière; mais
eu ce cas-là il fuflit que l’aveugle s’apperçoive qu'il
elt expofé à la lumière pour qu'il remue les prunelles,
par l’ancienne habitude qui n’eft pas encore
éteinte en lui, 6c mille chofes peuvent le lui faire
deviner. La chaleur fur le vilage, le mouvement de
l’air, 6c le plus petit fentimem du toucher lui fulHt,
pendant que toutes ces chofes ne fuffiroiont pas pour
les autres qui voient, 6c en voyant ont Vame occupée
ailleurs ; mais je veux fuppoler que ce mouvement
(oit arrivé fans aucun indice, peut-on affurcr
que le nerf optique , en perd.iut la faculté de voir ,
perd auffi tout autre fentimem ? Pourquoi ne pour-
roit-il pas être dérangé au point feuiemeni de ne plus
renvoyer les images au cerveau , in.iis Je pouvoir y
tninlmettrc les f'ecoulîés d’un choc ordinaire ? i! elt
vrai que tous les fentimens dépendent du toucher;
mais peut-on affurcr que leurs différences ne déjiLTi-
deiit pas auffi de la différente difpoiîtion des nerfs ,
de façon que fila malndie a détruit cette organila-
tion qui produiloii le taff viluel, il n’ '/ puiiTe [)our-
tant relier quelqii’ordre des parties mj'ms exact 6c
moins [Jarfait, mais luflîlaat néanmoins pour produire
le fimple taél ordin.iire , même ircs-delicat,
comme cel.i arriverolt i^i jxir le léger choc de la
lumière ? Dans les rhumes du cerveau , ceux qui ea
font arteélés, ne démêlent pas les odeurs, mais ils
s’apperçoivent qu'ils lom touches [).ir quoi que ce
foit que l'on introduife d.ins les narines; mai) fans
avoir recours aux rhumes, il fuflit du cas raconte
plus haut, d’un erfluve qui, place.fous les narin 's »
parvient jufqu’a les brûler fans qu’on en dénie âc
l’o.leiir. L’efprit de fol ammoniac ou <lc corne de
ce rf, ou telle autre odeur la plus pénétrante 6«i
la plus volatile , fi on ne l’ iiifpire avec les narines ,
ne produit d’autre lenfation que celle d'une exhalation
incommode , qui bouche 6c qui pénétrant d.ins
les narines, juf'qu’à y produire une brûlure Inf'up-
portable, ne (e fait cependant ïamais ientir comme
odeur, tant que l'on contient i.i relpiration. Voil'i
donc une circonflance d.ms laquelle la même matière
réveille fur le même orgme le lentinient .lu t.icl ,
mais non le f'enriment propre de l’organe qui eff
excité, quand les particules 6c les efll.ives font portés
par le courant de l’air qu’on inlpirc, 6c qu'elles
p.irviennent en gliiîant lur les inembr.ines internes
des narines ; ainfi la Lingue brûlée ou écorchée [j.ar
ha/.ard , f'e (ènr touchée par les mets, m ils n’en démêle
pas ie gnût. Il eff donc vr.ii que toiit’orgme
d’un feus particulier, éprouve Li fenfation qui lui
eff propre , outre le (impie rail commun; ainfi la
même chofe peut arriver dans le nerf optique : il ne
verra plus, mais il fentira la lumière, non pas de
telle fiçon qu’elle réveille l’idée de l objet, mais il
la fentira comme un fimple corps (|ii’ii touche, 6c
cela lûiHt pour caufer le mouvement des prunelles.
I Q|fif|u 11