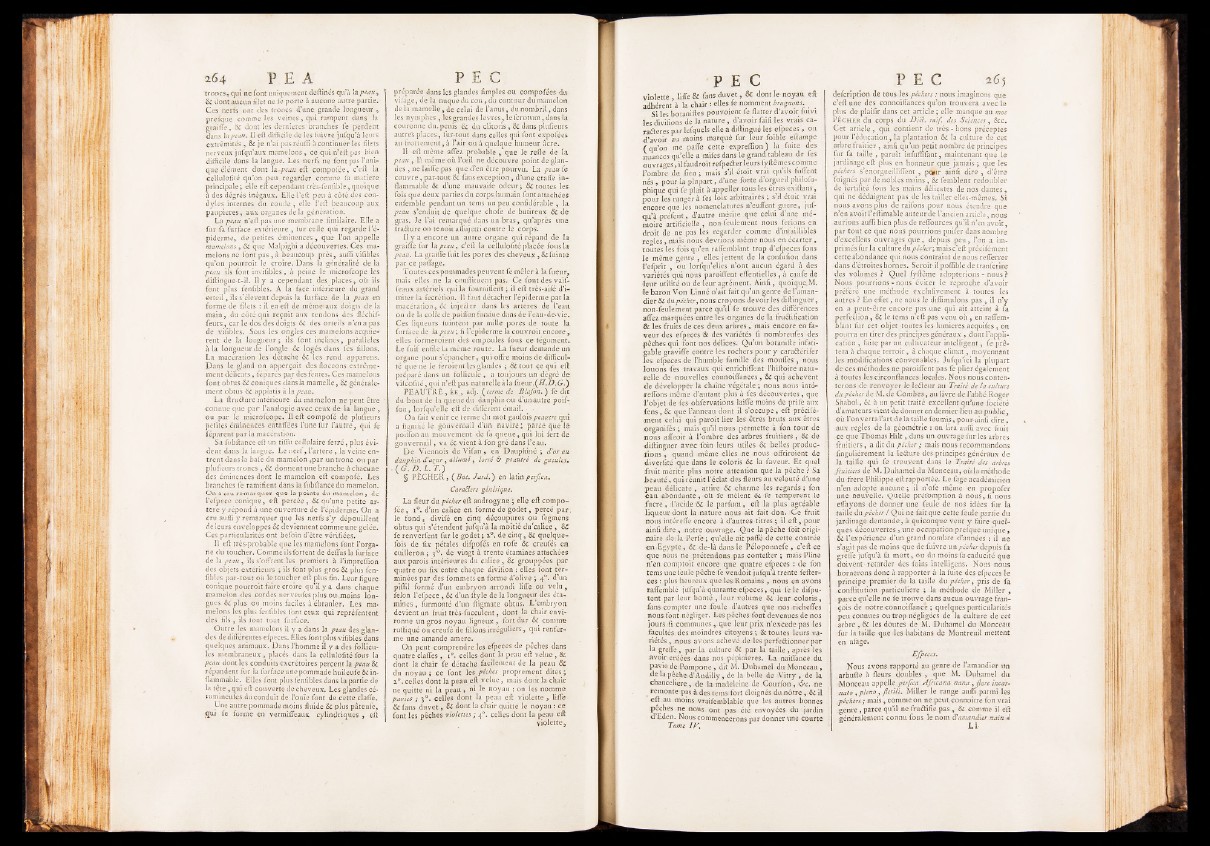
■ 11 r 2.64 P E A
‘ j - »,
troncs,-qui ne font uniquement defines qu’à la
& dont aucun filet ne le porte à aucune autre parue.
Ces nerfs ont des troncs d’une grande longueur ,
prefque comme les veines , qui rampent dans la
graifî'e, dont les dcrnicrcs branches fe perdent
clans la/’c./w. Il efl difficile de les fuiv’ rc jiifqu’à leurs
e^trt■ nmcs, & je n'ai pas rcuiii à continuer les filets
nerveux jufqu’aux mamelons , ce qui n’eff pas bien
difficile dans la langue. Les nerh ne font pas l’iini-
que clément dont h'pcu/i cil compofee, c’clf la
cellulofité qu’on peu regarder comme fa matière
principale; elle eft cependant crès-femible , quoique
à des degrés inégaux. Elle l’eCt jicu à côté des condyles
internes du coude , elle l’efl beaucoup aux
paupières, aux organes de la génération.
La peau n'efl [las une membrane fimilaire. Elle a
fur l'a lin face extérieure , fur celle qui regarde l ’épiderme,
de petites éminences, que l’on appelle
mamelons , & que Malpighi a découvertes. Ces mamelons
ne font pas, à beaucoup près, autli vifibles
qu’on pourroit le croire. Dans la généralité de la
peau ils font invillbles , à peine le microfeope les
ciiftlngue t-il. Il y a cependant des places, oii ils
font plus fenlibles. A la face inferieure du grand
orteil, ils s'élèvent depuis la luiface de la peau en
forme de filets : il en eft de meme aux doigts de la
main, du côté qui reçoit aux tendons des fléchil'-
feurs, car le dos des doigts bc des orteils n’en a pas
de vifibles. Sous les ongles ces mnineions acc|iiie-
rent de la longueur; ils font inclinés, parallèles
à la longueur de l’ongle logés dans les filions.
La macération les détache & les rend appareils.
Dans le gland on appercoit desfloccons extrêmement
délicats , léparcs par des fentes. Ces mamelons
font obtus bv coniques dans la mamelle, Sw généralement
obtus bi applatis à la peau,
La firucKirc intérieure du mamelon ne peut être
connue que par l’analogie avec ceux de la langue ,
ou par le microfeope. Il efl compofé de plufieurs
petites éminences entalfées l’une fur l’autre, qui fe
Icparent [>ar la macération.
Sa l'ubfiance efl un tilTu cellulaire ferré, plus évident
dans la langue. Le nerf, l'artere , la veine entrent
dans-l;i baie du mamelon ,par un tronc ou par
plufieurs troncs , & donnent une branche à chacune
des éminences dont le mamelon efl compofé. Les
branches fe ramifient dans la fubftancedu mamelon.
Ün a cru remarquer que la pointe du mamelon, de
Teipece conique, eft percée, & au’une petite artère
y répond à une ouverture de l’épiderme. On a
cru auffii y remarquer que les nerfs s’y dépouillent
de leurs enveloppes & deviennent comme une gelée.
Ces particularités ont befoin d'etre vérifiées.
Il efl très-probable que les mamelons l'ont l’organe
du loucher. Comme ilsfortent de défias la furfàce
de !a peau , ils s'offiront les premiers à l’impreffiion
des o'ujets extérieurs ; ils font plus gros & plus l'en-
fiblcs par-tout oii le toucher efl plus fin. Leur figure
conique pourroit faire croire qu’il y a dans chaque
mamelon des cordes nerveiifes plus ou moins longues
bc plus ou moins faciles à ébranler. Les mamelons
les plus fenlibles font ceux qui repréfentent
des fils , ils lont tour flirffice.
Outre les mamelons il y a dans la peau des glandes
de dilFérenies efpeces. Elles font plus vifibles dans
quelques animaux. Dans l’homme il y a des follicules
membraneux , places dans la cclliiîofitc fous la
peau dont les conduits excrétoires percent la peau &
répandent fur la llirfaceunepommade huileufebcinflammable.
Elles font plus fenlibles dans la partie do
la tête , qui eft couverte de cite veux. Les glandes cé-
rumineufes du conduit de l’oiue font de cette clafTe.
Dnc autre pommade moins fluide & plus pâieulé,
qui le forme en vermillcaux cylindriques , ell
P E C
préparée dans les glandes fimples ou compofees du
viiage, de la nuque du cou , du contour du mamelon
de la mamelle, de celui de ranus, du nombril, dans
les nymphes , les grandes levres, Icfcrotum, dans !a
couronne du. penis bc du clitoris, bc dans plufieurs
autres places, fur-tout dans celles qui font expofees
au frottement, à l’air ou à quelouc humeur âcre.
Il efl même allez probable , que le refte de la
peau , là même oi'i l’oeil ne découvre point de glandes
, ne laiffic pas que d’en être pourvu. La peau fe
couvre, par-tout bc fans exception , d’une cralfe in-
fhimmable & d’une mauvaife odeur; &: toutes les
fois que deux parties du corps humain font attachées
enfcmble pendant un tems un peu conlidérable , la
peau s’enduit de quelque choie de butireux b£ de
gras. Je l’ai remarque dans un bras, qu’apres une
fraflure on tenoic airujctti contre le corps.
Il y a encore un autre organe qui répand de la
graiffic fur l'àpcau, c’eft la cellulofité placée fous la
peau. La graille fuit les pores des cheveux , & lainte
par ce pallage.
Tomes ces pommades peuvent fe mêler à la fueiir,
mais elles ne la conflituent pas. Ce font des vaif-
feaux artériels qui la fournillent ; il eft très-aifé d’imiter
la fecrétion. Il faut détacher l’épiderme par la
macéraiion, ÖC injccler dans hs arteres de l’cau
ou <lc la colle de poillon fondue dans de l’eau-de-vie.
Ces liqueurs iuintent par mille pores de toute la
furface de la peau ; li l’epiderme la couvroit encore,
elles formeroient des empoules fous ce tégument.
Le f'uif enfile lu meme rouie. La lueur demande un
organe pour s’éjiancher, qui offre moins de difficulté
que ne le ferolent les glandes ; & tout ce qui eft
préparé dans un follicule , a toujours un dégré de
vilcoliic, qui n’eftpas natiirelIeàiaftieur.(.^f.D.G.)
PEAUTRÈ , ÉE , adj. {_terme de Blajon. ) fe dit
du bout de la queue du dauphin ou d’unautre poif-
Ibn, lorfqu’elle eft de différent émail. •
On fait venir ce terme du mot gaulois peautre qui
a fîgniiîé le gouvernail d’un navire; parce que le
poiflon au mouvement de fa queue, qui lui fert de
gouvernail, va bi vient à fon gré dans l’eau.
De Viennois de Vifan , en Dauphiné ; d'or au
dauphin d'azur , allumé , lorré & peaulré de gueules,
( G. D . L. T. )
§ PÊCHER, {^Bot. Jard.') en latinpirjîca.
Caractère générique.
La fleur du pécher androgyne ; elle eft compo-
fée , 1°. d’un calice en forme de godet, percé par,
le fond, divifé en cinq découpures ou fegmens
obtus qui s’étendent jufqu’à la moitié du'calite , bb
fe renverfent fur le godet ; de cinq, àc quelquefois
de fi.x pétales difpofés en rofe ik. creufés en
cuilleron ; 3°. de vingt à trente étamines att-achées
aux parois intérieures du calice , & grouppées par
quatre ou fix entre chaque diviiion ; elles font terminées
par des fommets en forme d’olive ; 4'’. d’un
piftil formé d’un embryon arrondi lifl'e ou velu ,
félon l’efpece , bc d’un llyle de la longueur des étamines
, furmonté d’un ftigmate obtus. L’embryon
devient un fruit très-fiicciilent, dont la chair environne
un gros noyau ligneux , fort dur & comme
ruftiqué ou creiifc de filions irréguliers, qui renferme
une amande amerc.
On peut comprendre les efpcces de pêches dans
quatre dalles , i^. celles dont la peau cil velue , &
dont la chair fe détache facilement de la peau &
du noyau; ce font \cs pèches proprement dites;
2°. celles dont la peau eft velue , mais dont la chair
ne quitte ni la peau , ni le noyau ; on les nomme
puvies ; 3''. celles dont la peau cil violette , lifle
bc fans duvet, & dont la chair quitte le noyau : ce
font les pêches violettes ; celles dont la peau eft
violette,
P E C
violette , lilTe U fans duvet, & dont le noyau eft
adhérent à la chair : elles fe nomment brugnons. ^
SI les botaniftes pouvolent fc flatter d’avoir fuivt
les divifions de la nature , d’avoir faili les vrais ca-
raÛeres par lefquels elle a diltingué les efpeces, ou
d’avoir au moins marqué fur leur foible eftampe
( qu’on me paffe cette expreffion ) la fuite des
nuances qu’elle a mifes dans le grand tableau de fes
ouvrages, il faudroit refpeéler leurs fyftcmes comme
l’ombre du fien ; mais s'il étoit vrai qu ils tuftent
nés , pour la plujiart, d’une forte d orgueil pinlofo-
phique qui fe plaît à appeller tous les ctres exiflans,
pour les ranger à les loix arbitraires ; s il etoit vrai
encore que les nomenclatures iieulTent guere, juf-
qu’à préfent, d’autre mérite que celui d’une mémoire
artificielle, non-feulement nous ferions en
droit de ne pas les regarder comme d’infaillibles
relies , mais nous devrions même nous en écarter ,
toutes les fois qu’en raflémblant trop d’elpeces fous
le meme genre , elles jettent de la confufton dans
l’efprlr , ou lorfqu’ellcs n’ont aucun égard à des
variétés qui nous paroiflent effentiellcs , à caufe de
leur utilité ou de leur agrément. Ainfi, quoique M.
le baron Von Linné n’ait fait qu’un genre de l’amandier
&:c!u/»^'c/ze/-, nous croyons devoir les diftinguer,
non-feulement parce qu’il fe trouve des différences
affez marquées entre les organes de la fruéllfîcation
& les fruits de ces deux arbres, mais encore en faveur
des efpeces Ht des variétés fi nombreufes des
pêches qui font nos délices. Qu’un botanifte infatigable
graviffe contre tes rochers pour y caraélérifer
les efpeces de l’humble famille des moufles , nous
louons fes travaux qui enrichiffent l’hilloire naturelle
de nouvelles connoiffances , & qui achèvent
de développer la chaîne végétale ; nous nous inté-
reffons même d’autant plus à fes découvertes, que
l ’objet de fes obfervations laifl'e moins de prile aux
fens, k que l’anneau dont il s’occupe, eft pvécifé-
ment celui qui paroît lier les êtres bruts aux êtres
organifés ; mais qu’il nous permette à fon tour de
nous affeoir à l ’ombre des arbres fruitiers , 6c de
diftinguer avec foin leurs utiles & belles procluc-
lions , quand même elles ne nous offriroient de
diverlité que dans le coloris & la faveur. Et quel
fruit mérite plus notre attention que la pêche } Sa
beauté, qui réunit l’éclat des fleurs au velouté d’une
peau délicate , attire & charme les regards ; Ibn
eau abondante , oîi fe mêlent &C fe temperent le
Lucre , l’acide 6c le parfum , eft la plus agréable
liqueur dont la nature nous ait fait don. Ce fruit
nous intcreft'e encore à d’autres titres ; il c i l , pour
ainfi dire , notre ouvrage. Que la pêche foit originaire
de lu Perfe ; qu’elle ait pafl'é de cette contrée
en Egypte, 6c de-là dans le Pcloponnefe , c’eft ce
que nous ne prétendons pas conteller ; mais Pline
n’en comptoïc encore que quatre eipeces : de fon
tems une feule pêche fe vendoit jui'qu’à trente fefter-
ces ; plus heureux que les Romains , nous en avons
rallemblé jufciu'à quarante efpeces, qui fe le difpu-
tent par leur bonté , leur volume & leur coloris,
fans compter une foule d’autres que nos richelles
nous font négliger. Les pêches font devenues de nos
jours fi communes, que leur pri.x n’excede pas les
facultés des moindres citoyens ; & toutes leurs variétés
, nous avons achevé de les perfeélionner par
la grcft'o, par la culture 6c par la taille, après les
avoir créées dans nos pépinières. La naiflance du
pavie de Pompone , dit M. Duhamel du Monceau ,
de la pêche d’Andilly , de la belle de Vitry , de la
chancelicro , de la madeleine de Courfbn , &c. ne
_ remonte pas à des tems tort éloignés du nôtre , 6c il
eft au moins vraifcmblabie que les autres bonnes
péchés ne nous ont pas été envoyées du jardin
d Eden. Nous commencerons par donner une courte
Tome ly .
P E C 2 6 1
defcriprlon de tous les pêchers : nous imaginons que
c’eft une des connoiffances qu’on trouvera avec le
])lus de plailir dans cet article ; elle manque au mot PÊCHER du corps du Dicl. raif. des Sciences , 6cc.
Cet article, qui contient de très-bons préceptes
pour l’éducation, la plantation 6c la culture de cet
arbre fruitier , ainfi qu’un petit nombre de principes
fur fa taille , paroît infuffifant, maintenant que le
jardinage eft plus en honneur que jamais ; que les
pêchers s’enorgiiciruffe.nt , po#ir ainfi dire , d’être
foignés par de nobles mains , 6c femblent redoubler
de fertilité fous les mains délicates de nos dames,
qui ne dédaignent pas de les tailler elles-mêmes. Si
nous avons plus de raifons pour nous étendre que
n’en avoit l’eftimable auteur de l'ancien article, nous
aurions auffl bien plus de reffources qu’il n’en avoit,
par tour ce que nous pourrions jHiifer dans nombre
d’cxcellens ouvrages que, depuis peu, l’on a imprimés
fur la culture du pêcher-, mais c’eft précifément
cette abondance qui nous contraint de nous refi'errer
dans d’étroites bornes. Seroit il poflible de tranl'crire
des volumes ? Quel fyftême adopterions - nous ?
Nous pourrions - nous éviter le reproche d’avoir
préféré une méthode exclufivemcnt à toutes les
autres ? En efl'et, ne nous le diffimulons pas , il n’y
en a peuc-êire encore pas une qui ait atteint à fa
perfeclion , 6c le rems n'eft pas venu o ii, en raffem-
blant fur cet objet toutes les lumières acquifes , on
pourra en tirer des principes généraux , dont l’application
, faite par un cultivateur intolllgenf, le prêtera
à chaque terroir , à chaque climat, moyennant
les modifications convenables. Jufqu’ici la plupart
de ces méthodes ne paroifî'ent pas fe plier également
à toutes les circonftanccs locales. Nous nous contenterons
de renvoyer le leéleur au Traité de La culture
du pécher M. de Combes, au livre de l'abbé Roger
Shabot, 6c à un petit traité excellent qu’une Ibcicté
d’amateurs vient de donner en dernier lieu au public,
oîi l’on verra l’art de la taille Ibumis, pour-ainfi dire ,
aux réglés de la géométrie : on lira aufli avec fruit
ce que Thomas Hilr, dans un ouvrage fur les arbres
fruitiers, a dit du pécher; mais nous recommandons
lîngiiliérement la leélure des principes généraux de
la taille qui fe trouvent dans le Traité des arbres
fruitiers de M. Duhamel du Monceau, oîi la méthode
du frere Philippe eft rapportée. Le luge académicien
n’en adopte aucune ; il n'ofe même en propofer
une nouvelle. Quelle préfomption à nous, fi nous
effiayons de donner une feule de nos idées fur la
taille du pécher ! Qui ne i'aitque cette feule partie du
jardinage demande, à quiconque veut y faire quelques
découvertes, une occupation prel'qiie unique,
6c l’expérience d’un grand nombre d’années ; il ne
s’agit pas de moins que de fiuvrc un pécher àc^w\s fa
greffe jufqu’à fa mort, ou du moins fa caducité que
doivent-retarder des l'oins intelligens. Nous nous
bornerons donc à rapporter à la fuite des cfjicces le
principe premier de la taille du pécher, pris de fa
conftitution particulière ; la méthode de Miller ,
parce qu’elle ne fe trouve dans aucun oiu'rage fran-
çois de notre connoiffance ; quelques particularités
peu connues ou trop négligées de la culture de cet
arbre , 6e les doutes de M. Duhamel du Monceau
fur la taille que les habltans de Montreuil mettent
en uiage.
Efpeces.
Nous avons rapporté au genre de l’amandier un
arbufle à fleurs doubles , que M. Duhamel du
Monceau ajipelle perfica Africana nana,foreincar-
nato , pleno , ferili. Miller le range aulfi parmi les
pêchers; mais, comme on ne peut connoître fon vrai
genre , parce qu’il ne truftifie pa s, & comme il eft
généralement connu ions le nom Lamandier nain à