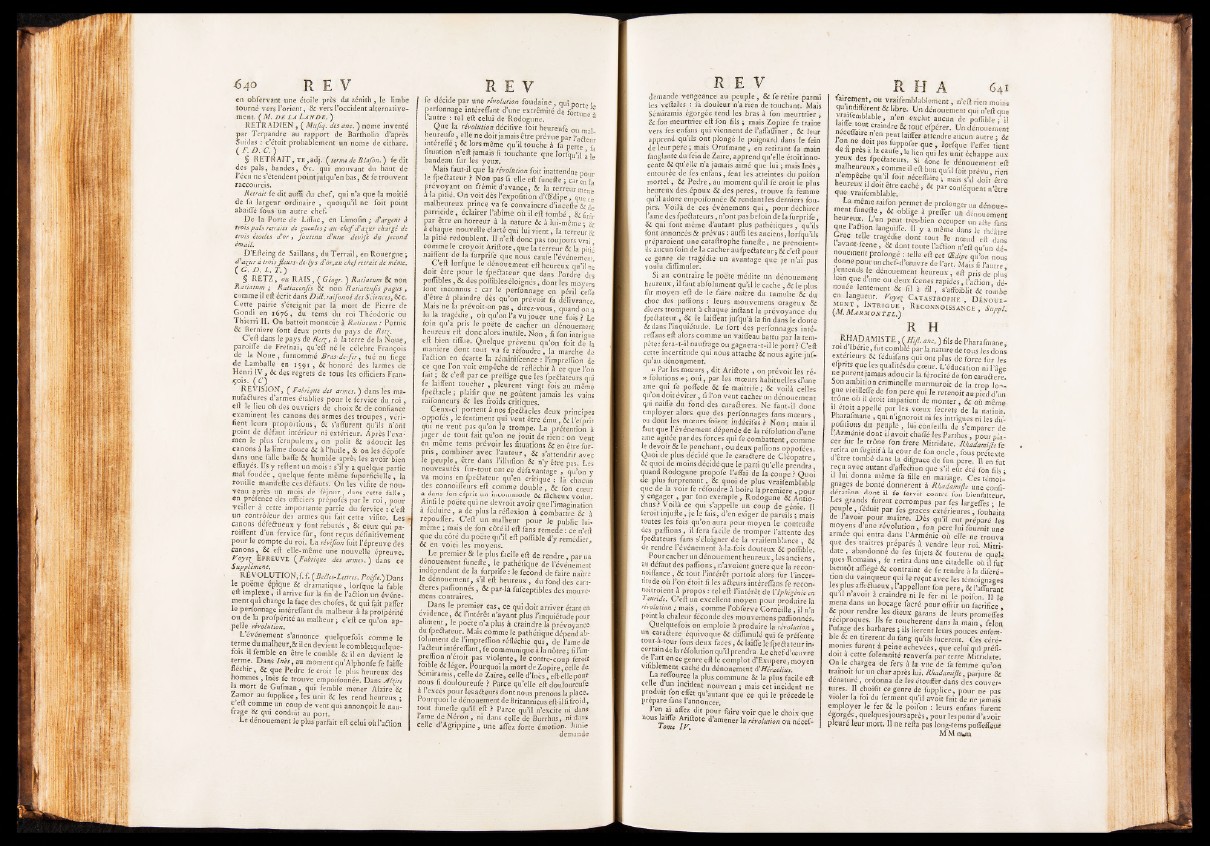
ill 1 '
■6 A O REV en obfervant une ctoüe près du zénith, le limbe
tourné vers l’orienr, & vers l’occident alternativement.
( M. DE LA L a n d e . )
RETRADIEN , ( Mufiq. des anc. ) nome inventé
par Terpandre au rapport de Bartholin d’après
Suidas : c’étoit probablement un nome de cithare.
( F . D . C. )
§ RETRAIT, TE,adj. de BUfon.') fedit
des pals, bandes, &c. qui mouvant du haut de
l ’écu nes’etendentpoimjulqu’enbas, & le trouvent
raccourcis.
Retrait fe dit aufll du chef, qui n’a que la moitié
de la largeur ordinaire , quoiqu’il ne foit point
abaiOé lous un autre chef.
De la Porte de EilTac, en Limofin ; d’argent à
trois pals retraits de gueules ; au chef d'a'^ur chargé de
trois étodts d'or, foucenu d'une devij'e du Jecond
émail.
D ’Elîeing de Sailians, du Terrail, en Rouerguc ;
d’azur à trois fieurs-dt-lys d'or,au chejretrait de même,
( G . D . L. T . )
§ RETZ, ou RAIS, ( Géogr. ) Ratiacum & non
Rdiiatum ; Ratiacenjïs & non Ratiatenfis pagus ,
comme il elî écrit dans Dicl. ralfonné desScienees, ficc.
Cette pairie s’éteignit par la mort de Pierre de
Gondi en 1676, du tems du roi Thcodoric ou
Thierri II. On battoit monnoie à Ratiacum: Pornic
& Berniere lont deux ports du pays de Ret‘^,
C e ll dans le pays de Ret{, à la terre de la Noue,
paroilTe de Freinai, qu’efl né le célébré François
de la Noue, lurnommé Bras-de-fer, tué au fiege
de Lamballe en 159^ » ^ honoré des larmes de
Henri IV , des regrets de tous les officiers Ffan-
.çois. ( C’ )
REVISION, ^ Fabrique des armes, ) dans les nia-
nufaélures d armes crablies pour le lervice du r o i ,
eü le heu oh des ouvriers de choix & de confiance
examinent les canons des armes des troupes, vérifient
leurs proportions, &: s’alTurent qu’ils n’ont
point de défaut intérieur ni extérieur. Après l’examen
le plus fcrupuleux, on polit & adoucit les
canons à la lime douce & à l’huile, & on les dépofe
dans une falle baffe & humide après les avoir bien
effuyés. Ifs y relient un mois : s’il y a quelque partie
mal loudée , quelque fente même fuperficielle , la
rouille maniléfie ces defauts. On les vifite de nouveau
après un mois de féjour, dans cette falle,
en prefence des officiers prepofes par le r o i , pour
veiller à ^ette importante partie du fervice : c’eff
un controleur des armes qui fait cette vifite. Les«
canons défeélueux y font rebutés , & ceux qui pa-
roiffent d’un fervice ffir, font reçus définitivement
pour le compte du roi. La révif on fuit l’épreuve des
canons , & eff elle-même une nouvelle épreuve.
ÉPREUVE {Fabrique des armes.) dans ce
Supplément.
RÉVOLUTION,f.f. {Btiks-Lettns. Poc/e.)Dans
le poeme épique & dramatique , lorfque la fable
eu implexe , il arrive fur la fin de l’afHon un événement
qui change la lace des chofes, 61 qui fait paffer
le perlonnage intéreffani du malheur à la profpérité
ou de la profpérité au malheur ; c’efi: ce qu’on appelle
revolution. ^
L événement s’annonce quelquefois comme le
terme dumalheiir,& il en devient le comble;que!que-
tois il femble en être le comble & il en devient le
terme. Dans Inès, au moment qu’Alphonfe fe laiffe
fiechir, & que Pedre fe croit le plus heureux des
hommes , Inès fe trouve empoifonnée. Dans y^lfe
la mort de Gufman, qui fembie mener Alzire Sc
Zamor au fupphce, les unit & les rend heureux ;
c elt comme un coup de vent qui annonçoit le nau-
trage 6c qui conduit au port.
Le dénouement le plus parfait eff celui oùl’aéUon :
R E V I fe décide par une revolution, foudaine , qui 00^.. *
' perfonnage intéreffant d’une extrémité de fortum» ^
l’autre : tel eff celui de Rodogune. ‘
Que la révolution décifive Ibit heiireufe ou mal
heureufe, elle ne doit jamais être prévue par l’afleiû
intéreffé ; & lors même qu’il touche à fa perte f"
fmiation n’eft jamais fi touchante que lorlqu’il aie
bandeau fur les yeux. ^
Mais faut-il que la révolution foit inattendue nour
le fpeaateur ? Non pas fi elle eff funefte ; car en h
prévoyant on frémit d’avance, & la terreur menL
a la pitie. On voit dès l’expofition d’CEdipe , que ce
malheureux prince va fe convaincre d’inceffe de
parricide , éclairer l’abîme où il eff tombé , & finir
par être en horreur à la nature te il lui-même ; &
à chaque nouvelle clarté qui lui vient, la terreur de
la pitié redoublent. Il n’eft donc pas toujours vrai
comme le croyoit Ariftote,que la terreur & la piti’
natlient de la turprile que nous caufe l’événement
C’eft lorique le dénouement eft heureux qu’il né
doit être pour le fpeaateur que dans l’ordre des
poffibles , & des polliblcséloignés, dont les moyens
inconnus : car le perfonnage en péril cede
d’être à plaindre dès qu’on prévoit fa délivrance
Mais ne la prévoioon pas, direz-vous, quand on é
lu la tragédie , oii qu’on l’a vu jouer une fois ? Le
foin qu’a pris le poète de cacher un dénouement
heureux ell donc alors inutile. Non , fi fou intrimie
efl bien tifllie. Quelque prévenu qu’on foit de” la
maniéré dont tout va fe réfoudre , la marche de
l’aaion en écarte la réiuinifcence : l’impreffion de
ce que l’on volt empêche de réfléchir à ce que l’on
fait ; & c’ert par ce preftige que les fpeaateiirs qui
fe laifient toucher , pleurent vingt fois au même
Ipeêfacle ; plaifir que ne goûtent jamais les vains
raifonneurs & les froids critiques.
Ceux-ci portent a nos fpeélacles deux principes
0[)pofês , le fentiment qui veut être ému, iSc l ’elprit
tfUi ne veut pas qu’on le trompe. La prétention à
Jiigcrye tout fait qu’on ne jouit de rien ; on veut
en même tems prévoir les fituations & en être fur-
pris , combiner avec l’auteur, & s’attendrir avec
le peuple, être dans l’illufion & n’y être pas. Les
nouveautés fur-tout ont ce défavantage , qu’on y
va moins en fpcftateiir qu’en critique : là chacun
des connoiffeurs eft comme double , & fon coeur
a dans fon efprit un incommode & fâcheux voifiii.
Ainfi le poeteqiiine devroit avoir que l’imagination
a feduire, a de plus la reflexion à combattre & à
repouffer. C’eft un malheur pour le public lui-
même ; mais de fon côté il eft fans remede : ce u’cft
que du côté du poète qu’il eft pofllble d’y remédier
êc en voici les moyens. ^
Le premier & le plus facile eft de rendre , par un
denouement funefte, le pathétique de l’événement
indépendant de la fiirprife : le fécond de faire naître
le denouement, s’il eft heureux , du fond des cara-
Seres paflionnés , & par-là fufceptibles des moiivc-
mens contraires.
^ Dans le premier cas, ce qui doit arriver étant en
evidence, & 1 intérêt n’ayant plus l’inquiétude pour
a iinent, le poète n a plus à craindre la prévoyance
du rpeèlatcur. Mais comme le pathétique dépend ab-
lolument de l’impreffion réfléchie q ui, de l’ame de
1 afteur intéreffant, fe communique à la nôtre; fil’ini*
preffion n étoit pas violente, le contre-coup feroic
foible & léger. Pourquoi la mort deZopire, celle ée
Semiramis, celle de Zaïre, celle d’Incs , eft-el!epotir
nous fi douloureufe ? Parce qu’elle eff douloiircufe
à l’excès pour lesafteiirs dont nous prenons la place.
Pourquoi le dénouement de Britannicus eff-ilfi froid,
tout funefte qu’il eff ? Parce qu’il n’excite ni dans
l’ame de Néron , ni dans celle de BLirrhins, ni dans
celle d Agrippine, une afl'ez forte émotion- Jume
demande
R E V demande vengeance au peuple, & fe retire parmi
les veffalcs : fa douleur n’a rien de touchant. Mais
Sémiramis égorgée tend les bras à fon meurtrier ,
te fon meurtrier eff fon fils ; mais Zopire fe traîne
vers fes enfans qui viennent de rafiaffiner , & leur
apprend qu’ils ont plongé le poignard dans le fein
de leurpere ; mais üroimane , en retirant fa main
fanglantedii feinde Zaïre, apprend qu’elle ctoitinno-
cente & qu’elle n’a jamais aimé que lui ; mais Inès ,
entourée de fes enfans, fent les atteintes du poifon
mortel, te Pedre, au moment qu’il fe croit le plus
heureux des epoux & des peres, trouve fa femme
qu’il adore empoilonnée & rendant les derniers fou-
pirs. Voilà de ces événemens q u i, pour déchirer
i’ame des fpedateurs, n’ont pas befoin de la fiirprife,
te qui font même d’autant plus paihctiques , qu’ils
font annoncés & prévus ; auffi les anciens, lorfqu’ils
préparoient une cataffrophe funefte, ne prenoient-
ils aucun foin de la cacher au fpeéfateur;ôèc’eff pour
ce genre de tragédie un avantage que je n’ai pas
voulu diffimuler.
Si au contraire le poète médite un dénouement
heureux, il faut abfolument qu’il le cache , te le plus
fiir moyen eff de le faire naître du tumulte te du
choc des pafiions ; leurs mouvemens orageux te
divers trompent à chaque inffant la prévoyance du
fpeffateur , & le laiffent jufqu’à la fin dans le doute
& dans 1 inquietude. Le fort des perfonnages inté-
relfaiis eff alors comme un vaiffeau battu par la tempête:
fera-t-il naufrage ou gagnera-t-il le port? C ’eft
cette incertitude qui nous attache te nous agite juf-
qu’au dénouement.
« Par les moeurs , dit Ariftote , on prévoit les ré-
» foUitions»; oui, par les moeurs habituelles d’une
ame qui fe poffede te fe maîtrife ; te voilà celles
qu’on doit éviter , fi l’on veut cacher un dénouement
qui nailTe du fond des caraêleres. Ne faut-il donc
e.mployer alors que des perfonnages fans moeurs ,
ou dont les moeurs foient indécifes ? Non ; mais il
fiut que l’événement dépende de la réfolution d’une
ame agitée par des forces qui fe combattent, comme
le devoir & le penchant, ou deux pafiions oppofées.
Quoi de plus décidé que le caraaere de Cléopâtre,
te quoi de moins décidé que le parti qu’elle prendra,
quand Rodogune propofe l’effai de la coupe? Quoi
de plus furprenant, te quoi de plus vraifemblable
que de la voir fe refoudre à boire la premiere , pour
y engager , par fon exemple, Rodogune & Antio-
c'uis? Voilà ce qui s’appelle un coup de génie. Il
leroit injiiffe, je le fais, d’en exiger de pareils ; mais
toutes les fois qu’on aura pour moyen le contraffe
des paffions, il fera facile de tromper l’attente des
fpeêtateurs fans s’éloigner de la vraifemblance , te
de rendre l’événement à-!a-fois douteux te poffible.
Pour cacher un dénouement heureux, les anciens,
au défaut des paffions, n’avoient guere que la recon-
noiffance , te tout l’intérêt portoit alors fur l’incertitude
où l’on étoit fi les aaeurs intereffans fe recon-
noitroient à propos : tel eff l’intérêt de Vlp/iigértie en
Tauride. C ’eff un excellent moyen pour produire la
revolution ; mais, comme l’obferve Corneille , il n’a
point la chaleur fficonde des mouvemens paffionnés.
Quelquefois on emploie à produire la révolution ,
un caradlere équivoque te diffimulé qui fc préfente
toiir-iVtour fous deux faces, & laiffe le fpeaateur incertain
de la réfolution qu’il prendra Le chef-d’oeuvre
^ genre eff le complot d’Exupere, moyen
viliblement caché du dénouement à’Héraclius.
La reffource la plus commune te la plus facile eft
celle d un inadent nouveau ; mais cet incident ne
pioduit Ion effet qu’autant que ce qui le précédé le
prepare fans I annoncer.
J en ai affez dit pour faire voir que le choix que
nous laiffe Ariftote d’amener la «Vote«« ou nécef-
Tome i r .
R H A 6 4 1
fiairement, ou vraifemblablemem , n’eft rien moins
qu indifférent te libre. Un dénouement qui n’eff oue
vrmfemblable , n’en exclut aucun de poffible ; i>
^aiudre & tout efpérer. Un dénouement
aire n en pem laiffer attendre aucun autre ; U
e fi près a la caufe, le lien qui les unit échappe aux
yei x des Ipedateurs. Si donc le dénouement eft
” n emm pecrhe" q' i i mtl fToit' neceflaire ; niais s’pilr édvouit, rêiterne
q ^ 'q iem b iaM e !
La même raifon permet de prolonger un dénoueînle"
uurreeiiix V.^ uL un’ ^pe ut tres-bien occupuenr duénn oa£uleem faennst
que adion ianguiflé. 11 y a meme dans le th-'ître
tarée telle tragédie dont tout fe noeud eft dans
avant-lcenc , & dont toute l’adion n’eft qu’un dénouement
prolongé : telle eft cet (EJip, q ,fo„ nous
donne pont unchel-d’oeuvre de l’art. Mais fi l’autre
) entends le dénouement heureux, eft pris de plu;
loin que d une ou deii.x feenes rapides, l’adion dénouée
lentement ik fil à fil , s’aflbiblit & tombe
Catastrophe , D énoüe-
jI ’ , Reconnoissakce , Suppl.
{M .M a r m o u t e l . ) ’
R H
, (iK/f. une. ) filsdePharafniane,
rot d Iberie, fut comblé par la nature de tous les dons
extérieurs & lediiifans qui ont pins de force fur les
elprits que les qualitésdu coeur. L’éducation ni l'âge
ne purent |amais adoucir la férocité de fon caraftere.
Son ambition criminelle niiirnuiroit de la trop io-'-
gue vieilleffe de fon pere qui le retenoit an pied d’un
tronc ou il eioit impatient de monter, & où même
il ctoit appelle par les voeux fecrets de la nation.
Pharalmane , qui n’ignoroit ni fes intrigues ni les dif-
pofitions du peuple , lui confeilla de s’empare-' de
l,Armeiiie dont li avoir chaffé les Parihes , pour r-la-
cer fur le trône fon frere Mitridate, WmdamiFk
retira en i'ugiiifà la cour de fon oncle, fous prétexte
d eire tombé dans la dlfgrace de fon pere. Il en fut
reçu avec autant d affection que s’il eût été fon fils ■
il lui donna même fa fille en mariage. Ces témoignages
de bonté donneront à RhadamifU une confi-
dération dont il fe fervit contre fon bienfaiteur.
Les grands furent corrompus par fes largeffes ■ le"
peuple, leduit par fes grâces extérieures, foiihaila
de i avoir pour maître. Dès qu'il eut préparé les
moyens d une révolution , fon pere lui fournit une
armee qui entra dans l'Arménie où elle ne trouva
que des traîtres préparés à vendre leur roi. Mitridate
. abandonné de fes fiijels & foutenii de qiield
ques Romains, fe retira dans une citadelle où il fut
bientôt afliégé & contraint de fe rendre à la diferé-
tion du vainqueur qui le reçut avec les témoignages
les plus affeaueux , l’appellant fon pere, & l’affurant
qu il n avoit à craindre ni le fer ni le poifon. Il le
mena dans un bocage facré pour offrir un facrifice
& pour rendre les dieux garans de leurs promelTes
réciproques. Ils fe touchèrent dans la main, félon
1 iilage des barbares ; ils lièrent leurs ponces enfem-
ble te en tirèrent du fang qu’ils fucerent. Ces cérémonies
furent à peine achevées, que celuiqui prefi-
doit à cotte folemnité renverlà par terre Mitridate.
On le chargea de fers à la vue de fa femme qu’on
traînoit fur un char après lui. Rkadumijlt, parjure &
dénaturé , ordonna de les étouffer dans des couvertures.
Il choifit ce genre de fupplice, pour ne pas
violer la foi du ferment qu’il avoir fait de ne jamais
employer le fer & le poifon : leurs enfans furent
é p rg é s , quelques jours après, pour les punir d’avoir
pleuré leur mort. Il ne refta pas long-tems poffeffeiit
M M nwn
i(" f fl.