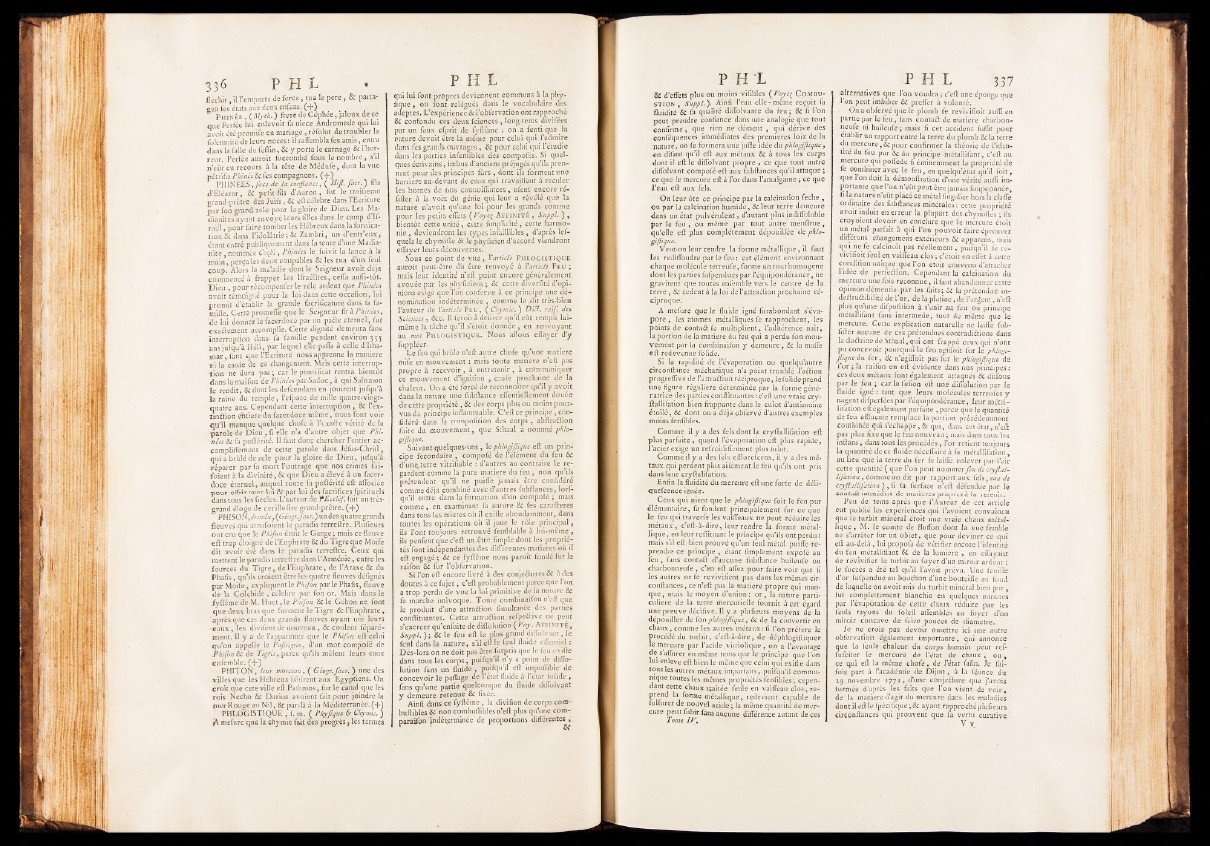
3 P H L
f t
N-1 1-^.il i 1; ;! : i' î I lis llï t’ü
i, (■
f ii '
I n
î( '
Èn
fl Vil
U
' ■ -f'iy 1
ra
flcchir, 11 l'emporta de force , tua le pcrc , & partapea
les états aux deux cnfans. (-P) _
Pki n ée , fi'credeCéphoe,jaloux dece
que Perfée lui eulevoit fa niece Andromède qui lui
avoit été pronnfe en mariage , réloliit de troubler la
fülemnitc de leurs noces: ilraflcmblafes amis, entra
dans la falle dufeftin, 6c y portale carnage & l'horreur.
Perfée auroit fuccombé lous le nombre, s'il
n’eùt eu recours à la tête de Médufe, dont la vue
pétrifia Phince & lés compagnons, (-f )
p u în é e s , /Inre de la confiance, ( Hfi. facr.') fils
d'Eléaznr, petit-fils d’Aaron , fut le troilieine
orand-pretre des Juifs, & cil célébré dans l’Ecriture
par fon grand zele pour la gloire de Dieu. Les Ma-
dianites ayant envoyé leurs filles dans le camp d If-
i-acl, pour faire tomber les Hébreux dans la fornication
& dans l’idolâtrie Zambri, un d’entr’eux,
étant entré publiquement dmis la tente d’une Madia-
jiite , nommée Cofic, Phuiees le fuivit la lance a la
main, perça les deux coupables & les tua dun feul
coup. Alors la maladie dont le Seigneur avoit déjà
commencé à frapper les Ifraclites, cefTa aniTi-tôt.
Dieu , pour rccompcnfer le zele ardent que Phinées
avoir témoigné pour la loi dans cette occafion, lui
promit d'établir la grande facrilicature dans fa famille.
Cette promeffe que le Seigneur fit â Phlnécs,
de lui donner lefacerdoce par un paéle éternel, fur
exadement accomplie. Cette dignité demeura fans
interruption dans fa famille pendant environ 335
snsjufqu’à Héli, par lequel elle paffa à celle d’Itlia-
mar, fans que rÈcrliure nous apprenne la maniéré
r i la caufe de ce changement. Mais cette imemip-
îlon ne dura pas; car le ponilficat rentra bientôt
dans la maifoii de Phinées parSaJoc , à qui Salomon
le rendit, & dont les defeendans en jouirent jufqu’à
la ruine du temple , l’efpace de mille quatre-vlngt-
quatre ans. Cependant cette interruption, & l’ex-
tinfHon entière du facerdoce même, nous font voir
qu’il manque quelque chofe à l’exaéle vérité de la
parole de Dieu , fi elle n’a d’autre objet que Phinées
fa poflcrité. II faut donc chercher l’entier ac-
complilfemcnt de cette parole dans Jéfus-Chrifi,
qui a bridé de zele pour la gloire de Dieu, jufqy’à
réparer par fa mort l’outrage que nos crimes fai-
foient il la divinité, que Dieu a élevé à un facerdoce
éternel, auquel toute fa poftérité ed aiïbciée
pour offrir avec lui ôc par lui des facrifices fplrituels
dans tous les fiecles. L’auteur de YEccléf. fait un très-
grand éloge de cet illuftre grand-prêtre, (-f)
PHJSON, étendu,(Géogr. J ncr.)i\n des quatre grands
fleuves qui arrofoient le paradis terreftre. Plufieurs
ont cru que le Phifon étoit le Gange ; mais ce fleuve
eff trop éloigné de l’Euphrate & du Tigre que Mo'ife
dit avoir été dans le paradis terreftre. Ceux qui
mettent le paradis terreftre dans l’Arménie, entre les
fources du Tigre, de l’Euphrate, de l’Araxe & du
Phalis, qu’ils croient être les quatre fleuves défignés
par Moife, expliquentle Phifon parle Phalis, fleuve
de la Colchide, célébré par fon or. Mais dans le
fyftcme de M. Huet, le Phifon & le Géhon ne font
que deux bras que forment le Tigre 6c l’Euphrate ,
après que ces deux grands fleuves ayant uni leurs
eaux, les divifent de nouveau , 6c coulent féparé-
ment. Il y a de l’apparence que le Phifon eft celui
qu’on appelle le Pafafris, d’un mot compofé de
Phfon ic de Tigris, parce qu’ils mêlent leurs eaux
enfemble. (+ )
PHITON, leur morceau, ( Géogr.facr. ) une des
villes que les Hébreux bâtirent aux Egyptiens. On
croit que cote ville eft Pathmos, fur le canal que les
rois Necho 6c Darius avoient fait pour joindre la
mer Rouge au Nil, 6c par-là à la Méditerranée, (-j-)
PHLOGISTIQUE , f. m. ( Phyfique &■ Chymie. )
A mefure que la chymie fait des progrès, les termes
P H L
qui lui font propres deviennent communs à la phy-
fique, ou font relégués dans le vocabulaire des
adeptes. L’expérience ^Tobfervation ont rapproché
6c confondu ces deux fciences , long-tems divifées
par un faux efprit de fyftcme : on a fenti que la
nature dévoie être la même pour celui qui l’admire
dans fes grands ouvrages , & pour celui qui l’étudie
dans les parties infenliblcs des compolés. Si quelques
écrivains, imbus d’anciens préjugés qu’ils prennent
pour des principes fûrs , dont ils forment une
barrière au-devant de ceux qui travaillent à reculer
les bornes de nos connoiflances, ofent encore ré-
fifter à la voix du génie qui leur a révélé que la
nature n’avoit qu’une loi pour les grands comme
pour les petits effets {^Eoyei A f f in it é , Suppl. ) ,
bientôt cette unité, celte fim])licité , cette harmonie
, deviendront les types infaillibles , d’après lef-
quels le chymifte S: le phyficicn d’accord viendront
eft'ayer leurs decouvertes.
Sous ce point de vue , Varticle P m l o g i s t i q u e
auroit peut-être dû être renvoyé à Ÿariide F eu ;
mais leur identité n’ eft point encore généralement
avouée par les ohyficiens ; 6c cette diverfité d’opinions
exige que l’on conferve à ce principe une dénomination
indéterminée , comme le dit très-bien
l’auteur de Vartule F e u , (^Chymie,') Dicf, r.ùf des
Sciences, &c. 11 lerolt à defirer qu’il eût rempli lui-
même la tâche qu’il s’étoir donnée , en renvoyant
au mot PHLOGISTIQU E. Nous alloiis eft'ayer d’y
fupplécr-
Le feu qui brûle n’eft autre chofe qu’une matière
mife en mouvement : mais toute matière n’efi pas
propre à recevoir , à entretenir , à communiquer
ce mouvement d’ignltion , caule prochaine de la
chaleur. On a été forcé de reconnoitre qu’il y avoit
dans la nature une fubftance effentiellement douée
de cette propriété , & des corps plus ou moins pourvus
dé principe inflammable. C’eft ce prlncijje, cen-
ftdérc dans la compolition des corps , abftraéHon
faite du mouvement, que Sthaal a nommé phlo-
gifiique.
Suivant quelques-uns , \.q phlogifliqiu eft un principe
fecondaire , compofé de l’eiément du feu ôi
d’une terre vltrifiable : d’autres au contraire le regardent
comme la pure matière du feu , non qu’ils
prétendent qu’il ne piiift'e jamais être confidéré
comme déjà combiné avec d’autres fubftances, lorf-
qu’il entre dans la formation d’un compofé ; mais
comme, en examinant fa nature & fes caraOeres
dans tous les mixtes où U exlfte abondamment, dans
toutes les opérations où il joue le rôle principal,
ils l’ont toujours retrouvé femblable à hn-même ,
ils penfent que c’eft un être fimple dont les propriétés
font indépendantes des ditîvrcntes matières où il
eft engagé; & ce fyftême nous paroît fondé fur la
raifon 6>t fur l’obfervation.
Si l’on eft encore livré à des conjeélures & à des
doutes à ce fujet, c’eft probablement parce que l’on
a trop perdu de vue la loi primitive de la naiurc &
fa marche univoque. Toute combinaifon n eft que
le produit d’une attraélion ftmultanée des parties
conftituantes. Cette attraéHon relpeifive ne peut
s’exercer qu’enfuite de dlflolution ( Poy. A f f i n i t é ,
Suppl.)-, 6c le feu eft le plus grand dilToIvanr, le
feul dans la nature, s’il eft le feul fluide eft'emiel :
Dcs-lors on ne doit pas être furpris que le feu '■ xille
dans tous les corps, puifqu’il n’y a point de diffo-
lution fans un fluide, puilqu’il eft impolfibie de
concevoir le paftage de 1 état fluide a 1 état lolide ,
fans qu’une partie quelconque du fluide dilTolvant
y demeure retenue & fixée.
Ainfi dans ce fyftcme , la divifion de corps com-
buftibles non combuftibles n’eft plus qu’une com-
paraifon indéterminée de proportions différentes ,
P H L
& d’effets plus ou moins vifibles (Poyei C o m b u s
t io n , Suppl.). Ainfi l’eau elle-même reçoit fa
fluidité & fa qualité diffolvante du feu; & fi l’on
peut prendre confiance dans une analogie que tout
confirme , que rien ne dément , qui dérive des
conféquences immédiates des premieres loix de la
nature, on fe formera une jufte idée duphlogifUqiie,
en difant qu’il eft aux métaux 6c à tous les corps
dont il eft le diffolvant propre , ce que tout autre
diffolvant compofé eft aux fubftances qu’il attaque ;
ce que le mercure elt à l’or dans l’amalgame ; ce que
l ’eau eft aux fels.
On leur ôte ce principe par la calcination feche ,
ou par la calcination humide, 6c leur terre demeure
dans un état pulvérulent, d’autant plus indiffoluble
par le feu , ou même par tout autre menftrue,
qu’elle eft plus complètement dépouillée de phlo-
gifîique.
Veut-on leur rendre la forme métallique , il faut
les rediffoudre parle feu ; cet clément environnant
chaque molécule terreufe,forme un tour homogène
dont les parties fufpendues par l’équipondérance, ne
gravitent que toutes enfemble vers le centre de la
terre , 6c cedent à la loi de l’attradion prochaine réciproque.
A mefure que le fluide igné furabondant s’évapore
, les atomes métalliques fe rapprochent, les
points de contad fe multiplient, l’adhérence naît,
la portion de la matière du feu qui a perdu Ion mouvement
par la combinaifon y demeure , 6c la malle
eft redevenue folide.
Si la rapidité de l’évaporation ou qiieîqu’autre
circonrtance mcchanique n’a point trouble l’adion
progreftive de l’attradion réciproque, le folide prend
une figure régulière déienninéc par la forme génératrice
des parties conftituantes : c’eft une vraie cry-
ftallilation bien frappante dans le culot d’antimoine
ctoilé, 6c dont on a déjà obièrvé d’autres exemples
moins fenftbles.
Comme il y a des fels dont la cryftallifation eft
plus parfaite , quand l’évaporation eft plus rapide,
l ’acier exige un refroiJifl'ement plus l'ubit.
Comme i! y a des Icls efflorelcens, il y a des métaux
qui perdent plus ailcment le feu qu’ils ont pris
dans leur cryftalil'ation.
Enfin la fluidité du mercure eft une forte de dcli-
quefcence ignée.
Ceux qui nient que le phlogifilquc fo!t le feu pur
élémentaire, fe fondent principalement fur ce que
le feu qui traverfe les vaiffeaux ne peut réduire les
métaux, c’eft-à-dire, leur rendre la forme métallique,
en leur reftituani le principe qu’ils ont perdu:
mais s’il eft bien prouvé qu’un feul métal piiiffc reprendre
ce principe , éiant ftinplement expofé au
feu, tans contaél d’aucune fubftance huileufe ou
charbonneufe , c’en eft affez pour faire voir que fi
les autres ne fe revivifient pas dans les mêmes cir-
conftances, ce n’eft pas la matière propre qui manque,
mais le moyen d’union: o r , la nature particulière
de la terre mercurielle fournit à cet égard
une preuve dccifive. Il y a plufieurs moyens de la
dépouiller de fon phlogijUque, 6c de la convertir en
chaux, comme les autres métaux: fl l’on préfère le
procédé du tiirbit, c’eft-à-dire, de déphîogiftiqiier
le mercure par l'acide vitrioliqiie , on a l’avantage
de s’affurer en même tems que le principe que l’on
lui enleve eft bien le même que celui qui exille dans
tous les autres métaux impart'aits, puifqu’jl communique
toutes les mêmes propriétés l'enfibles; cependant
cette chaux uaitee feule en vailfeau clos, re-
forme métallique, redevient capable de
lulfurer de nouvel acide ; la même quantité de mercure
peut fubir fans aucune dift'érence autant de ces
Tonie IK»
P H L 3 3 7
afternatîves que l’on voudra ; c’eft une éponge que
l’on peut imbiber 6c pieffcr à volonté.
Ona obfervé que le plomb fe revivifioit aiifti en
partie par le feu, fans contact de matière charbon-
nculè ni huileufe; mais fi cet accident fuftit pour
établir un rapport entre la terre du plomb 6c la terre
du mercure , 6c pour confirmer la théorie de l’identité
du feu pur Ôc du principe metaliifant, c’eft au
mercure qui poüede fi éminemment la propriété de
le combiner avec le feu, en quelqu’ctar qu’il foit,
que 1 on doit la dcmonftratlon d’une vérité aulFi importante
que l’on n’eût peut-être jamais foupçonnée.
Il la nature n’eût placé ce métal fmgulicr hors la clalTe
oïdinaire des lubftanccs minérales : cette propriété
avoit induit en erreur la plupart dos chymiiles ; ils
croyoient devoir en conclure que le mercure étoit
un métal partait à qui l’on pouvoir taire éprouver
différens changemens extérieurs 6c apparens, mais
qui ne le calcinoit pas rceliemem, puifqu’il le ve-
vjvinou feul en vaifléau clos ; c’etoiten effet à cette
condition unique que l’on étoit convenu d’atiacher
lidée de perfechon. Cependant la catcinailon du
mercure une fois reconnue, il faut abandonner cette
opinion démentie par les faits; 6c la prétendue m-
deftrudtibilité de l’or, de la platine , de l’argent, n’efl:
plus qii une dilpofition à s’unir au feu ou principe
métalÜfanr fans intermède, tout de même que le
mercure. Cette explication nauirelle ne laiffe fiib-
fifter aucune de cos prétendues contradidtions dans
la dodtnr.e de Sthaal, qui ont frappé ceux qui n’ont
pu concevoir pourquoi le feu agiiîbit fur le phlofi-
jîique du fer, 6c n’agiiToit pas fur le phlogifiique 'de
1 or ; la raifon en eft évidente dans nos principes :
ces deux métaux font également attaqués 6c diifous
par le feu ; car la liifton eft une dilîblution par le
fluide igné : tant que leurs molécules terreul'es y
nagent dilpeiToes par l’équipondérance, leur métal-
htauon tftégHlemeni parfaite , parce que la quantité
de teu affluence remplace la portion précédemment
combinée qui s’échappe, 8c qui, dans cet état, n’eft;
pas plus fixe que le feu nouveau ; mais dans tous les
inftans, dans tous les procédés, l’or retient toujours
la quantité de ce fluide néceftaire à fa mccalllfation ,
au lieu que la terre du fer fe laiffe enlever par l’air
cette quantité ( que l’on peut nommer feu de ayfl,d~
lifation ,com\we: on dit par rapport aux l'els, ea.v t/i
cryfialüjution) ,ï\ (a furface n’eft défendue par le
comadt immédiat de matières propres à la retenir.
Peu de teins après que i’Auteiir de cet article
eut publié les expériences qui l’avoient convaincu
que le turbit minéral étoit une vraie chaux métallique
, M. le comte de Biiffon dont la vue femble
ne s’arrêter lur un objet, que pour deviner ce qui
eft au-delà , lui propofa de vérifier encore l’identité
du teu mctalliftant 6c de la lumière , en eft'ayatkC
de revivifier le turbit au foyer d’un miroir ardent ;
le lucccs a été tel qu’il l’avoit prévu. Une feuille
d’or fufpendue au bouchon d’une bouteille au fond
de laquelle on avoit mis du turbit minerai bien pur,
fut compleitcment blanchie en quelques minutes
par l’évaporation de cette chaux réduite par les
feuls rayons du ioleil affemblés au foyer d'im
miroir concave de Icize pouces de diamètre.
Je ne crois pas devoir omettre ici une antre
obfervation également im]>ortanre, qui annonce
que la leiile chaleur du corps humain peut ref-
fufeiter le mercure de l’état de chaux , ou ,
ce qui eft la même chofe, de letar falin. Je fai-
fois part à l’académie de Dijon , à la Icance du
19 novembre 17 7 1 , d’une conjediire c[uc j’avois
formée d’après les faits que l’on vient de voir,
de la manière d’agir du mercure dans les maladies
dont il eft le fpécifique ; 6c ayant rapproché plufieurs
circonftances qui prouvent que fa vertu curative
V y
i