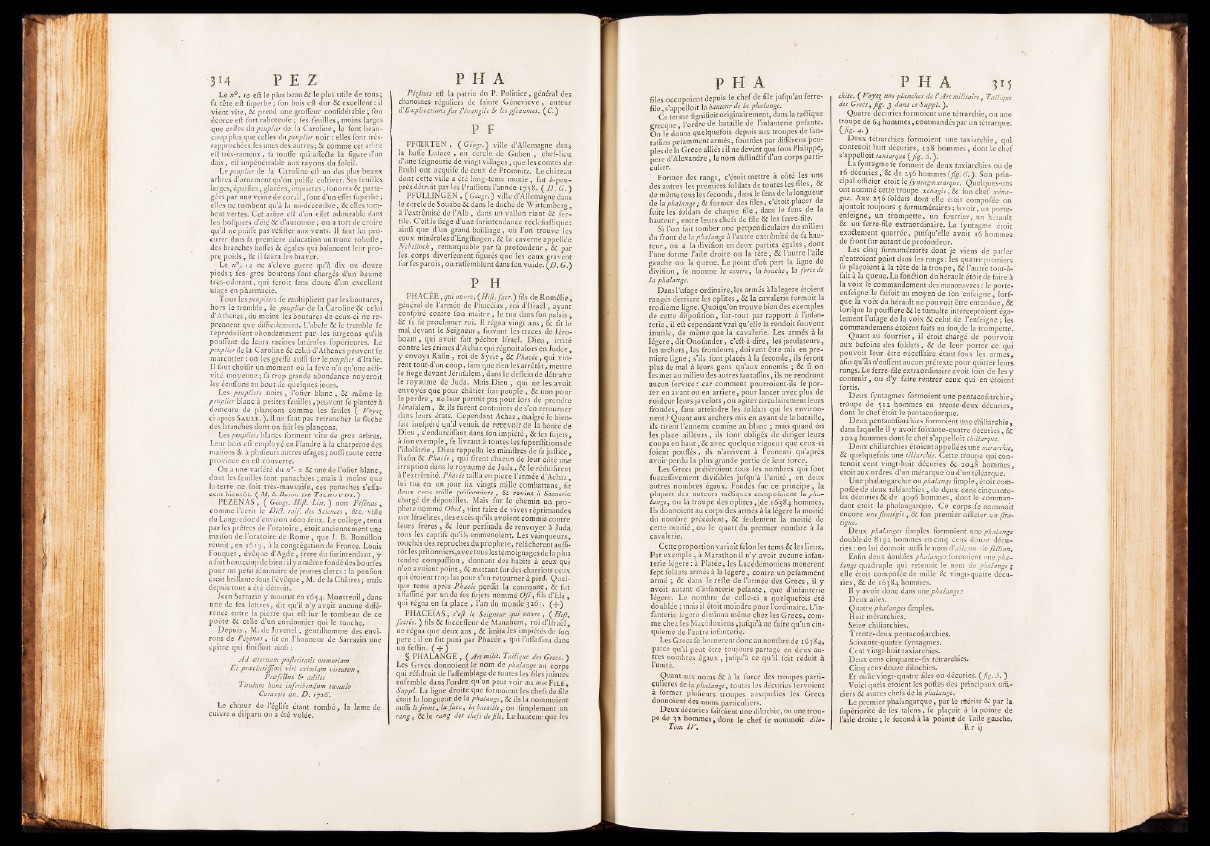
3 ^ 4 P E Z
if
I., ml
Le to ell: le plus beau & le plus utile de tous ;
fa tete cil l'iipcrbe i Ton bois ell dur excellent : il
vient vite, ôc prend une grolTeur confidérable ; l'on
écorce ell fort raboteufe ; fes feuilles, moins larges
que celles du p a ip lu r de la Caroline, le font beaucoup
plus que celles du p iu p l'u r noir : elles font très-
rappiochées les unes des autres ;& comme cet arbre
elt très-rameux , fa toulî'e qui aOééle la figure d’un
dais , elt impénétrable aux rayons du foleil.
Le peuplier de la Caroline ell un des plus beaux
arbres d’ornement qu’on puilfe cultiver. Ses feuilles
larges, épailîés, glacées, inquiétés , fonores Sc partagées
par une veine de corail, Ibnr d\in effet fuperbe ;
elles ne tombent qu’à la mi-décembre, & elles tombent
vertes. Cet arbre e(t d’un effet admirable dans
les bofquets d’été &c d'automne ; on a tort de croire
qu'il ne puifié pas réliller aux vents. U faut lui procurer
dans fa premiere éducation un tronc robulle,
des branches baffes & égales qui balancent leur propre
poids, <k. il faura les braver.
Le /2 ne s’cleve guere qu’à dix ou douze
pieds ; fes gros boutons font chargés d’un baume
très-odorant, qui feroit fans doute d’un excellent
ufage en pharmacie.
Tous les peupliers fe multiplient par les boutures,
hors le tremble , le peuplier de la Caroline & celui
d’Athènes, du moins les boutures de ceux-ci ne reprennent
que difliciiemenr. L'abele & le tremble fe
reproduilent abondantment par les furgeons qu’ils
poufi'ent de leurs racines latérales fuperienres. Le
peuplier la Caroline de celui d’ Athènes peuvent fe
marcotter : on les greffe aulfi fur le peuplier d'Italie.
11 faut choifir un moment où la feve n’a qu’une activité
moyenne; fa trop grande abondance noyeroit
les ceuffons au bout de quelques jours.
Les peupliers noirs , l’ofier blanc , & même le
peuplier blanc à petites feuilles, peuvent fe planter à
demeure de plançons comme tes faules ( Voyei^
ci après Saule. ). Il ne faut pas retrancher la fléché
des branches dont on fait les plançons.
hesp eu p lie rs h h n e s forntent vite de gros arbres.
Leur bois eff employé en Flandre h la charpente des
mailons & à plulieurs autres ufages; auffltoute cette
province en ell couverte.
On a une variété du n°- x Sc une de l’ofier blanc,
dont les feuilles font panachées ; mais à moins que
la terre ne foit îrès-mauvaife, ces panaches s’effacent
bientôt. ( M . le Baron d e T s c h o u d i . )
PÉZÈNAS , ( Géogr. H iß . L ilt. ) non Péfénas ,
comme l’écrit le H ic l. raif. des Sciences , &c. ville
du Languedoc d’environ 1600 feux. Le college, tenu
par les prêtres de l’oratoire, étoit anciennement une
maifon de l’oratoire de Rome , que J. B. Bomillon
réunit, en 1Ö iç), à la congrégation de France. Louis
Fouquet, évêque d’Agde , frere du furintendant, y
a fait beaucoup de bien : il y a même fondé des bourfes
pour un petit Icminaire de jeunes clercs : la penfion
étoit brillante fous l’évêque , M. de la Châtres; mais
depuis tout a été détruit,
Jean Sarrazin y mourut en 1654. Montreuil, dans
une de fes lettres, dit qu’il n’y avoit aucune différence
entre la pierre qui eff fur le tombeau de ce
poete Sl celle d’un cordonnier qui le touche.
Depuis , M. de Juvenel, gentilhomme des environs
de P ß i ß i a s fit en l’honneur de Sarrazin une
cpître qui finilToit ainfi :
A d cuernam pojleritaùs rnemoriam
E l ptiBclarißimi viri exirniam virtutvn ,
'PrsfeHus & adiles
T iiulum hune inferihendum tumulo
Curavete an. D . iy x 6 .
Le choeur de l’églife étant tombe, la lame de
cuivre a difparu ou a été volée.
P H A
Péfénas eff la patrie du P. Polinief, général des
chanoines réguliers de faiute Geneviève , auteur
(E E xp lica lion s fu r Cèvangde G les pfeaunies. (C.)
P F
PFGERTEH , {G è o g r .') ville d’Allemagne dans
la baffe Lufiice , au cercle de Guben , chef-lieu
d’une feigneurie de vingt villages, que les comtes de
Bruhl ont acqulfe de ceux de Promnitz. Le château
dont cette ville a été long-tcms munie , fut à-peu-
près détruit par les Prulfiens l’année 1758. ( D G ' )
PFULLINGEN , ( GVu<-r. ) ville d’Allemagne dans
le cercle de Souabe & dans le duché de Wirtembero ,
à l’extrémité de l’Alb , dans un vallon riant & fertile.
C’elHefiege d’une furintendance eccléfiaffique:
ainfi que d’un grand bailliage , où l’on trouve les
eaux minéralesd’Engftingen,& 1.1 caverne appellée
N eb d lo ch , remarquable par fa profondeur , 6e par
les corps diverlemeni figurés que les eaux gravent
lur les parois, ou raff'embientdansfon vuide. { D . G.)
P H
PHACÈE, çKi ouvre, (^H ifl.ficr.') fils de Romélie,
général de i’armee de Phacéias, roi d’Iftaël, ayant
confpiré contre fon maître, le tua dans fon palais,
& fe fit proclamer roi. II régna vingt ans , & fit le
mal devant le Seigneur , fuivant les traces de Jéroboam
, qui avoir fait pécher Ifraël. Dieu , irrité
contre lescrimesd’Achazquirégnoitalors en Judée,
y envoya Rafin , roi de Syrie , & Phacée , qui vinrent
tout-d’un-coup, fans que rien les arrêtât, mettre
le fiege devant Jérufalem , dans le defléin de détruffe
le royaume de Juda. Mais Dieu , qui ne les avoit
envoyés que pour châtier fon peuple , & non pour
le perdre , ne leur permit pas pour lors de prendre
Jérufalem, &l ils furent contraints de s’en retourner
dans leurs états. Cependant Achaz , malgré le bienfait
inefpéré qu’il venoit de recevoir de la bonté de
Dieu , s’endiirciffant dans fon impiété, & fes fujets,
à fon exemple, fe livrant à toutes les fiiperftitions de
l’idolâtrie , Dieu rappella les miniffres de fa juftice,
Rafin <Sc Phacée , qui firent chacun de leur côté une
irruption dans le royaume de Juda, êc le réduifirent
à l’extrémité. Phacée tailla en pièce l’armée d’Achaz,
lui tua en un jour fix vingts mille combattans, fit
deux cens mille prifonniers , & revint à Samarie
chargé de dépouilles. Mais fur le chemin un prophète
nommé O b ed , vint faire de vives réprimandes
aux Ifraélit es, des excès qu’ils avoient commis contre
leurs freres , & leur perfuada de renvoyer à Juda
tous les captifs qu’ils emmenoient. Les vainqueurs,
touchés des reproches du prophète, relâcherentauffi-
tüt les prifonniers,avectous les témoignages de la plus
tendre compaffion , donnant des habits à ceux qui
n’en avoient point, Gc mettant fur des charriots ceux
qui étoienttrop las pour s’en retourner à pied. Quelque
tems après Phacée perdit la couronne, & fut
affalTmc par un de fes fujets nommé O f é , fils d’Eia ,
qui régna en fa place , l’an du monde 326,. ( -f)
PHACEIAS, c’^/2 U Seigneur qui o u v r e , {_HiJ},
f ie r t é . ) fils & fucceffeur de Manahem, roi d’KVacl,
ne régna que deux ans , & imita les impiétés de fon
pere : il en fut puni par Phacée , qui l’affalfina dans
un feftin. ( + )
§ PFIALANGE , (^A n mille. Taclique des Grecs. )
Les Grecs donnoient le nom de phalange au corps
qui réfultoit de l’affemblage de toutes les files jointes
enfemble dans l’ordre qu’on peut voir au moi File ,
S uppl. La ligne droite que formoient les chefs défilé
étoit la longueur de la phalange, & ils la nommoient
lé f r o n t , la f i iC i , la b a ta ilU , ou fimplement un
ra n g , & le rang des chefs de f ile , La hauteur que les
P H A
files occupolent depuis le chef de file jufqu’au ferre-
file, s’appclloit la hauteur de la phalange.
Ce terme fignifioitoriginairement, dans la taéfique
grecque, l’ordre de bataille de l’infanterie pefance.
On le donna quelquefois depuis aux troupes de fan-
talTms pefamment armés, fournies par dift'érens peuples
de la Grece alliés : il ne devint que fous Philippe,
pere d’Alexandre, le nom diffinûifd’un corps particulier.
Former des rangs, c’étoit mettre à côte les uns
des autres les premiers foldats de toutes les files, &
de même tous les féconds, dans le fens de la longueur
de la phalange ; & former des files, c’étoit placer de
fuite les foldats de chaque file , dans le fens de la
hauteur , entre leurs chefs de file les _ferre-filev_
Si l’on fait tomber une perpendiculaire du milieu
du front de la phalange à l’autre extrémité de fa hauteur,
on a la divifion en deux parties égales, dont
l’une forme l’aile droite ou la tête, &C l’autre l’aile
gauche ou la queue. Le point d’où part la ligne de
divifion, fe nomme le centre, \d. bouche, la force de
la phalange.
Dans l’iifage ordinaire, les armés à la legere étolent
rangés derrière les oplites , & la cavalerie formoit la
troifieme ligne. Quoiqu’on trouve bien des exemples
de cette difpofition, fur-tout par rapport à l’infanterie
, il eff cependant vrai qu’elle la rendoit fouvent
inutile, de même que la cavalerie. Les armés à la
légère , dit Onofander, c’eff-à-dire, les jaculateurs,
les archers, les frondeurs, doivent être mis en premiere
ligne ; s’ils font placés à la fécondé, ils feront
plus de mal à leurs gens qu’aux ennemis ; & fi on
les met au milieu des autres fantaffms, ils ne rendront
aucun fervice : car comment pourroient-ils fe porter
en avant ou en arriéré, pour lancer avec plus de
Toideur leurs javelots , ou agiter clrculairementleurs
frondes, fans atteindre les foldats qui les environnent
? Quant aux archers mis en avant de la bataille,
ils tirent l’ennemi comme au blanc ; mais quand on
les place ailleurs, ils font obligés de diriger leurs
coups en haut, & avec quelque vigueur que ceux-ci
foient pouffés, ils n’arrivent à l’ennemi qu’après
avoir perdu la plus grande partie de leur force.
Les Grecs préféroient tous les nombres qui font
fucceffivement divifibles jufqu’à l’unité , en deux
autres nombres égaux. Fondés fur ce principe, la
plupart des auteurs taéfiques compofoient la p h a lange,
ou la troupe des oplites, [de 16384 hommes.
Ils donnoient au corps des armés à la légère la moitié
du nombre précédent, & feulement la moitié de
cette moitié, ou le quart du premier nombre à la
cavalerie.
Cette proportion varioit felon les tems & les lieux.
Par exemple , à Marathon il n’y avoit aucune infanterie
légère : à Platée, les Lacédémoniens menèrent
fept foldats armés à la légère , contre un pefamment
armé ; & dans le reffe de l’armée des Grecs , il y
avoit autant d’infanterie pefante, que d’infanterie
légère. Le nombre de ccllc-ci a quelquefois été
doublée ; mais il étoit moindre pour l'ordinaire. L’infanterie
légère diminua même chez les Gre cs, comme
chez les Macédoniens , jufqu’à ne faire qu’un cinquième
de l’autre infanterie.
LesGrecsfe boinerent donc au nombre de 16584,
parce qu’il peut être toujours partagé en deux autres
nombres égaux , jufqu’à ce qu’il foit réduit à
l’unité.
Quant aux noms & à la force des troupes particulières
de la phalange, toutes les déçu ries lervoient
à former pluffeurs troupes auxquelles les Grecs
donnoient des noms particuliers.
Deuxdccuries faifoient une dilochie,ou une troupe
de 31 hommes, dont le chef fe nommoit âilo -
Tom l E ,
P H A 3 1 5
chite. ( E o y e i nos planches de L 'A n m ilitair e , Tactique
des G r e c s , f ig . 3 dans ce S u p p l. ).
Quatre décuries formoient une tétrarchie, ou une
troupe de 64 hommes, commandés par un tétrarque.
{ f is -4-)
Deux tctrarchles formoient une taxiarchie, qui
contenoit huit decuries, 128 hommes, dont le chef
s’appelloit taxiarque (^fig. J . ).
Lafyntagmele tormojt de deux taxiarebies ou de
16 décuries, & de 256 hommes G .) . Son principal
officier etoit leJyntagmatarque. Quelques-uns
ont nommé cette troupe x én a g ie ,iU fon chef W/zæ-
gue. Aux 256 foldats dont elle étoit compofée on
ajoutoit toujours 5 furnuméraires : favoir, un porre-
enleigne, un trompette, un fourrier, un herault
& un ferre-file extraordinaire. La fyntagme étoit
exaâement quarrée, puifqu’elle avoit 16 hommes
de front fur autant de profondeur.
Les cinq furnumérairés dont Je viens de parler
n’entroient point dans les rangs : les quatre premiers
fe plaçoient à la tête de la troupe, & l’autre tout-à-
fait à la queue. La fonûion du hérault étoit de faire à
la voix le commandement des manoeuvres : le porte-
enfeigne le faifoir au moyen de fon enfeigne, lorf-
que la voix du hérault ne pouvoit être entendue, ôi
lorfque la poulfiere & le tumulte interceptoient également
l’ufage de la voix & celui de l’enfeigne ; les
commandemens étoient faits au fomde la trompette.
Quant au fourrier, il étoit chargé de pourvoir
aux befoins des foldats, & de leur porter ce qui
pouvoit leur être néceff'aire étant fous les armes,
afin qu’ils n’eufl'ent aucun prétexte pour quitter leurs
rangs. Le ferre-file extraordinaire avoit foin de les y
contenir, ou d’y faire rentrer ceux qui en étoient
fortis.
Deux fyntagmes formoient une pentacofiarchie,
troupe de 512 hommes en trente-deux décuries,
dont le chef étoit le pentacoffarque.
Deux pentacofiarchies formoient une chlliarchie,
dans laquelle il y avoit foixante-quatre décuries, 6c
1024 hommes dont le chef s’appelloit chlUarquc.
Deux chiliarchies étoicntappellées une mérarchie,
Sc quelquefois une téléarchie. Cette troupe qui contenoit
cent vingt-huit décuries Sc 2048 hommes,
étoit aux ordres d’un mérarque ou d'un téléarcjiie.
Une phalangarchie ou phalange fimple, étoit compofée
de deux téléarchies , de deux cens cinquante-
fix décuries & de 4096 hommes, dont le commandant
étoit le phalangarque. Ce corps fe nommoit
encore une fir a tég ie , Sc fon premier officier un fira-
tigue.
Deux phalanges fimples formoient une phalange
doublede 8192 hommes en cinq cens douze clécu-
ries : on lui donnoit auffi le nom à 'a ile ou de fe clion .
Enfin deux doubles formoient une y/itzquadruple
qui retenoit le nom de phalange y
elle étoit compofée de mille & vingt-quatre décuries,
& de 16384 hommes.
Il y avoit donc dans une phalange i
Deux ailes.
Quatre phalanges fimples.
Huit mérarchies.
Seize chiliarchies.
Trente-deux pentacofiarchies.
Soixante-quatre fyntagmes.
Cent vingt-huit taxiarebies.
Deux cens cinquante-fix tétrarchies.
Cinq cens douze dilochies.
Et mille vingt-quatre files ou décuries, { fig . S . )
Voici quels étoient les poffes des principaux officiers
Sc autres chefs de la phalange.
Le premier phalangarque, par le mérite Sc par la
fupériorité de fes taiens, fe plaçoit à la pointe de
l’aile droite *, le fécond à la point« de Faile gauche.
Rr ij