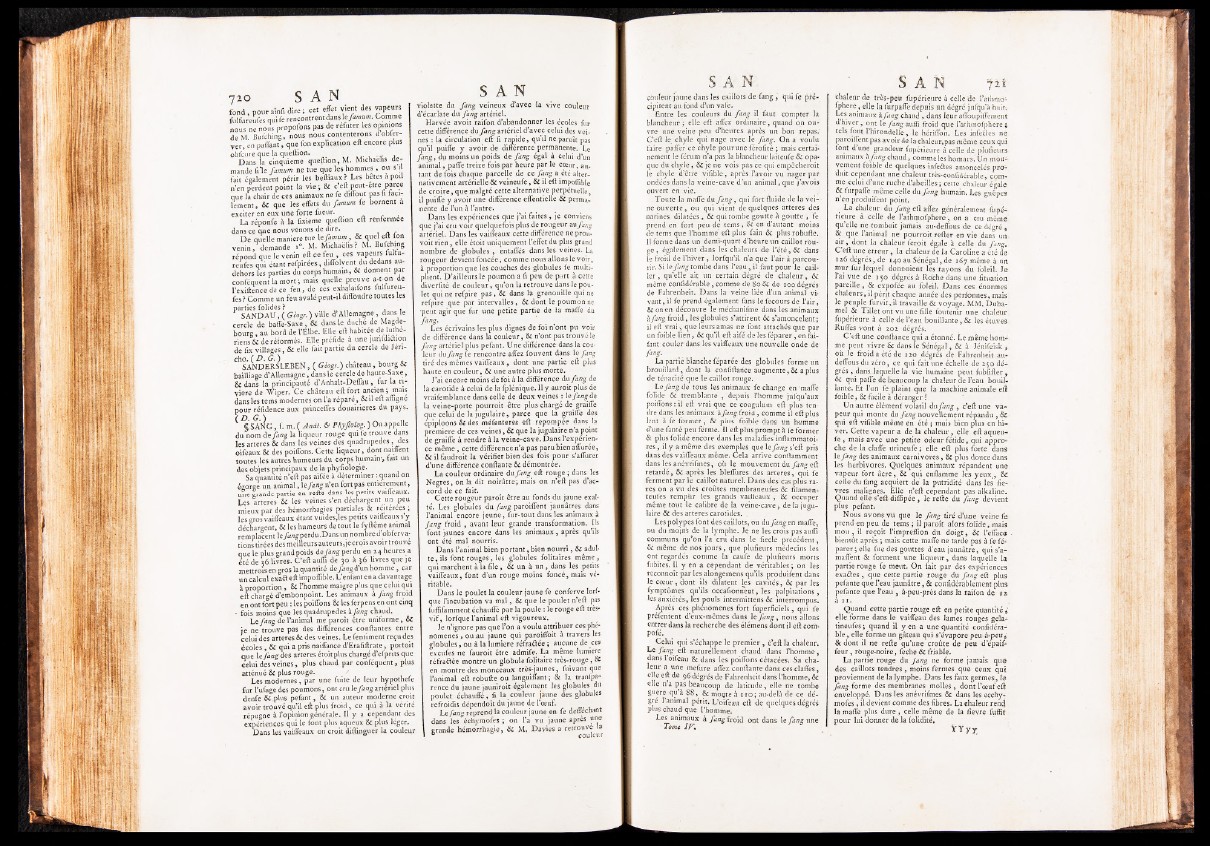
Il “
f. S|l tf I
i.'l.i'ili: ''
« ‘ tt ■<
•' 'f'ii!"
710 S A N fond, po.rn-.nfi dire; cet effet vient deî vapeur;
fulfureules qui fe rencontrenldansley«,»»:. Comme
nous ne notls propolbns pas de réfuter les op,nions
(leM liurdiing, nous nous contenterons d obier-
Ycr, en paHant, que l'on explication eft encore plus
oblcure que la quertion. _ ,
Dans la cinquième queftion,M. Michaelis demande
file furnum ne tue que les hommes , ou s 1
lait egalement périr les beftiaux? Les bêtes a poil
n’en perdent point la v ie ; & c’eft peut-être parce
que la chair de ces animaux ne fe diflout pas u facilement,
&C que les effets du famum fe bornent a
exciter en eux une forte fueur. ^
La réponfe à la fixieme queftion cft renfermee
dans ce que nous venons de dire. , n. r
De quelle manière tue U famum , & que eft fon
venin, demande i». M- Michaelis? M, Biifching
répond que le venin eft ce feu , ces vapeurs fultii-
re'ifes qui étant refplrées, diffolyeot du dedans au-
dehors les parties du corps humain, & donnent par
confcquenrlamort; mais quelle preuve a-t-qn de
l'exillence de ce feu , de ces exhataifons fultureu-
fes? Comme un feu avalé peut-il diffoudre toutes les
parties folides ? , 1 1
SANDAU,(Cét)gr.)ville d’Allemagne, dans le
cercle de baffe-Saxe, & dans le duché de Magde-
bourg , au bord de l’Elbe. Elle eft habuce de luthériens
de rétormés. Elle prcftde à une )un!diaioa
de ftx villages, & elle fait partie du cercle de Jéricho.
{ D . G . ) V , A L c
SANDERSLEBEN , ( G io g r .) chateau , bourg &
bailliage d’Allemagne , dans le cercle de haute-Saxe,
& dans la principauté d’Anhalt-Deffau , fur la riviere
de Wiper. Ce château eft fort ancien; mais
dans les tems modernes on l’a réparé, & ile f t aftîgné
pour réftdence aux princeffes douairières du pays.
iD .G A ^ n
§ SANG, f. m. ( A n a t. & P hy fiolog. ) On appelle
du nom de fa n g la liqueur rouge qui le trouve dans
les arteres & dans les veines des quadrupèdes, des
oifeaux & des poiffons. Cette liqueur, dont naiffent
toutes les autres humeurs du corps humain-, fait un
des objets principaux de la phyftologie.
Sa quantité n’eft pas aifee à déterminer : quand on
éc’or^’e un animal, le fa n g n’en fort pas entièrement,
une grande partie en refte dans les petits vaiffeaux.
Les arteres & les veines s’en déchargent un peu
mieux par des hémorrhagies partiales 6l réitérées ;
les grosvaiftéaiix étant vuides,les petits vailTeauxs’y
décharcent, & les humeurs de tout le fyftcme animal
remplacent leyi-zngperdu.Dans un nombred’qbferva-
tions tirées des meilleurs auteurs,je crois avoir trouvé
que le plus grand poids de/à/jg perdu en 14 heures a
été de 36 livres. C ’eft auflî de 30 à 36 livres que je
mettrois en gros la quantité deyà/:g d’un homme , car
un calcul exaÛ eft impoffible. L’enfant en a davantage
à proportion , &C l’homme maigre p’iis que celui qui
eft chargé d’embonpoint. Les animaux à fa n g froid
en ont fort peu : les poiffons & les ferpens en ont cinq
' fois moins que les quadrupèdes à fa n g chaud.
Le/<2/2g de l’animal me paroît être uniforme, &
Je ne trouve pas des différences conftantes entre
celui des arteres & des veines. Le fentlment reçu des
écoles , & qui a pris naiffance d’Erafiftrate, portoit
que U fa n g des arteres étolt plus chargé d’efprits que
celui des veines, plus chaud par conféquent, plus
atténué & plus rouge.
Les modernes, par une fuite de leur hypothefe
fur l’ufage des poumons, ont cru \ efan g artériel plus
denfe & plus pefant, 6i un auteur moderne croit
avoir trouvé qu’il eft plus froid , ce qui à la vérité
répugne à l’opinion générale. Il y a cependant des
expériences qui le font plus aqueux & plus léger.
Dans les vaiffeaux on croit diftinguer la couleur
SAN
violette du fa n g veineux d’avec la vive couleur
d’écarlate du /à/jg artériel.
Harvée avoir raifon d’abandonner les écoles fur
cette différence d u a r t é r i e l d’avec celui des veines
: la circulation eft fi rapide, qu’il ne paroît pas
qu'il puiffe y avoir de différence permanente. Le
fa n g , du moins un poids de fa n g égal à celui d’im
animal, paffe treize fois par heure par le coeur, autant
de fois chaque parcelle de ce fa n g a été alternativement
artérielle & veineufe, & il eft impoinblc
de croire, que malgré cette alternative pcrpcuietlo,
il puiffe y avoir une différence efléntielle & permanente
de l’un k l’autre.
Dans les expériences que j’ai faites , je conviens
que j’ai cru voir quelquefois plus de rougeur au
artériel. Dans les vaiffeaux cette différence ne prou-
volt rien , elle étoit uniquement l’effet du plus grand
nombre de globules , entaffés dans les veines. La
rougeur devient foncée, comme nous allons le voir,
à proportion que les couches des globules le multiplient.
D ’ailleurs le poumon a fi peu de p irt k cette
diverfité de couleur, qu’on la retrouve dans le poulet
qui ne refpiie pas, & dans la grenouille qui ne
refpire que par intervalles, dont le poumon ne
•peut agir que fur une petite partie de la mafle du
fa n g .
Les écrivains les plus dignes de foi n’ont pu voir
de différence dans la couleur, & n’ont pas trouvé le
f i n g artériel plus pefant. Une différence dans la couleur
du fa n g (e rencontre affez fouvent dans le fm g
tiré des mêmes vaiffeaux , dont une partie eft plus
haute en couleur, & une antre plus morte.
j ’ai encore moins de foi à la différence du fa n g de
la carotide à celui de la fplénique. Il y auroit plus de
vraifemblance dans celle de deux veines : le fa n g de
la veine-porte pourroit être plus charge de graiffe
que celui de la jugulaire, parce que la graille des
épiploons & des méfenteres eft repompée dans la
premiere de ces veines, que la jugulaire n’a point
de graiffe à rendre à la veine-cave. Dans l’cxpérlen-
ce même , cette différence n’a pas paru bien allurée,
& il faudroit la vérifier bien des fois pour s’affurer
d’une différence confiante & démontrée.
La couleur ordinaire <\\\fing eft rouge ; dans les
Negres, on la dit noirâtre; mais on n’eft pas d’accord
de ce fait.
Cette rougeur paroît être au fonds du jaune exalté.
Les globules du f i n g paroiffent jaunâtres dans
l’animal encore jeune, fur-tout dans les animaux à
Ja n g froid , avant leur grande transformation. Ils
font Jaunes encore dans les animaux, après qu’ils
ont été mal nourris.
Dans l’animal bien portant, bien nourri, & adulte
, ils font rouges , les globules folitaires meme,
qui marchent à la file , & un à un, dans les petits
vaiffeaux, font d’un rouge moins foncé, mais véritable.
Dans le poulet la couleur jaune fe conferve lorf-
que l’incubation va mal, & que le poulet n’eft pas
fuffifamment échauffé par la poule : le rouge eft très-
v if, lorfque l’animal eft vigoureux.
Je n’ignore pas que l’on a voulu attribuer ces phénomènes,
ou au jaune qui paroiffoit à travers les
globules, ou à la lumière réfraélée ; aucune de ces
exeufes ne fauroit être admife. La même lumière
réfraftée montre un globule folitaire très-rouge , ^
en montre des monceaux très-jaunes, fulvant que
l’animal eft robufte ou languiffant; & la tranlpa-
rence du jaune Jauniroit également les globules du
poulet échauffé, fi la couleur jaune des globules
refroidis dépendoit du jaune de 1 oeuf. ^
Le fang reprend la couleur jaune en fe deftechant
dans les échymofes ; on l’a vu jaune après une
grande hémorrhagie, & M. Davies a retrouve la
° coulcv'.r
S A N couleur jaune dans les caillots de fang , qui fe précipitent
au fond d’un vale.
Entre les couleurs du fa n g il faut compter la
blancheur; elle eft affez ordinaire, quand on ouvre
une veine peu d’heures après un bon repas.
C’eft ie chyle qui nage avec le fa n g . On a voulu
faire palfer ce chyle pourune ferofité ; mais certainement
le fénim n’a pas la blancheur laiteufe & opaque
du chyle , & je ne vois pas ce qui etnpccheroit
le chyle d’être vifiblc, après l’avoir vu nager par
ondées dans la veine-cave d’un animal, que j’avois
ouvert en vie.
Toute la maffe du f a n g , qui fort fluide de la veine
ouverte, ou qui vient de quelques arteres des
narines dilatées, & qui tombe goutte à goutte , fe
]>rend en fort peu de tems, & en d’autant moins
de tems que l’homme eft plus fain & plus robufte.
Il forme dans un demi-quart d’heure un caillot rouge
, egalement dans les chaleurs de r c t c ,& dans
le froid de l’hiver, lorfqu’il n’a que l’air à parcourir.
Si le fang tombe dans l’eau , il faut pour le cailler
, qu'elle ait un certain degré de chaleur , &
meme conftdcrable , comme de 80 tk de 100 déorés
de Fahrenheit. Dans la veine liée d’un animal vivant
, il fe prend également fans le fecours de l’air,
& on en découvre le méchanilme dans les animaux
k f in g froid, lesglobules s’attirent s’amoncelant;
ilelt vrai , que leurs amas ne font attachés que par
un foible lien , & qu’il eft aifé de les fcparer , en fai-
lant couler dans les vaiffeaux une nouvelle onde de
fang.
La partie blanche fcparée des globules forme un
brouillard, dont la confiftance augmente, & a plus
de ténacité que le caillot rouge.
Leyè,-:^ de tous les animaux fe change en maffe
folide & tremblante , depuis l’homme julqn’aux
poiffons : il eft vrai que ce coagulum eft plus ten
dre dans les animaux à fm g froid , comme il eft plus
lent à fe former, Sc pins foible dans un homme
d’une famé peu ferme. Il eft plus promj)t k (e former
& plus lolide encore dans les maladies inflammatoires
, il y a meme des exemples que le fa n g s’efl pris
dans des vaiffeaux même. Cela arrive conftamment
dans les anevriftnes, oîi le mouvement du yàn» eft
retardé, & apres les bleffurcs des arteres, qui fe
ferment par le caillot naturel. Dans des cas plus rares
on a vu des croûtes membraneiii'es & filamen-
teufes remplir les grands vaiffeaux , & occuper
même tout le calibre de la velnc-cavc, de la jugulaire
& des arteres carotides.
Les polypes font des caillots, ou du fm g ^ n maffe,
ou du moins de la lymphe. Je ne les crois pas auflî
communs qu’on l’a cru dans le ffecle precedent,
& même de nos jours, que plufieurs médecins les
ont regardés comme la caulè de plufieurs morts
fiibites. Il y en a cependant de véritables; on les
rcconnoît par les alongemens qu’ils produilént dans
le coeur, dont ils dilatent les cavités, & par les
fymptomes qu’ils occaffonneat, les palpitations,
les anxiétés, les pouls intermittens & interrompus.
Après ces phénomènes fort fuperficiels , qui le
prefentent d’eux-memes dans \ t f w g , nous allons
entrer dans la recherche des élémens dont il eft com- pofé.
Celui qui s’échappe le premier , c’eft la chaleur.
"^0 fa n g eft naturellement chaud dans l’homme,
dans loifeau dans les poiffons cétacées. Sa chaleur
a une mefure affez conftanre dan.s ces claflés,
elle eft de 9 6 dégrés de Fahrenheit dans l’homme, &
elle na pas beaucoup de latitude, elle ne tombe
guère qu’a 88, & mogte â 1 10 ; au-delà de ce clé-
gré 1 animal périt. L’oifeau eft de quelques clégré.s
plus chaud que l’homme.
Les animaux à fa n g froid ont dans le fa n g une
Tonii i y .
S A N 72. Î
chaleiir de très-peu fupérieurc à celle de i’athrno-'
fphere , elle la lurpaffe depuis un dégré jiifqu’à huit-.
Les animaux k fa n g chaud , dans leur affoupiffement
(1 h iver, ont le fa n g auffi froid que rafhino(|)herc ;
tels font l’hirondelle , le hériffbn. Les infeéles ne
paroiffent pas avoir de la chaleur,pas même ceux qui
lont d une grandeur fujréiieure à celle de pliiffciirs
animaux à c h a u d , comme les homars. Un mouvement
foible de quelques iniéaes amoncelés produit
cependant une chaleur très-confidérable, comme
celui d’une ruche d’abeilles ; cette chaleur égale
& lurpaffe même celle du fa n g humain. J^es guêpes
n’en produilém point.
La chaleur du eft affez généralement fiipé-
rieiire k celle de l’athmolpherc , on a cru même
qu’elle ne tomboit jamais au-deflbus de ce degré ,
& que l’animal ne pourroit refter en vie dans im
air , dont la chaleur feroit égale à celle du fm g .
C’eft une erreur , la chaleur de la Caroline a été de
ii6 d ég ré s ,d e 140 au Sénégal, de 167 meme à un
mur fur lequel donnoient les rayons du foleil. Je
l’ai vue de 1 50 degrés à Roche dans une fjuiation
pareille , & expofée au foIeil. Dans ces énormes
chaleurs, il pérît chaque année des perfonnes, mais
le peuple furvit,il travaille voyage. MM. Duhamel
& Tillet ont vu une fille loutenir une chaleur
fupérieure à celle de l’eau bouillante , & les étuves
Ruffes vont à z o i degrés.
C ’eft une conftance qui a étonné. Le même homme
peut vivre & dans le Sénégal, & à Jénileisk ,
ou le froid a été de 120 degrés de Fahrenheit au-
deffous du zéro, ce qui fait une échelle de 150 dé-
grés , dans laquelle la vie humaine peut fubfifter ,
& qui paffe de beaucoup la chaleur de l’eau bouillante.
Et l’on fe plaint que la machine animale eft
foible, & facile à déranger !
Un autre élément volatil du fa rîg , c’eft une vapeur
qui monte du fa n g nouvellement répandu , Sc
qui eft vifible même en été ; mais bien plus en hiver.
Cette vapeur a de la chaleur , elle eft aqueu-
l e , mais avec une petite odeur fétide, qui appro-
che de la ciaffe iirineufe ; elle eft plus forte dans
le fa n g des animaux carnivores , &: plus douce dans
les herbivores. Quelques animaux répandent une
vapeur fort âcre, & qui enflamme les y eu x ,
celle du fang acquiert de la putridité dans les fièvres
malignes. Elle n’eft cependant pas alkaline.
Quand elle s’eft dillîpée , le refte du fa n s devient
plus pefanti
Nous avons vu que le fa n g tiré d’uoe veine fe
prend en peu de tems ; il paroît alors folide, mais
mou, il reçoit l’impreffion du doigt, & l’efface
bientôt après ; mais cette maffe ne tarde pas k fe fé-
parer; elle fue des gouttes d'eau jaunâtre, qui s’a-
maffent & forment une liqueur, dans laquelle la
partie rouge fe meut. On fait par des expériences
exaéles , que cette partie rouge du fm g eft plus
pelante que l’eau jaunâtre, & confidérablement plus
pefante que l’eau , à-peu-près dans la raifon de 12
à 11.
Quand cette partie rouge eft en petite quantité ^
elle forme dans le vaiffeau des lames rouges gela-
tineufes; quand il y en a une quantité confidcra-
ble, elle forme un gâteau qui s’évapore peu à-peu^'
& dont il ne refte qu’une croûte de peu d’epaif-
feur, rbuge-noire, feclie & friable.
La partie roiige du Jang ne forme jamais que
des caillots tendres, moins fermes que ceux quî
proviennent de la lymphe. Dans les faux germes, le
fa n g forme des membranes molles , dont l’ceuf eft
enveloppé. Dans les anévrifmes Ôc dans les ecchy-
mofes, il devient comme des fibres. La chaleur rend
la maffe plus dure, celle même de la fièvre fuffit
pour lui donner de la folidité.
Y Y y x
If '