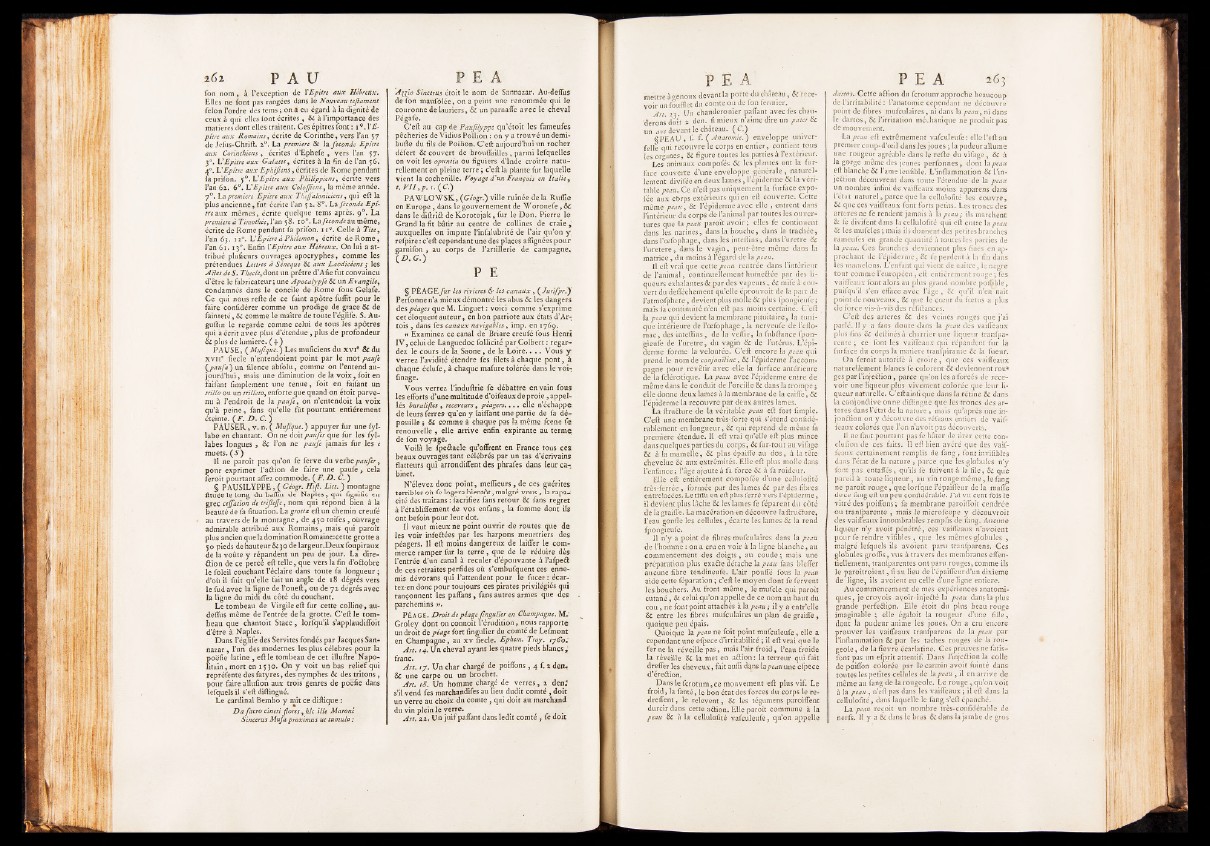
_ f I i i ,
‘ 'm .
i t ji-
1 ' :
,; Cii...
r î i î
'( • < r
i 6 i P A U
fon nom , à l'exception de VEplcre aux Hchreux.
Elles ne font pas rangées dans le Nouveau leßament
feion l’ordre des tems ; on a eu égard à ia dignité de
ceux à qui elles font écrites , & à l’importance des
matières dont elles traitent. Ces cpîtres font : i l’A-
pure aux Romains^ écrite de Corinthe, vers l’an 57
de Jefiis-Chrifl. 2". La premiere & la fécondé Epure
aux Corinthiens , écrites d’Ephefe , vers l’an 57.
3°. VEpitre aux Galaies^ écrites à la ^n de l’an 56.
4°. h'Epître aux Ephéfuns, écrites de Rome pendant
fa prilbn. 5®. <zh.v Philippiens^ écrite vers
l’an 61. 6°. h'Epitre aux Coloffîcns^ la meme année.
7®. La premiere Epitre aux Tkeßaloniciens, qui eR la
plus ancienne, fut écrite l’an ^ 2. 8°. La fécondé EpU
/rtfaux memes, écrite quelque tems apres. 9®. La
premiere a Timothée 58. 10°. La fécondé zx\ même,
écrite de Rome pendant fa prifon. 1 C e l l e à Tite^
l’an 63. 11“. VEpitre à Philernon^ écrite de Rome ,
l’an 61. 13'’ . Enfin r£//rr<; aux Hébreux. On lui a attribué
pluûeurs ouvrages apocryphes, comme les
prétendues Lettres à Séneque & aux Laodiciens ; les
A'âes de S. 7 /;<rirA,dont un prêtre d’Afie fut convaincu
d’être le fabricateur ; une Apocalypfe & un Evangile^
condamnes dans le concile de Rome fous Gelafe.
Ce qui nousreRede ce faint apôtre fuffit pour le
faire confidérer comme un prodige de grace & de
fainreté, & comme le maître de toute l’églife. S. Au-
guRin le regarde comme celui de tous les apôtres
qui a écrit avec plus d’étendue , plus de profondeur
Ôc plus de lumière. (-}•)
PAUSE, (^Mußque.^ Les muRclens du xvi® & du
XVII® Rede n entendoient point par le mot paufe
{^paufa') un filence abfolu, comme on l’entend aujourd’hui,
mais une diminution delà v o ix ,fo it en
faifant fimplement une tenue, foit en faifant un
trillo ou un trillcto, enforte que quand on étoit parvenu
à l’endroit de la paufe., on n’eniendoit la voix
qu’à peine, fans qu’elle fût pourtant entièrement
éteinte. ( 7 . D . C. )
PAUSER , V. n. ( Mußque.') appuyer fur une fyl-
labe en chantant. On ne doit paufer que fur les fyl-
labes longues , ôc l’on ne paufe jamais fur les e
muets. (S')
U ne paroît pas qu’on fe ferve du verbe
pour exprimer l’aélion de faire une paule, cela
feroit pourtant afl'e2 commode. {^F.D. C. )
§ PAUSILYPPE, ( Géogr. Hiß. Uct. ) montagne
fituée le long du baflîn de Naples, qui Rgnifie en
grec cefacion de trifeffe, nom qui répond bien à la
beauté de fa fîtuation. La gratta efl un chemin creufé
au travers de la montagne, de 450 toifes , ouvrage
admirable attribué aux Romains, mais qui paroît
plus ancien que la domination Romainercette grotte a
50 pieds dehauteur&30 de largeur.Deux foupiraux
de la voûte y répandent un peu de jour. La dire-
dion de ce percé efl telle, que vers la fin d’odobre
le foleil couchant l’éclaire dans toute fa longueur ;
d’où U fuit qu’elle fait un angle de 18 degrés vers
le fud avec la ligne de l’oueR, ou de 72 degrés avec
la ligne du midi du côté du couchant.
Le tombeau de Virgile efl fur cette colline, au-
defllis même de l’entrée de la grotte. C ’eR le tombeau
que chantoit Stace, lorfqu’il s’applaudiRbit
d’etre à Naples.
Dans l’églife des Servîtes fondés par Jacques San-
nazar , l’un des modernes les plus célébrés pour la
poéfie latine , efl le tombeau de cet üluftre Napolitain,
mort en 1530. On y voit un bas relief qui
reprefente des fatyres, des nymphes & des tritons ,
pour faire allufion aux trois genres de poéfie dans
lefquels il s’eft diftingué.
Le cardinal Bembo y mit ce difllque :
Da facto cineri flores ^ hic ilLe Maroni
Sincerus Mufa proxirnus ut tumulo :
P E A A^fo Sincêrus étoit le nom de Sannazar. Au*de{Tus
de Ion maufôlée, on a peint une renommée qui le
couronne de lauriers, & un parnaflé avec le cheval
Pégafe.
C ’efl au cap de Paufilyppt qu’étoit les fameufes
pêcheries de Vidius Poilion : on y a trouvé undemi-
bufle du fils de Poilion. C’efl aujourd’hui un rocher
défert & couvert de broufiàilles, parmi lefquelles
on volt les opuntia ou figuiers d’Inde croître naturellement
en pleine terre ; c’eft la plante fur laquelle
vient la cochenille. Eoyage d'un François en Italie,
t. V U .p . tX c . )
PAWLOWSK, (Géogr.) ville ruinée de la Rulîîe
en Europe , dans le gouvernement de AVoronele , ôc
dans le diftriél de Korotojak, fur le Don. Pierre le
Grand la fit bâtir au centre de collines de craie ,
auxquelles on impute l’infalubrlté de l’air qu’on y
refpire : c’efl cependant une des places afiîgnées pour
garnifon , au corps de l’artillerie de campagne.
iD .G . )
P E
§ PÉAGE fur les rivieres & les canaux , ( Jurifpr^
Perfonne n’a mieux démontré les abus & les dangers
des péages que M. Linguet : voici comme s’exprime
cet éloquent auteur, en bon patriote aux états d’Artois
, dans fes canaux navigables, imp. en 1769.
« Examinez ce canal de Briare creufé fous Henri
IV , celui de Languedoc follicité par Colbert ; regardez
le cours de la Saône, de la Loire.. . . Vous y
verrez l’avidité étendre fes filets à chaque pont, à
chaque éclufe, à chaque mafure tolérée dans le voi-
finage.
Vous verrez l’induflrîe fe débattre en vain fous
les efforts d’une multitude d’oifeaux de proie , appel-
lés buralifes , receveurs, pèagers. . . . elle n’échappe
de leurs lérres qu’en y laiffant une partie de fa dépouille
; & comme à chaque pas la même feene fe
renouvelle , elle arrive enfin expirante au terme
de fon voyage.
Voilà le fpeftacle qu’offrent en France tous ces
beaux ouvrages tant célébrés par un tas d’écrivains
flatteurs qui arrondiffent des phrafes dans leur cabinet.
N’élevez donc point, mefîieurs, de ces guérites
terribles oîi fe logera bientôt, malgré vous , la rapacité
des traitans : facrifiez fans retour & fans regret
à l’établiffement de vos enfans, la fomme dont ils
ont befoin pour leur dot.
Il vaut mieux ne point ouvrir de routes que de
les voir infeélées par les harpons meurtriers des
péagers. Il efl moins dangereux de lailTer le commerce
ramper fur la terre, que de le réduire dès
l’entrée d’un canal à reculer d’épouvante à l’afpeft
de ces retraites perfides oû s’embufquent ces ennemis
dévorans qui l’attendent pour le fucer : écar-
tez en donc pour toujours ces pirates privilégiés qui
rançonnent les paflans , fans autres armes que des
parchemins ».
PÉAGE. Droit de péage fngulier en Champagne. M.
Groley dont on connoît l’érudition, nous rapporte
un droit de péage fort fingulier du comté de Lefmont
en Champagne, au x v fiecle. Ephem. Troy. tyCo,
Are. iq.. Un cheval ayant les quatre pieds blancs,
franc.
Art. //. Un char chargé de poiflbns , 4 f. 1 den*
& une carpe ou un brochet.
Arc. 18. Un homme chargé de verres, 2 den:
s’il vend fes marchandifes au lieu dudit comté , doit
un verre au choix du comte , qui doit au marchand
du vin plein le verre.
An. Z2. Un juif pafTant dans ledit comté , fe doit
P E A
niett"c oenoiix devant la porte du château, 5: rece^
voir un foLifflet du comte on de Ion fennier.
Art. 2 j. Un chauderonier palTant avec (es chau-
deronsdoit 2 den. fi mieux n’aime dire un pater ^
un ave devant le château. ( C.)
§P £ A U , f- ï. {Anatomie.) enveloppe umver-
felle qui recouvre le corps en entier, contient tous
les organes, & figure toutes les parties à l’extérieur.
Les animaux compofes & les plantes ont la fur-
face couverte d’une enveloppe generale , naturellement
divilée en deux lames , 1 epiderme & la véritable
peau. Ce n'eflpas uniquement la furface expo-
fée aux corps extérieurs qui en efl couverte. Cette
meme peau, & l cpidcrmc avec elle , entrent dans
l’intérieur du corps de l’animal par toutes les ouvertures
que la peau paroît avoir clics le continuent
dans les narines, dans la bouche, dans la trachée,
dans l’oefophage, dans les inteflins, dans l’iiretre 6c
Puretere, dans le vagin, peut-être même dans la
matrice , du moins à l’égard de la peau.
Il efl vrai que cette peau rentrée dans rintéricur
de l’animal, continuellement huincêlée par des liqueurs
exhalantes & par des vapeurs, 6c mife à couvert
du deflechement qu’elle éprouvoit de la part de
ratmofphefe , devient plus molle & plus fpongieufe ;
mais fa continuité n'en efl pas moins certaine. C'efl
lu peau qui devient la membrane pituitaire, la tunique
intérieure de I’cefophage , la nerveufe de l’cllo-
mac, des inteflins, de ia veflîe, la fubflance fpon-
qieufe de l’uretre, du vagin 6c de Tutérus. L'épi-
clcrme forme la veloufcc. C’efl encore la pe.au qui
j)rend le nom de conjonciine , & répicicnne l’accompagne
pour revêtir avec elle la furface antérieure
de la fclérotique. La peau avec l’cpidcrme entre de
même dans le conduit de i’orcilie & dans la trompe ;
elle donne deux lames à la membrane de la caifle, 6c
l’cpidermc la recouvre par deux autres lames.
La flruQure de la véritable peau efl fort Ample.
C’efl une membrane très-forte qui s’étend confidc-
rablement on longueur, & qui reprend de même fa
premiere étendue. Il efl vrai qu’elle efl plus mince
dans quelques parties du corps, & fur-tout au vifage
Si à la mamelle, & plus épaifié au dos, à la tête
chevelue 6c aux extrémités. Elle efl plus molle dans
l’enfance ; l’âge ajoute à la force & à ù roideur.
Elle efl entièrement conipofce d’une cellulofitc
très-ferrée , formée par des lames 6c par des fibres
entrelacées. Le tilTu en efl plus ierre vers l’épiderme,
il devient plus lâche & les lames fe léparent du côté
de la graiflé. La macération en découvre laflruclure,
l’eau gonfle les cellules , écarte les lames & la rend
fpongieufe.
Il n’y a point de fibres mufculaircs dans la pc.au
de l'homme : on a cru en voir à la ligne blanche, au
commencement des doigts, au coude; mais une
préparation plus exaèle dcrache la peau fans bleffer
aucune fibre tendineufe. L’air pouffé fous ia peau
aide cette féparation ; c’eft le moyen dont fe fervent
les bouchers. Au front même, lemufcle qui paroît
cutané , & celui qu’on appelle de ce nom au haut du
cou , ne font point attachés à la peau; il y a entr’elle
6c entre les fibres mufculaires un plan de graifl'e ,
quoique peu épais.
Quoique la peau ne foit point mufculeufe , elle a
cependant une efpece d’irritabilité ; il efl vrai que le
fer ne la réveille pas, mais l’air froid, l’eau froide
la réveille 6c la met en aêlion: la terreur qui fait
dreffer les cheveux, fait aufir dans Itxpeauwne efpece
d’crcéUon.
Dans le ferotum,ce mouvement efl plus vif. Le
froid, la famé, le bon état des forces du corps le re-
dreffent, le relevent, 6c les tégumens paroiffent
durcir dans cette aftion. Elle paroît commune à la
peau 6c à la cellulofité valculeufe, qu’on appelle
P E A 2 6 1
dartos. Cette afllon du ferolunrapproche lîeaucoup
de l’iriirabilité; l’anatomie cependant ne découvre
))oint de fibres mufculaircs , ni dans la peau, ni dans
le dartos ,& l’irritation mé^hanique ne produit pas
de mouvement.
La peau efl extrêmement vafculeufe: e llcl’cflau
premier coup-d’oeil dans les joues ; la pudeur allume
une rougeur agréable dans le refle du vifage, 6c h
la gorge même des jeunes perfonnes, dont h peau
ell blanche 6c l’aine lenfibic. L’inflammation 6c l’in-
jeétion découvrent dans toute l’étendue de la peau
un nombre infini de vailfeaux moins apparens dans
l’ét.it naturel, parce que la cellnlofué les couvre,
6c que ces vaiffeaux font forts petits. Les troncs des
arteres ne fe rendent jamais à la peau ; ils marchent
& fe divifentdans la cellulofité qui efl entre la peau
& les nmfcles ; mais ils donnent des petites branches
rameiifes en grande quantité à toutes les parties de
In peau. Ces branches deviennent plus fines en approchant
de r'épiderme, & fe perdent à la fin dans
les mamelons. L’enfant qui vient de naître, le negre
tout comme l'européen , eli entièrement rouge ; l'es
vaifl'eaux font alors au jihis grand nombre polfible,
piiilqu'i! s’en etface avec l’âge , qu’il n’en naît
point de nouveaux, & que le coeur du foetus a [dus
de force vis-à-vis des réfiflances.
C ’efl des arteres 6c des veines rouges que j’ai
parié. Il y a lans doute dans la peau des vaifl'eaux
plus fins & dellincsà charrier une liqueur tranfpa-
renre ; ce font les vaifl'eau>: qui répand(.nt lûr la
furface du corps la matière tianfpiramc 6c la ilieur.
On feroit autorité à croire, que ces vaiffeaux
naturellement blancs fe colorent & deviennent rou*
ges par l’injecfion , parce qu’on les a forcés de recevoir
une liqueur plus vivement colorée que leur liqueur
naturelle. C’eflainfique dans la rétine 6c dans
la conjonèUve on ne dillingue que les troncs des arteres
dans l’état de la nature , mais qu’aj)i'ès iinein-
jondion on y découvre des véfeaux entiers de v a if
leaux colorés que l’on n’avoit pas découverts.
Il ne faut pourtant pas fe hâter de tirer cette con-
cîuiioii lie ces faits, il efl bien avéré que des vaiffeaux
certainement remplis de fang , font invifibles
dans l’état de la nature , parce que les globules n’y
font pas cntafl'és, qu’ils f'e fuivent à la file, ôi. que
pareil à toute liqueur , au vin rouge même, le fang
ne paroît rouge, que lorfque l’épaifl'eur de la mafl'e
de ce fang efl un peu confidcrable. J’ai vit cent fois le
vitré des poiflbns; fà membrane paroifl'oit cendrée
ou tranfparcnte , mais le microfeope y dccouvroit
des vaifl'eaux innombrables remplis de lang. Aucune
liqiieur n’y avoir pénétré, ces vaiffeaux n'avoient
pour fe rendre vifibles , que les mêmes globtilcs ,
malgré lefquels ils avoient paru tranfparens. Ces
globules groffis, vus à travers des membranes effen-
tiellement, traniparentes ont paru rouges, comme ils
le paroîtroient, fi au lieu de l’épaiffeurd’un dixième
de ligne, ils avoient eu celle d’une ligne enriere.
Au commencement de mes expériences anatomiques,
je croyois avoir injefté la peau dan? la plus
grande perfeèlion. Elle étoit du plus licau rouge
imaginable ; elle égaloit la rougeur d'une fille,
dont la pudeur anime les joues. On a cru encore
prouver les vaiffeaux tranfparens de la peau par
rinflammation & par les taches rouges de ia rougeole,
de la fievre ccarlatine. Ces preuves ne fatis-
font pas un efprit attentif. Dans l’injctflion la colle
de poiflbn colorée par le carmin avoit fuinté dans
toutes les petites cellules de la peau , il en arrive de
même au fiing de la rougeole. Le rouge , qu’on voit
à la peau , n’efl pas dans les vaifl'eaux ; il efl dans la
cellulofitc, dans laquelle le fang s’efl épanché.
La peau reçoit un nombre très-confidérable de
nerfs. U y a & dans le bras & dans la jambe de gros