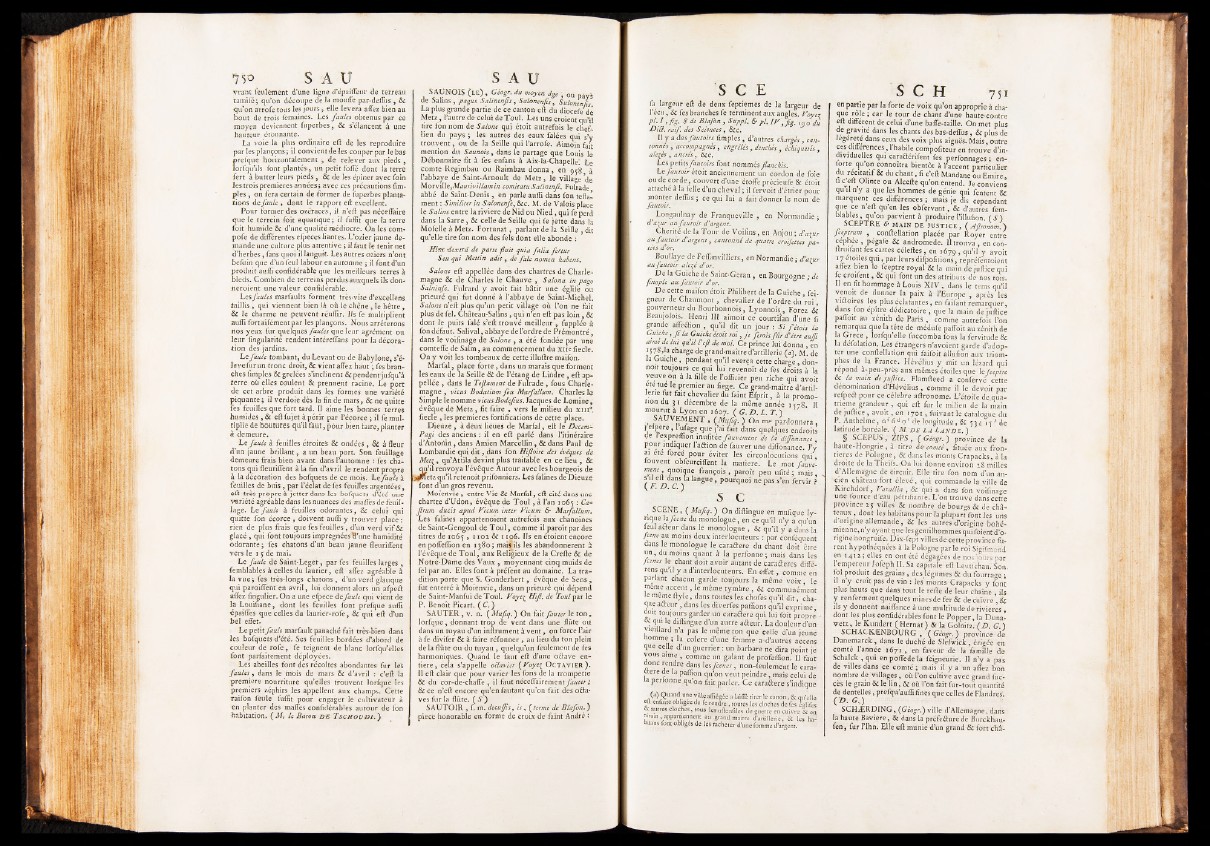
I' ' ’
1 »
lÜH
>7 V o SAU
H .'
rMjf :. i f r r I i
I - '
\} 'ü? , ■
vraiit feulênicnt d’une ligne d’épaifleiir de terreau
lamil'é; qu’on découpe delà moiilTe par-dcffiis , ÔC
qu’on arrofe tous les jours, elle lèvera affez bien au
bout de trois léniaines. Les fu uU s obtenus par ce
moyen deviennent liiperbes, 6c s’élancent à une
hauteur étonnante.
La \^oie la plus ordinaire efl: de les reproduire
parles plançons; il convient de les couper par le bas
preique horizontalement -, de relever aux pieds ,
îorlqu’ils (ont plantés , un petit fbfle dont la terre
fert à butter leurs pieds , & de les épiner avec foin
les trois premières années; avec ces précautions fim-
ples , on fera certain de former de fuperbes plantations
de fa tiU , dont le rapport eft excellent.
Pour former des ozéraces, il n’ell pas néceflaire
que le terrein foit aquatique; il fuffit que la terre
foit humide & d’une qualité njédiocre. On les com-
pofe de différentes elpeces liantes. L’ozier jaune demande
une culture plus attentive ; il faut le tenir net
d’herbes, fans quoi il languit. Les autres oziers n’ont
befoin que d’un l'eul labour en automne ; il fontd’un
produit aufh confidérable que les meilleurs terres à
bleds. Combien de terrems perdus auxquels ils don*
neroient une valeur confîdérable.
Lcs/ira/^J marfaulcs forment très-vite d’excellens
taillis , qui viennent bien )à où le chêne , le hêtre ,
& le charme ne peuvent reuffir. Ils fe multiplient
aulTi fort aifément par les plançons. Nous arrêterons
nos yeux fur quelques que leur agrément ou
leur fingiilarite rendent intéreflans pour la décoration
des jardins.
Le fa i l l i tombant, du Levant ou de Babylone, s’é-
levefurun tronc droit, & vient affez haut ; fes branches
fimples &grelées s’inclinent dépendent jufqu’à
terre où elles coulent & prennent racine. Le port
de cet arbre produit dans les formes une variété
piquante ; il verdoie dès la fin de mars, & ne quitte
fes feuilles que fort tard. Il aime les bonnes terres
humides , & eft fujet à périr par l’écorce ; il fe multiplie
de boutures qu’il faut, pour bien faire, planter
à demeure.
Le fa i l l i à feuilles étroites & ondées , & à fleur
d’un jaune brillant, a un beau port. Son feuillage
demeure frais bien avant dans l’automne : fes chatons
qui fleuriffent à la fin d’avril le rendent propre
à la décoration des bofquets de ce mois. Le fa u U k
feuilles de buis , par l’éclat de fes feuilles argentées,
eft très-propre à jetterdans les bofquets d’été une
wriété agréable dans les nuances des niadés de feuillage.
Le fa i l l i à feuilles odorantes, & celui qui
quitte fon écorce , doivent auffi y trouver place :
rien de plus frais que fes feuilles , d’un verd v if &
glacé , qui font toujours imprégnéesH’une humidité
odorante; fes chatons d’un beau jaune fleuriflent
vers le 1 5 de mai.
Le fa i l l i de Saint-Leger, par fes feuilles larges ,
femblables à celles du laurier, efl: affez agréable à
la vue; fes très-longs chatons, d’un verd glauque
qui paroiflent en avril, lui donnent alors un afpeft
affez fingulier. On a une efpece de fa u lc qui vient de
la Louifianc, dont les feuilles font prefque aiilfi
épaiffes que celles du làurier-rofe, & qui efl d’un
bel effet.
Le petit fa u le marfault panaché fait très-bien dans
les bofquets d’été. Ses feuilles bordées d’abord de
couleur de ro fe , fe teignent de blanc lorfqu’elles
font parfaitement déployées.
Les abeilles font des récoltes abondantes fur les
f a i l l e s , dans le mois de mars & d’avril : c’efl la
première nourriture qu’elles trouvent lorfque les
premiers zéphlrs les appellent aux champ',. Cette
Tailon feule luffit pour engager le cultivateur à
en planter des maffes confidérab'es autour de fon
habitation. (Af. U Baron d e T s c h o v d j .')
SAU
SAUiNOIS (le) , Géogr. du moyen âge , ou payÿ
de Salins , pagus Salïn en fis , Salonenfis , Sidanen fu
La plus grande partie de ce canton efl du diocefe de
Metz, l’autre de celui de Toul. Les uns croient qu’il
tire ion nom de Satone qui ctoit autrefois le chef-
lieu du pays ; les autres des eaux falées qui s’y
trouvent, ou de la Seille qui l’arrofe. Aimoin fait
mention du S a u n o is , dans le partage que Louis le
Débonnaire fit k fes enfans k Aix-la-Chapelle. Le
comte Regimbai! ou Raimbau donna, en 9^8 ^
l’abbaye de Saint-Arnoult de Metz, le village de
M o rv il\e ,M a u riv illam in coniùacii S a lin e n f . Fulrade
abbé de Saint-Denis , en parle aufli dans fon tefta-
ment : Simil'uer in S a lom n fe , & c. M. de Valois place
le S a lin s entre la riviere de Nid ou Nied , qui fe perd
dans la Sarre , & celle de Seille qui fe jette dans la
Mofelle à Metz. Fortunat, parlant de la Seille , dit
qu’elle tire fon nom des fels dont elle abonde ;
Hitix. -dixtrâ de pane fluit quia falia fertur
S ni qui Matin adit, de fait nornen habens.
Salone efl appcilée dans des Chartres de Charlemagne
& de Charles le Chauve , Salona in pa^o
Salninfe. Fiilrard y avoit fait bâtir une églife ou
prieuré qui fut donné à l’abbaye de Saint-Michel.
Salone n’efl plus qu’un petit viÜage où l’on ne fait
plus de fel. Château-Salins , qui n’en efl pas loin, &
dont le puits falé s’eft trouvé meilleur , fupplée à
fon défaut. Salivai, abbaye de l’ordre de Prémontré,
dans le voifinage de Salone , a été fondée par une
comtefl'e de Salm, au commencement du xiie fiecle.
On y voit les tombeaux de cette illuflre maifon.
Marial, place forte , dans un marais que forment
les eaux de la Seille & de l’étang de Lindre , efl ap-
pellée , dans le Teflament de Fulrade , fous Charlemagne
, viens Bodatiitm f e u Marfallum. Charles le
Simple le nomme vicusBodeßus.]zzc^\^% de Lomine,
évêque de Metz , fit faire , vers le milieu du xiii®,
fiecle , les premieres fortifications de cette place.
Dieuze , à deux lieues de MarfaI, efl le Decem^
Pagi des anciens ; il en efl parlé dans l’itinéraire
d’Antorün , dans Amien Marcellin , & dans Paul de
Lombardie qui d i t , dans fon Hißoire des évêques de-
Meti, qu’Attila devint plus traitable en ce lieu , 6c
qu’il renvoya l’évêque Autour avec les bourgeois de
.ViJnetz qu’il retenoit prifonniers. Les falines de Dieuze
font d’un gros revenu.
Moïenvic , entre Vie & MarfaI, efl cité dans une
chartee d’Udon, évêque de T o u l, k l’an 1065 : Ci-
ßrurn du cis apud Victim inter Vicum & Marfallum.
Les falines appartenoient autrefois aux chanoines
de Saint-Gengoul de T oui, comme il paroît par des
titres de 1065 , 1 102. & 1 106. Ils en étoient encore
en poffeflion en 1380; mais ils les abandonnèrent k
l’évêque de T ou l, aux Religieux de la Crefle & de
Notre-Dame des Vaux , moyennant cinq muids de
fel par an. Elles font à préfent au domaine. La tradition
porte que S. Gonderbert, évêque de Sens ,
fut enterré à Moïenvic, dans un prieuré qui dépend
de Saint-Manfui de Toul. Voye:^ H ß . de To«/par le
P. Benoît Picart. ( C. )
SAUTER, V. n. ( Mußq. ) O n fa it fa u te r le ton ,
lo r fq u e , d o n n an t t ro p de v en t dans u ne flû te o u
dans un tu y a u d’ un in fin im e n t à v e n t , on fo r c e l’a ir
à fe d iv i fe r & à fa ire r é fo n n e r , au lieu du to n p lein
de la flû te o u du tu y a u , q u e lq u ’un léu lem en t de le s
h a rm o n iq u e s . Q u an d le fau t e f l d ’une o f l a v e en t
i è r e , c e la s’ a p p e lle oeiavier {V oye^ O c t a v i e r ) .
11 e fl c la ir q u e p o u r v a r ie r le s fo n s de la t rom p e t te
& du c o r -d e -ch a ffe , il fau t n e c e fla irem en t fa u te r i
& c e n ’e ft e n c o r e q u ’ en fau tan t q u ’on fa i t d e s ofla*
v e s fu r la flû te . ( A )
SAUTOIR , f. in. deeußs, is , ßerme de Blafon. )
p ie c e h o n o r a b le en fo rm e de croi.x de faint André :
. I ii.{ ' l i ï l ' î '
S C E
fa largeur efl de deux feptiemes de la largeur de
récu , & fes branches fe terminent aux angles. Voye^
,fig. 8 de Blafon , Suppl. & pl. IV ,fig . iqo du
Dicl. raif des Sciences, Sic.
II y a àQsfautoirs^ Amples , d’autres chargés , cantonnés
, accompagnés , engrêlés , denckés , échiquetés ,
aleiés , ancrés , 6cc.
Les petitsy««m/>5 font nommés fianchis.
hc fantoir etoit anciennement un cordon de foie
onde cordc, couvert d’une étoffe précieufe & cîoit
attaché k la Telle d’un cheval ; il fervoit d’étrier pour
monter delfus ; ce qui lui a fait donner le nom de
faïuoir.
^ Longaiilnay de Franquevüle , en Normandie ;
d'a^nr au faiitoir d’argent.
Cherité de la Tour de Voifins, en Anjou ; dlaïur
au fautoir d'argent, cantonné de quatre croiletus pa-
lits d’or. ^
Boullaye de Feffanvillicrs, en Normandie ;
au faiitoir aieif d'or.
De la Giiiche de Saint-Geran , en Bourgogne ; de
finopli au fintoir d’or.
De cette maifon étolt Philibert de la Gulche , fei-
gneiir de Chaumont , chevalier de l’ordre du roi
gouverneur du Bourbonnois , Lyonnois , Forez 6c
Beaujoiois. Henri III aimoit ce courtiî'an d’une fi
grande affeaion , qu’il dit un jour : Si fétois la
Giiicke , ƒ la Guichi était roi , je ferais fur d'éire aiiffi
aimé de lui qu il l'efl de moi. Ce prince lui donna , en
j 57Bda charge de grand-maître d’artillerie («). M. de
la Guiche, pendant qu’il exerça cette charge , don-
noit toujours ce qui lui revenoit de fes droits à la
yeiive^ou à la fille de l’officier peu riche qui avoit
ete tue le premier an fiege. Ce grand-maître d’artil-
lene fut fait chevalier du faint Efprit, à la promotion
du 3 I décembre de la même année 1 5-8. Il
mourut à Lyon en 1607. ( G. D. L .T .') '
SAUVEMENT , {Mufiq. ) On me pardonnera
jelpere, lufage que j’ai fait dans quelques endroits
de lexpreiîîon inufitée fauvemem de la dijfonance
pour indiquer ladion de fauver une diffonance. J’y
ai ete forcé pour éviter les circonlocutions qui
louvent obfcurclffent la matière. Le mot fauve-
quoique françois , paroît peu uficé ; mais,
s il efl dans la langue, pourquoi ne pas s’en fervir ?
( F. D . C. )
S C
. Sv^ENE, ( Mufq. ) On diflingue en mufique lyrique
\afccne du monologue , en ce qu’il n’y a qu’un
feul aéfeiir dans le monologue , & qu’il y a dans la
fetne au moins deux interlocuteurs : par confequent
dans le monologue le caraéfere du chant doit être
un, du moins quant k la perfonne ; mais dans les
fanes le chant doit avoir autant de caraéfercs difl'é-
rens qu’il y a d’interlocuteurs. En effet, comme en
parlant chacun garde toujours la même voix , le
memy accent, le même tymbre , communément
le memeftyle, dans toutes les chofesqu’il dit, chaque
aéfeur , dans les diverfes pallions qu’il exprime,
doit toujours garder un caraaerc qui lui foit propre -
^ qui le diflingue d’un autre aacur. La douleur d’im
Vieillard n’a pas le même ton que celle d’un jeune
nomme ; la colere d’une femme a d’autres accens
que celle d’un guerrier : un barbare ne dira point je
vous aime , comme un galant de profeflion. Il faut
onc rendre dans les feenes , non-feulement le caractère
de la paflion qu’on veut peindre , mais celui de
a perlonne qu’on fait parler. Ce caraftere s’indique
(<i) Quand une villealFiégée ahlffé tirer ic canon ,& qu’elle
cil enflure obligée de fe rendre , toutes les clodies de fes églifes
y autres cloches, tous les uflenfiles de guerre en cuivre eu
oin-iin appartiennent an grand maître d’artillerie, & les ha-
t>«ans font obliges de les racheter d’une fomine d’argent.
S C H 7$i
en partie par la forte de voix qu’on approprie k cha*
que rôle ; car le tour de chant d’une haute-contre
efl différent de celui d’une baffe-taille. On met plus
de gravité dans les chants des bas-deffus , & plus de
legereté dans ceux des voix plus aiguës. Mais, outre
ces differences, 1 habile compofiteiir en trouve d’individuelles
qui caraaérifent fes perfonnages ; en-
orte quon connoîtra bientôt à l’accent particulier
du récitatif 6c du chant, fi c’eft Mandane ou Emire
fi c’eft Ohme ou Alcefle qu’on entend. Je conviens
qu il n’y a que les hommes de génie qui Tentent ÔC
marquent ces différences; mais je dis cependant
que ce n’eft qu’en les obfervant, & d’autres femblables,
qu’on parvient à produire l’illufion. (A )
SCEPTRE & MAIN DE JUSTICE, {Af i ronom. )
fcepirum , ^ conflellation placée par Royer entre
céphée, pégafe & andromede. Il trouva, en con-
flruifant fes cartes céleftes, en 1679, ^” ’^1 y avoit
17 étoiles qui, par leurs difpofitions, repréfentoient
aflëz bien le feeptre royal 6c la main de juflice qui
fe cioifent, 6c qui font un des attributs de nos rois.
Il en fit hommage à Louis X IV , dans le tems qu’il
yenoit de donner la paix à l’Europe , apics les
viéloires les plus éclatantes , en faifant remarquer,
dans fon épître dédicatoire , que la main de juflice
pafioit au zénith de Paris , tomme autrefois l’on
remarqua que la lete de médufe paffoit au zénith de
la Grece , lorfqu’elle fuccomba fous la fervitude 6c
la défolation. Les etrangers n’avoient garde d’adopter
une conflellation qui faifoit ailufion aux triomphes
de la France. Hévelius y mit un lézard qui
répond à-peu-près aux mêmes étoiles que \ cjcep‘trs
6c la main de ju f tic e . Flamfteed a conferve cette
dénomination d’flévélius , comme il le devoir par
relpeéf pour ce célébré aflronome. L’étoile de oiia-
irieme grandeur , qui cft fur le milieu de la main
de juflice, avoit, en 1701 , fuivant le catalogue du
P. Antheime, 6 o ' de longitude , 6c 53a 15 ' de
latitude boréale. ( M. d e l a L a n d e . )
§ SCEPUS , ZIPS , ( Géogr. ) province de la
haute-Hongrie , a titre de com té , fituée aux frontières
de Pologne, 6c dans les monts Crapacks, à la
droite de la Theils. On lui donne environ 28 milles
d’Allemagne de circuit. Elle tire fon nom d’un ancien
château fort élevé, qui commande la ville de
Kirchdorf, Varallia , & qui a dans fon voifinaffe
une fource d’eau pétrifianie. L’on trouve danscene
province 23 villes Sc nombre de bourgs 6c de châteaux
, dont les habitanspour la pluj>art font les uns
d’origine allemande, & les autres d'origine bohémienne,
n’y ay ant que lesgentilhommes qui foient d’o-
riginc hongroile. Dix-fcpt villes de cette province furent
hypothéquées à la Pologne par le roi Sigifmond
en 1412; elles en ont été dégagées de nos jours uar
l’empereur Jofeph II. Sa capitale efl Leutichau. Son-
fol produit des grains , des légumes 6c du fourrage ;
il n’y croît pas de vin : les monts Crapacks y font
plus hauts que dans tout le refle de leur chaîne , ils
y renferment quelques mines de fer ôc de cuivre’, &
ils y donnent naillance à une multitude de rivières ,
dont les plus confidérables font le Popper, la Duna-
wetz, le Kiindert (Hernat) 6t la Golnitz. fT>. G J
SCHACKENBOURG , {G é o g r .) province de
Danemarck, dans le duché de Slefwick, érigée en
comté l’année 1671 , en faveur de la famille de
Schaick , qui en poffede la feigneurie. Il n’y a pas
de villes dans ce comté ; mais i! y a un affez bon
nombre de villages, oit l’on cultive avec grand fuc-
cès le grain 6c le lin, & où l’on fait fur-tout quantité
de dentelles, prefqu’auffi fines que celles de Flandres.
( Z?. GO
SCHÆRDING, {Géogr.) ville d’Allemagne, dans
la haute Bavière, & dans la prcfeftiirede Burckhau-
fen, fur l’ihn. Elle efl munie d’un grand 6c fort châ