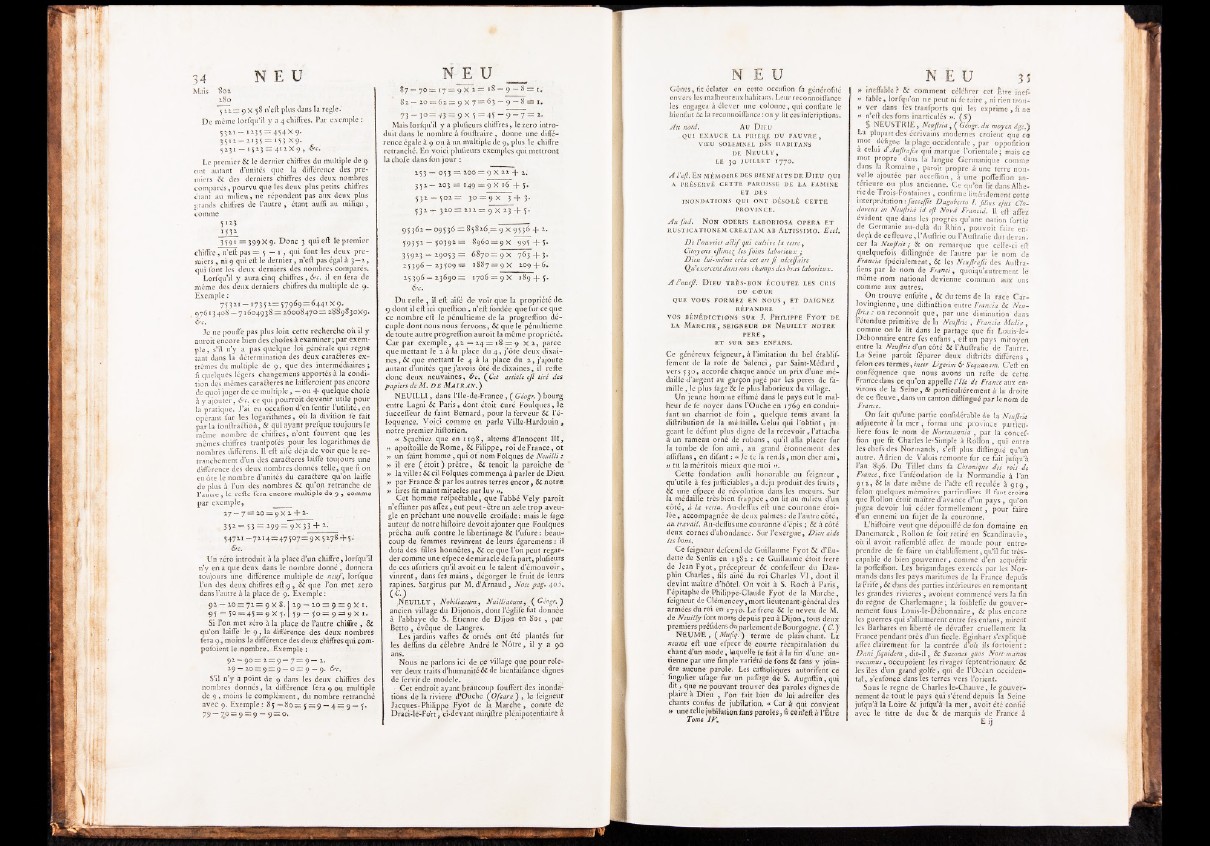
3 4
M.îis
N E U N E U
5 1 1— 9 x 5 8 n'cft plus (liîus la i cgle.
Do morne loriqu’il y a 4 chiilVes. Par o.soniplc :
5 U ' - ,135 = 4 5 4 x 9 .
3 5 1 1 - 1 1 5 5 = »‘«5 X9.
5231 - 1 5 1 5 = 4 1 1X 9 , &c.
Le premier le (.lcrnier chillVes du multiple de 9
ont autant d’imités que la clinoroiice des jire-
niiors & des derniers cliillVes des deux nombres
compares, jiourvu que les deux plus petits chidVes
étant au mdieu, ne répondent pas aux doux plus
«e.rands chifl'ies do 1 autre , étant aulîi au milieu ,
comme
>5D.
3591 = 3 9 9 x 9 . Donc 5 qui eft le premier
chitTre, n 'e llp a s= 5 — 1 , qui Ibnt les deux premiers
, ni 9 qui elt le dernier, n’cii pas égal k 3—1 ,
qui l'ont les deux derniers des nombres comparés.
Lorsqu’il y aura cinq chiffres, &c. il en fera de
meme des deux derniers chiflres du multiple de 9.
Exemple :
7 5 3 1 1 - 1 7 5 5 1 = 57969 = 6 4 4 1x9 .
9761340!^ — 71604938 = 16008470= 1889830X9.
t-c.
Je tic poudé pas plus loin cetic recherche oii il y
auroit encore bien des chofes examiner; par exemple
, s'il n'y a pas quelque loi générale qui régné
tant dans la détermination des deux caraéteres extremes
du multiple de 9, que des intermédiaires ;
fl quelques légers changemens apportés ù la condition
des memes caraiferes ne laidéroienr pas encore
de quoi juger de ce multiple, — ou -(- quelque choie
y ajouter, ce qui pourroit devenir utile pour
la pratique. J'ai eu occalion d’en fentir futilité, en
ooeram fur les logarithmes, oit la clivilion lé fait
par la foullraclion,"& qui ayant prefque toujours le
même nombre de chiiifcs, n'ont fouvent que les
mêmes chidres tranfpof'és pour les logarithmes de
nombres differens. Il efl aifé déjà de voir que le re-
ti-fluchcmciK d’un des caraéferes laiiïe toujours une
ditfcrcnce des deux nombres donnés telle, que fi on
en üte le nombre d'unités du caraétere qu’on lailîé
de plus à l'un des nombres & qu’on retranche de
l’autre , le relie fera encore multiple de 9 , comme
par exemple, ____
27- - 7 = 20 = 9 x 1 + i.
3 5 2 - 53 = 2991 9 x 3 3 + ^
54711-7214 = 47507=9X5278-1-5.
Un 7-cro introduit à la ])l.ice d’un chiffre, lorfqu’ll
n’y en a que deux dans le nombre donné , donnera
toujours une différence multiple de neuf, lorlquc
l’un des deux chiffres efl 9 , & que l’on met zéro
dans l’autre à la place de 9. Exemple :
92 — 20 = 72 = 9 x 8 . i 29 — 20 = 9 = 9X I.
95 - 50 = 4 5 = 9 X 5.1 59 - 5 0 = 9 = 9 X I.
Si l’on met zéro à la place de l’autre chiffre , &
qu’on laiffe le 9 , la différence des deux nombres
fera 9, moins la différence des deux chiffres qui com-
poloient le nombre. Exemple :
92 -90= 2 = 9 - 7 = 9 - 2.
29 — 20 = 9 = 9 — 0 = 9 —9. 6'c.
S'il n’y a point de 9 dans les deux chiffres des
nombres donnés, la différence fera 9 ou multiple
de 9 , moins le complément, du nombre retranché
avec 9. Exemple ; 85 — 80 = 5 = 9 — 4 = 9 — 5.
7 9 - 7 0 = 9 = 9 - 9 = 0 .
87 — 70 = 1 7 = 9 X 2 :
S i — 20 = 62 = 9 X 7 :
; 1 8 - 9 - 8 = r.
; 63 - 9 - 8 = 1 ,
73 - 30 = 43 = 9 X 5 = 45 - 9 - 7 = i-
Mais lorkju’il y a pUiilcurs cliinVes, le /.cro intro-
<luit dans le nombre iv ibullraire , donne une dilfé-
•encc égale k 9 ou k un multiple de 9, plus le chiffre
/etranche. En voici plufieurs exemples qui jnettront
la chufe dans Ion jour :
253 — 053 = 200 = 9 X 22 -p Z.
3 5 1 - 103 = 149 = 9 X 16 4- 5.
5 32 - 50x = 30 = 9 X 3 + 3 -
532 — 5 20 = 112 = 9 X 23 -h 5.
95362 — 09536 = 85826 = 9 X 9536 -P 2.
5 9 3 5 2 - 5 0 3 9 1= 8960 = 9 X 995 - f 5-
3 5 9 1 3 -2 9 0 5 3 = 6870= 9 X 763 q - î-
25396— 23509= i887 = 9 X 209-P6.
25396 — 23690= i 7o6 = 9X 1^9-1-5*
6-c.
Du relie , il cil aifé de voir que la propriété do
9 dont il ell ici quellion , n’elt fondée que fur ce que
ce nombre ell le pénultième de la progrelîion décuple
dont nous nous fervons, & que le pénultième
de toute autre progrclfion auroit la même propriété.
Car par exemple , 42 — 24 = 18 = 9 x 2, parce
que mettant le 2 ù la place du 4 , j’ote deux dixai-
n e s ,& q u c mettant le 4 à la j)lace du 2, j’ajoute
autant d'unités quej’avois ôté de dixaines, il relie
donc deux neuvaines, &c. (C'tr anicle cji tire des
papiers de M. DE M â IRA N .)
NEUILLI, dans l’Ile-de-France , ( Geogr. ) bourg
entre Lagni & Paris, dont étoit curé Foulques, le
fuccelfeur de faint Bernard, j)our la ferveur l’éloquence.
^’ üici comme en parle Ville-Hardouin ,
notre premier liilloricn.
« Sçachicz que en 1198, altems d’innocent III,
» apoiloille de Rome, & Filippe, roi de France, ot
» un faint homme , qui ot nom Folqucs de NeuiUi :
» il erc (é to it) prêtre, & tenoit la paroiche de
» la ville : 6c cil Folqucs commença k parler de Dieu
» par France & parles autres terres encor, 6c notre
>, lires Ht maint miracles par luy »,
Cet homme rcfpeélable, que l’abbé V ely paroît
n’ellimer pas affez, eut peut-être un zele trop aveugle
en prêchant une nouvelle croifade; mais le fage
auteur de notre hilloire devoir ajouter que Foulques
prêcha aulfi contre le libertinage 6c l’ufiire: beaucoup
de femmes revinrent de leurs égarcmens : il
dota des filles honnêtes, 6c ce que l’on peut regarder
comme une efjjece de miracle de fa part, plufieurs
de ces ufuriers qu’il avoit eu le talent d’émouvoir ,
vinrent, dans fes mains , dégorger le fruit de leurs
rapines. Sargirus par M. d’Arnaud , Noce pug. 40J,
( C . )
N euilly , NobUuicum, Nuilliacum, ( )
ancien vil'age du Dijonois, dont l’cglife fut donnée
à l’abbaye de S. Etienne de Dijon en 801 , par
Betto, évêque de Langres.
Les jardins valtes 6c ornés ont été j)lantés fur
les deflîns du célébré André le Nôtre, il y a 90
ans.
Nous ne parlons ici de ce village que pour rolc-
ver deux traits d’humanité 6c de bienfiifance dignes
de fervir de modèle.
Cet endroit ayant beaucoup fouffert des inondations
de la riviere d’Ouche (^Ofeara ) , le feigneur
Jacques-Philippe Fyot de la Marche, comte de
Draci-le-Fo'rt, ci-devanc minjiflrc plénipotentiaire k
E U (>êncs, fit éclater en cette occafion fa générofité
envers les malheureux h.ibitans, Leur rcconnoÜKince
les engagea k élever une colonne, c[ui conffate le
inenfut 6c la reconnoiffance: 011 y lit cesinl'cri[,tionb.
yht nord. Au Dn u
QUI EXAUCE LA l’RJERE DU PAUVRE,
VUlU SOLI MNI'L des IIAUITANS
DE Nr.UL.LY,
LE 30 JUILLET 1770.
l'efî. En MÉ:MomE oes yfENFAiT.s de D ieu qui
A PRÉSERVÉ CETTE PAROISSE DE LA FAMINE
ET DES
INONDATIONS QUI ONT DÉSOLÉ CETTE
PROVINCE.
Âu fud. Non odeius laboriosa opf.ra et
RUSTICATIONEM CREATAM AB AlTISSIMO. Eccl.
De l'ouvrier (ldif qui cultive lu terre.
Citoyens efi/ne^ les foins laborieux ;
Dieu lui-mèrne créa cet an Jï nccejfaire
Q_ii exercent dans nos champs des bras laborieux.
A l'oiief. D ieu très-bon écou te?, les cris
DU CIKUR
QUE v ou s FORMEZ EN NOUS, ET DAIGNEZ
RÉPANDRE
A^OS BÉNÉDICTIONS SUR J. PlIILIPPE FyOT DE
LA Marche , SEIGNEUR df. Neuilly notre
PERE ,
ET SUR SES ENFANS.
Ce généreux feigneur, à l’imitation du bel cfablif-
fement <le la role de Salenci, par Saint-Médard ,
vers 5 30, accorde chaque année un prix d’une médaille
d'argent au garçon jugé par les peres de famille
, le plus (age 6c le plus laborieux du village.
Un jeune hom ne eilimé dans le pays eut le malheur
de le noyer dans FOuche en 1769 en condui-
lant un charriot de foin , quelque tems avant la
(lifiribution de la médaille. Celui qui l’obtint, jugeant
le défunt plus digne de la recevoir, l’attacha
À un rameau orné de rubans, qu'il alla placer fur
la tombe de fon ami , au grand étonnement des
affillans, en difant : « Je ic la rends , mon cher ami,
w tu la méritois mieux que moi ».
Cette fondation nufll honorable au feigneur ,
qu’utile à fes jufticiabics, a déjà produit des fruits ,
6c une cfpece de révolution dans les moeurs. Sur
la médaille très-bien frappée , on lit au milieu d’un
côté, à la venu. Au-defias ell une couronne étoilée,
accompagnée de deux [)almes: de l’autre côte,
au travail. Au-deffusune couronne d’épis ; 6c côté
(leux cornes d’abondance. Sur l’exergue, Dieu aide
les bons.
Ce feigneur defeend de Guillaume Fyot & d’Eii-
dette de Senlis en 1382 ; ce Guillaume étoit frere
de Jean Fyot, précepteur & confeffeur du Dauphin
Charles , fils aîné du roi Charles V I , dont il
devînt maître d’hôtel. On voit k S. Roch à Paris,
l’ épitaphe de Philippe-Claude Fyot de la Marche,
feigneur de Clémenccy ,mort lieutenant-général des
.armées du roi en Le frere 6c le neveu de M.
de Neuilly lotit morts depuis peu à D ijon, tous deux
premiers jjréficlcns du parlement de Bourgogne. ( G. )
NEUME, terme de plain-chant. La
neume ell une dpece de courte récapitulation du
chant d’un mode, laquelle le fait à la fin d’une antienne
par une fimple variété de fons 6c fans y joindre
aucune parole. Les catholiques autorifent ce
fipgulicr ufage fur un paffage de S. Augullin, (jiii
dit , que ne pouvant trouver des paroles dignes de
plaire à Dieu , l’on fait bien de lui adrelter des
chants confus de jubilation. « Car à qui convient
» une telle jubilation fans paroles, fi ce n’eli à l’Être
Tome ly .
N E U » ineffalilc ? 6c comment célébrer cet Être incf-
» fable , lorfqu’on ne ])eut ni fc taire , ni rien trou-
» ver dan.s fes tranlports qui les cxjirime , fi ne
>» irell des Ions inarticulés ». (.V)
§ NEUSTKIE , Ncufiria , ( Géogr. du moyen dgc.'^
Eh plupart des écrivains modernes croient que ca
mot defigne la plage occidentale , par oppofition
a celui dylujlrafia qui marque l’orientale; mais ce
mot propre dans la langue Germanique comme
dans la Romaine , paroît jjropre à une terre nouvelle
ajoutée par acceffiou, k une poffeffion anterieure
ou plus ancienne. Ce qu’on lit dans Albc-
nc de Trois-Fontaines , confirme Uttéralemcm cette
interprétation :y//c«//ô Dagoberto I.Jilius ejtis do-
dovais in Neujirià id e[l Nova Francia. 11 eff affez
évident que dan.s les progr<îs qu’une nation fortie
de Germanie au-dcbl du Rlfin , jiouvoit faire en-
deçà de ce lleuve , l’Aullrie ou l’Auflrafie dut devancer
la Nenjlrie ; 6i on remarque que cellc-ci ell
quelquefois dillinguée de l’aiiire par le nom de
Francia fpécialement, & les des Aufirafiens
par le nom de Franci, quoiqu’autremcnt le
même nom national devienne commun aux uns
comme aux autres.
On trouve enfuite , & du tems de la race Car-
lovingienne, une dillinction entre/'/•a/RÉr 6c Nm-
[h'ta : onrcconnoît que, par une diminution dans
l’étendue primitive de la Neuflrie , Francia Media ,
comme on le lit clans le partage que fit Louis-Ie-
Debonnaire entre les enfans , ell un pays mitoyen
entre la Neuf rit d’un côté 6c l’Aullrafie de l’autre.
La Seine paraît fcparer deux dillricls différens ,
felon ces termes, Ligerim & Sequan.im. C’ell en
confcc/uence que nous avons un relie de cette
Francedans ce qu’on appelle l'iie de France aux environs
de la Seine, & particuliérement ü la droite
de ce fleuve, dans un canton dillingué par le nom de
France.
p n fait qu’une partie confulérable de la Neuf rie
adjacente la mer, forma une province particu.
liere fous le nom de Nonm.innia , par la conLcf-
fion que fit Charles Ic-Simple k Rollon , qui entre
les chefs des Normands, s’ell plus dillingiié qu’un
autre. Adrien de Valois remonte fur ce fait julqu’;\
l’an 896. Du Tillet dans fa Chronique des rois de
France, fixe l’inféodation de la Normandie à l’an
9 1 1 , &: la date même de l’aclc cil reculée 3 9 1 9 ,
felon quelques mémoires particuliers. H faut croire
que Rollon étoit maître d’avance d’un pays, qu’on
jugea devoir lui céder formellement, pour faire
d’un ennemi un fiijet de la couronne.
L’hiftüire veut que dépouillé de fon domaine en
Danemarck, Rollon fe foit retiré en Scandinavie,
où il avoit ralTemblé affez de monde pour entreprendre
de fe faire un ctablifl'ement, qu’il fut très-
capable de bien gouverner, comme d’en acquérir
la poffeffion. Les lîrigandages exercés par les Normands
dans les pays maritimes do la France depuis
la Frife, & dans des parties intérieures en remontant
les grandes rivieres, avoient commencé vers la fin
du régné de Charlemagne; la foibleffe du gouvernement
fous Louis-le-Débonnaire , 6c plus encore
les guerres qui s’allumèrent entre fes enfans, mirent
les Barbares en liberté de dévaller cruellement la
France pendant ores d’un fieclc. Eginhart s’explique
afl'ez clairement fur la contrée d’où ils fortoient :
Dani fiquidem , , 6cSutones quos Non-ni.inos
, occupoient les rivages léptentrionaux 6c
les îles d’un grand golfe, qui de l’Océan occidental,
s’enfonce dans les terres vers l’orient.
Sous le régné de Charles le-Chauve, le gouvernement
de tout le pays qui s’étend depuis la Seine
jiifqu’à la Loire 6c jufqu’à la mer, avoit été confie
avec le titre de duc 6c de marquis de France à
E ij