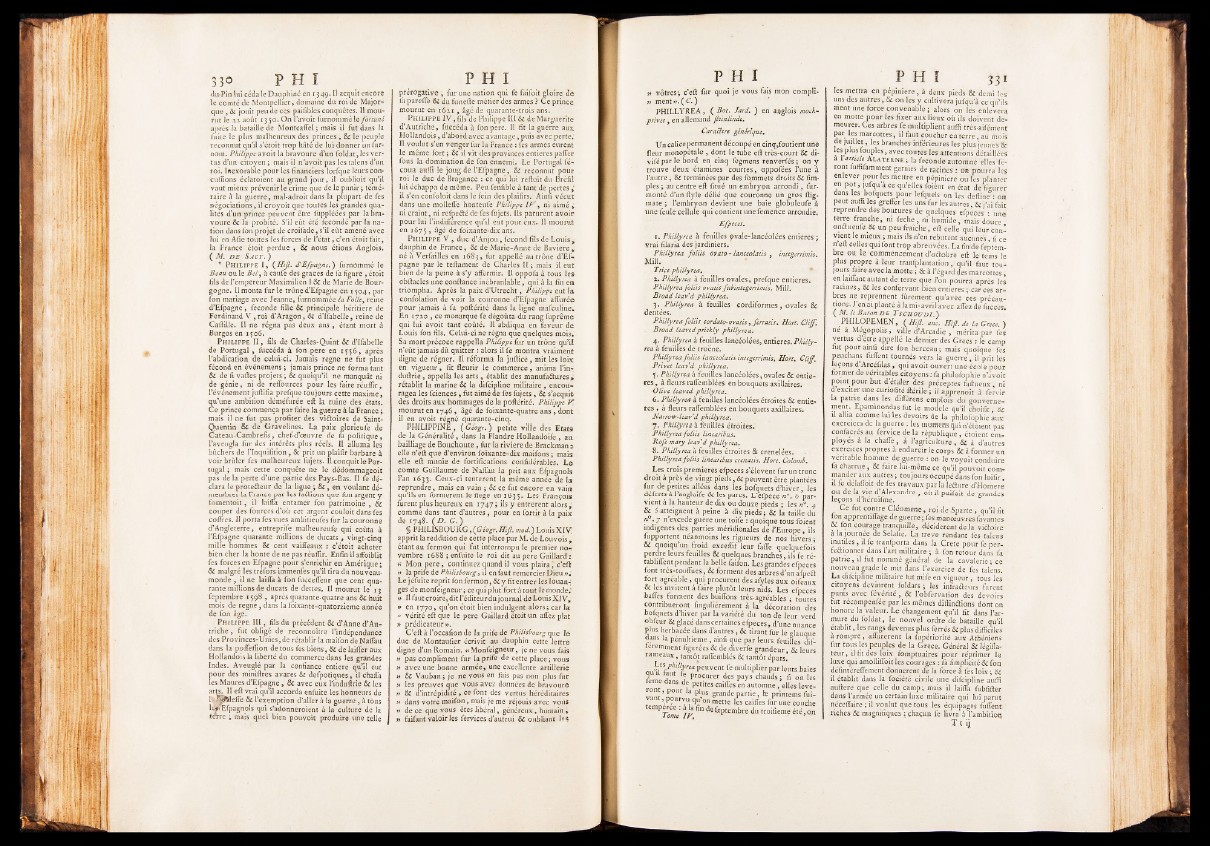
ë '
1 1
1^'«
■ ; ; r 1 f» ■
r-
*
’ i
■ 1
$ ^ ' ' 1
■^1
S fr ' '
1 1 ’
I h ‘11
1 '^ ' ! ( •
330 P H Î
du-Pln lui coda le Dauphine en r 349- acquit encore
le comté de Montpellier, domaine du roi de Majorque
, & jouit pende ces pailibles conquêtes. Il mourut
le i z août 1350. On l’avolt furnommé le fo rtun e
apres la bataille de MontcalTel ; mais il fut dans la
fuite le plus malheureux des princes , 6^ le peuple
reconnut qu'il s’étoit trop hâté de lui donner un üir-
nom. P h ïlip p i avoit la bravoure d’un foldat, les vertus
d’un citoyen ; mais il n’avoit pas les talens d’un
roi. Inexorable pour les financiers lorfque leurs con-
culfions éclatoient au grand jour, il oublioit qu’il
vaut mieux prévenir le crime que de le punir ; téméraire
la guerre, mal-adroit clans la plupart de fes
négociations, il croyoit que toutes les grandes qualités
d’un prince peuvent être fuppléées par la bravoure
& la probité. S’il eût été lecondé par la nation
dans (on projet de croifade, s’il eût amené avec
lui en Alie toutes les forces de l’état, c’en étoit fait,
la France étoit perdue , & nous étions Anglois.
( M. D E S a c y . )
* P h i l i p p e I, d’E fp a g n c .) furnommé le
Beau ou le S e f caufe des grâces de fa figure , étoit
fils de l'empereur Maximilien I & de Marie de Bourgogne.
Il monta fur le trône d’Efpagne en 1504, par
fon mariage avec Jeanne, furnommée la FolU^ reine
d’Efpagne, fécondé fille & principale héritière de
Ferdinand V , roi d’Aragon, & d’ifabelle, reine de
Caftille. Il ne régna pas deux ans , étant mort à
Burgos en 1506,
P h i l i p p e II, fils de Charles-Quint & d’ifabelle
de Portugal , fuccéda à fon pere en 1556, après
l’abdication de celui-ci. Jamais régné ne fut plus
fécond en événemens ; jamais prince ne forma tant
S i de fl vafles projets ; & quoiqu’il ne manquât ni
de génie, ni de relToiirces pour les faire réulTir,
l’événement juflifia prefque toujours cette maxime,
qu’une ambition déméfurée eft la ruine des étais.
Ce prince commença par faire la guerre à la France ;
mais il ne fut pas profiter des viéloires de Saint-
Quentin Ôc de Gravelines. La paix glorieufe de
Cateau'Cambrefis, chef-d’oeuvre de fa politique,
l’aveugla fur des intérêts plus réels. Il alluma les
bûchers de l'Inqtiifition , & prit un plallir barbare à
voir briller les malheureux fujets. Il conquit le Portugal
; mais cette conquête ne le dédommageoit
pas de la perte d’une partie des Pays-Bas. II fe déclara
le proteéfeur de la ligue 3 &, en voulant démembrer
la France par les f'aéUons que fon argent y
fomentoit, il laiffa entamer fon patrimoine , &c
couper des fources d’oii cet argent couloit dans lés
coffres. 11 porta fes vues ambitieiifes fur la couronne
d’Angleterre, entreprife malheureufe qui coûta à
l'Efpagne quarante millions de ducats , vingt-cinq
mille hommes ôc cent vailTeaux : c’étoit acheter
bien cher la honte de ne pas réulTir. Enfin il affoiblit
fes forces en Efpagne pour s’enrichir en Amérique ;
6c malgré les tréfors immenfes qu’il tira du nouveau-
monde , il ne laifla à fon fucceffeur que cent quarante
millions de ducats de dettes. Il mourut le 13
feptembre 1598 , après quarante-quatre ans & huit
mois de régné , dans la foixante-quatorzieme année
de fon âge.
P h i l i p p e III, fils du précédent & d’Anne d’Autriche
, fut obligé de reconnoître l’indépendance
des Provinces-Unies, de rétablir la maifon de NalTaii
dans la poffefTion de tous lés biens, & de laiffer au.x
Hollandois la liberté du commerce dans les grandes
Indes. Aveuglé par la confiance entière qu’il eut
pour des miniflres avares & defpotiques, il chaffa
les Maures d’Efpagne, & avec eux l’induflrie & les
art^ Il eft vrai qu’il accorda enluite les honneurs de
I ^^leffe & l’exemption d’aller â la guerre , h tous
Icf'Elpagnols qui s’adonneroient à la culture de la
terre j mais quel bien pouvoit produire une telle
P H I prérogative , fur une nation qui fe falfoit gloire de
ia parelle & du funefle métier des armes ? Ce prince
mourut en i6 i i , âgé de quarante-trois ans.
Ph il ip p e IV , fils de Philippe III Sc de Marguerite
d’Autriche, fuccéda à fon pere. 11 fît la guerre aux
Hollandois, d’abord avec avantage, puis avec perte.
Il voulut s’en venger fur la France : fes armes eurent
le même fort 3 6c il vit des provinces entières paffer
fous la domination de fon ennemi. Le Portugal fé-
coua aufîi le joug de l’Elpagne, & reconnut pour
roi le duc de Bragancc : ce qui lui reftoit du Bréfîl
lui échappa de meme. Peu fenfîble à tant de pertes
il s’en confoloit dans le léin des plaifîrs. Ainfî vécut
dans une molleffe honteufe FhUippe I V , ni aimé,
ni craint, ni refpeûé de fes fujets. lis parurent avoir
pour lui l’indilFérence qu’il eut pour eux. 11 mourut
en 1675, foixante-dix ans.
Ph il ip p e V , duc d’Anjou, fécond fîls de Louis,
dauphin de France, 6c de Marie-Anne de Bavière,
né à Verfailles en 1683, fut appelle au trône d’Efpagne
par le tefîament de Charles II; mais il eut
bien de la peine à s’y aftérmir. Il oppofa à tous les
obflncles une conllance inébranlable, qui à la fin en
triompha. Après la paix d’Utrecht, /’/zi/.'/’/.; eut la
conlülation de voir la couronne d’Efpagne affuréo
pour jamais à fa poflérité dans la ligne mafciiline.
En 1720 , ce monarque fe dégoûta du rang fuprême
qui lui avoit tant coûté. 11 abdiqua en faveur de
Louis fon fîls. Celui-ci ne régna que quelques mois.
Sa mort précoce rappella Philippe fur un trône qu’il
n’eût jamais dû quitter : alors il fe montra vraiment
digne de régner. II réforma la jufîice, mit les loix
en vigueur, fit fleurir le commerce, anima l’in-
dufîrie, appella les arts , établit des manufaéfures*
rétablit la marine Ôc la difeipline militaire , encouragea
les fciences , fut aimé de fes fujets , 6c s’acquit
des droits aux hommages de la poflérité. Philippe V
mourut en 1746 , âgé de foixante-quatre ans , dont
il en avoit régné quarante-cinq.
PHILIPPINE, (^Géogr.') petite ville des Etats
de la Généralité, dans la Flandre Hollandoife , au
bailliage de Bouchoute , fur la riviere de Brackman 5
elle n’eft que d’environ foixante-dix mailbns ; mais
elle efl munie de fortifications confîdérables. L©
comte Guillaume de NafTau la prit aux Efpagnols
l’an 1633. Ceux-ci tentèrent la même année de la
reprendre, mais en vain ; 6c ce fut encore en vaia
qu’ils en formèrent le fiege en 1635. Les François
furent plus heureux en 1747; ils y entrèrent alors,'
comme dans tant d’autres , pour en fortir à la paix
de 1748. (/>. G .)
§ PHILISBOURG , ( G t ; o g r . rnod.') LouisXIVI
apprit la reddition de cette place par xM, de Louvois ,
étant au fermon qui fut interrompu le pre.mier novembre
i688 ;enfuite le roi dit au pere Gaillard :
« iMon pere, continuez quand il vous plaira, c’efl:
>♦ la prife de Philisbourg, il en faut remercier Dieu».
Le jéfuite reprit fon fermon, 6c y fît entrer Iss louan-;
ges de monfeigneur ; ce qui plut fort à tout le monde,
» II faut croire, dit l’éditeur du journal de Louis XIV,
» en 1770, qu’on étoit bien indulgent alors ; car la
" vérité efl que le pere Gaillard étoit un alTez plac
» prédicateur».
C’efl à l’occafion de la prife de Philisbourg que le
duc de Montaufîer écrivit au dauphin cette lettre
digne d’un Romain. « Monfeigneur, je ne vous fais
» pas co.mpliment lur la prife de cette place ; vous
» avez une bonne armée, une excellente artillerie
» 6c Vauban ; je ne vous en fais pas non plus fur
» les preuves que vous avez données de bravoure
» 6c (l’intrépidité , ce font des vertus héréditaires
» dans votre maifon, mais je me réjouis avec vous
*> de ce que vous êtes libéral, généreux, humain ,
» faifant valoir les fervices d’autrui 6c oubliant les
P H I
» vôtres; c’efl fur quoi je vous fais mon compH-
» ment ». ( C. )
PHILLYREA, ( Bot. Jard. ) en aqglois moek-
privet, en allemand fkinlinde.
Caractère générique.
Un caiieepermanent découpé en cinq,foutient une
fleur monopétale , dont le tube efl très-court 6c di-
vilé par le bord en cinq fegmens renverfés ; on y
trouve deux étamines courtes, oppofées l’une à
l’autre, 6c terminées par des fo.mmets droits 6c Amples
; au centre eft fitué un embryon arrondi, fur-
monté d’un flyle délié que couronne un gros flig.
mate ; l’embryon devient une baie globuleufe à
une feule cellule qui contient une femence arrondie.
Efpeces.
1. P hilly na à feuilles ovale-IancéoIées entières ;
vrai fîlaria des jardiniers.
Phillyrea foUis oyato-lanaolaùs y incegerrirnis.
Mill.
Trice phillyrea.
2. Phillyrea à feuilles ovales, prefque entières.
Phillyrea folds ovatis fiibintegerrimis. Mill.
Broad leav'd phillyrea.
3. Phillyrea à feuilles cordiformes , ovales 5c
dentées.
Phillyrea folds cordato-ovatis y ferratis. Hort. Cliff".
Broad Leaved prickly phillyrea.
4. Phillyrea à feuilles lancéolées, entières. Philly^
tea à feuilles de troène.
Phillyrea folds lanceolatis integerrimis. Hort. Cliff.
Privet Uav d phillyrea.
5. Phillyreak feuilles lancéolées, ovales 6c entières
, à fleurs raffemblées en bouquets axillaires.
Olive leaved phillyrea.
6. Phillyrea à feuilles lancéolées étroites 6c entières
, à fleurs raflemblées en bouquets axillaires.
Narrow-leav'd phillyrea.
7. Phillyrea à feuilles étroites.
Phillyrea foliis linearibus.
Rofe mary leav'd phillyrea.
8. Phillyrea à feuilles étroites & crenelées.
Phillyrea foliis linearibus crenads. Hort. Colomb.
Les trois premieres efpeces s’élèvent fur un tronc
droit a près de vingt pieds, 6c peuvent être plantées
fur de petites allées dans les bofqiiets d’hiver, les
déferts à l’angloife 6c les parcs. L’efpece n'^. C parvient
à la hauteur de dix ou douze pieds ; les n°. 4
& 5 atteignent à peine à dix pieds ; & la taille du
tP’ 7 n excede guere une toife ; quoique tous foient
indigenes des^ parties méridionales de l’Europe, ils
fupportent neanmoins les rigueurs de nos hivers ;
6c quoiqu’un froid exceffîf leur faffe quelquefois
perdre leurs feuilles 8c quelques branches, ils fe ré-
tabliffent pendant la belle falfon. Lesgrandes efpeces
font trcs-toiiffiies, 6c forment des arbres d’un afueft
fort agréable , qui procurent des afyles aux oifeaux
ôc les invitent â faire plutôt leurs nids. Les efpeces
baffes forment des buiffons très-agréables ; toutes
contribueront fînguiiérément à la décoration des
bofquets d’hiver par la variété du ton de leur verd
obfcur 6c glacé dans certaines efpeces, d’une nuance
ph's herbacée dans d’autres , 6c tirant fur le glauque
dans la pénultième , ainfî que par leurs feuilles différemment
figurées 6c de diverfe grandeur, 6c leurs
rameaux , tantôt raffemblés 6c tantôt épars.
P^^vent fe multiplier par leurs baies
q raut le procurer des pays chauds ; fl on les
cme ans de petites caifles en automne, elles leve-
grande partie, le primems fui-
, p^ urvii qu on mette les caifTes fur une couche
^^'''^Tome l y du troifieme été,on
P H I 3 3 1
les mettra en pépinière, à deux pieds & demi les
uns des autres, 6c on les y cultivera jufqu’â ce qu’ ils
aient une force convenable ; alors on les enlèvera
en motte pour les fixer aux lieux où ils doivent demeurer.
Ces arbres fe multiplient aiiflî tres-aifément
P^F marcottes, il faut coucher en terre, au mois
de juillet, les branches inférieures les plus jeunes 6c
les plus toupies, avec toutes les attentions détaillées à I Alaterne ; la fécondé automne elles feront
lufîilamment garnies de racines : on pourra les
enlever pour les mettre en pépinière ouïes planter
en pot, ju qu à ce quelles lôlènt en état de figurer
dans les bolquets pour lefquels on les defline : on
peut auffi les greffer les uns fur les autres, & j’-fi fait
reprendre des boutures de quelques efpeces • une
terre franche, ni feche, ni humide, mais douce
onéfueulc 6c un peu fraîche, efl celle qui leur convient
le mieux ; mais ils n’en rebutent aucunes, fi ce
n eft celles qui font trop abreuvées. La fin de feptembre
ou le commencement d’oefobre eft le tems le
plus propre à leur tranfplantarion , qu’il faut toujours
faire avec la motte ; 6c à l’égard des marcottes ,
en lailTant autant de terre que l’on pourra après les
racines, 6c les conlervant bien entières ; car ces arbres
ne reprennent fûrement qu’avec ces précautions.
J en ai planté a la mi-avnl avec aflez de fucccs.
M. U Baron DE T s CH O U D l )
PHILÜPEMEN, fW j i . ar^c. Hiß. de la Grèce. )
ne à xMégopoIis, ville d’Arcadie , mérita par l'es
vertus d etre appelle le dernier des Grecs .■ le camp
fut pour ainfî dire Ion berceau; mais quoique fes
penchans fuffent tournés vers la guerre, il prit les
leçons (1 Arcéfilas , qui avoit ouvert une école pour
former de véritables citoyens ; fa philofophie n’avoit
point pour but d’étaler des préceptes faflueux ni
d’exciter une curiofiré flérile ; il apprenoit .à fervir
la patrie dans les difiérens emplois du gouvernement.
Epaminondas fut le modele qu'il choifit,
il allia comme lui les devoirs de la philofophie aux
exercices de la guerre : les momens qui n’étoient nas
confacrésaii fervice de la république, étoient employés
à la chalTe, à l’agriculture, 6c à d’autres
exercices propres à endurcir le corps & à former im
véritable homme^ de guerre : on le voyoït conduire
fa charrue , ôc faire lui-même ce qu’il pouvoit commander
aux autres ; toujours occupé dans fon loifir,
il fe délafioit de fes travaux par la leaure d’Homere
ou de la vie d’Alexandre , où il puifolt de grandes
leçons d’héroïlme.
Ce fut contre Clcomene, roi de Sparte , qu’il fît
fon apprentiflage de guerre; fes manoeuvres favantes
6c fon courage tranquille, décidèrent de la viifloire
à la journée de Selalie. La treve rendant fes talens
inutiles , il fe tranfporta dans la Crete pour fe per-
feéfionnei dans lart militaire ; à fon retour dans la
patrie, il fut nommé général de U cavalerie; ce
nouveau grade le mit dans l’exercice de fes talens.
La difeipline militaire hit mife en vigueur, tous les
citoyens devinrent foldats ; les infraaeurs furent
punis^ avec févérité , & l’obfcrvation des devoirs
fut rccompenfee par les memes diflinaions dont on
honore la valeur. Le changement qu’il fit dans l’armure
du (ôldat, le nouvel ordre de bataille qu'il
établit, les rangs devenus plus ferrés & plus difficiles
à rompre, affurerent la fupériorité aux Athéniens
fur tous les peuples de la Grèce. Général 6c Jégifla-
teur, il fit des loix fomptuaires pour réprimer le
luxe qui amolliflbit les courages ; là fimplicitéÔcfon
défmtéreflèment donneront de la force h. fes loix ; &
il établit dans la fociété civile une difeipline auflt
auflere que celle du camp; mais il laifla fubfifler
dans l’armée un certain luxe militaire qui lui parut
néceffaire;il voulut que tous les équipages fiiflént
riches 6c magnifiques : chacun fe livra à l’ambition
T = i j