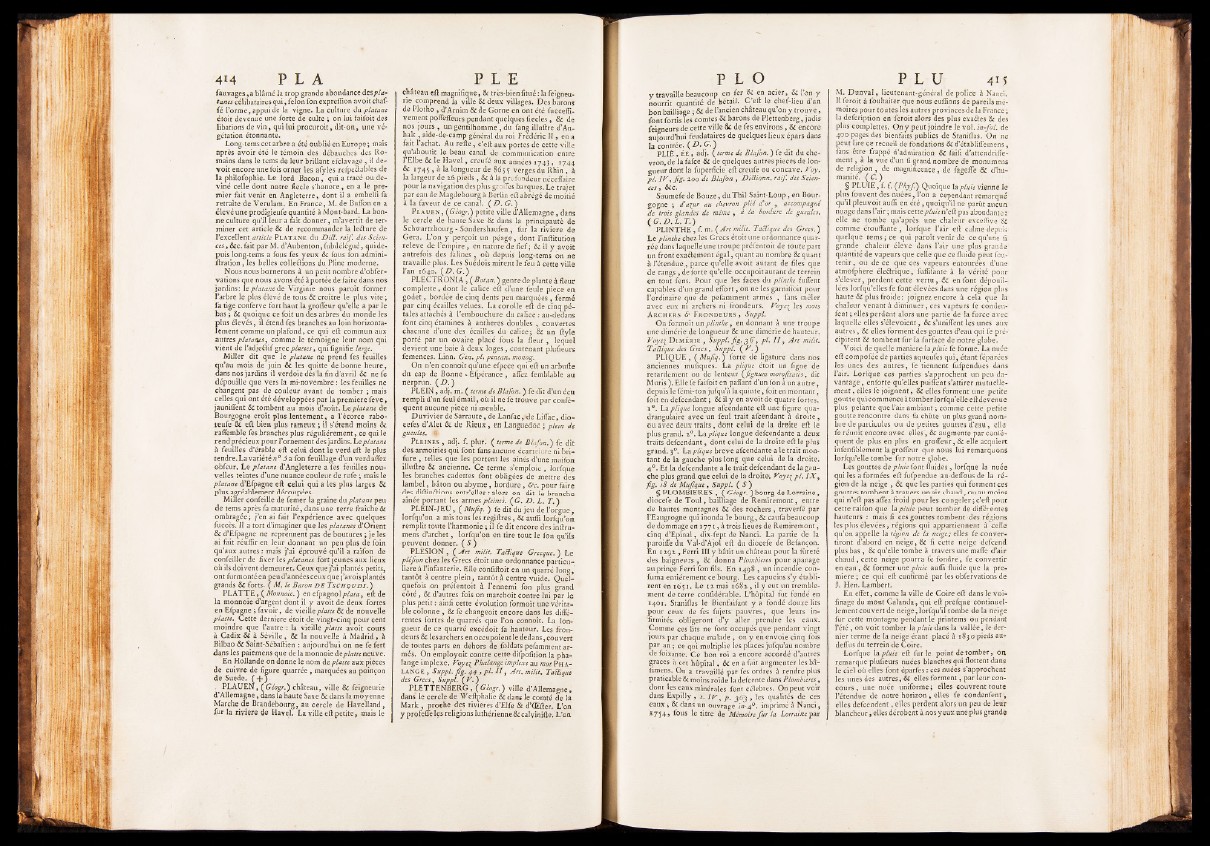
.■•ij ' ' S
-M,
lira ' I -H| hi
- !■ ' • <i
% S;',;
' «'AÎ i!ll • ^ 11
M
; Ir
k
4 hi
414 P L A fauvages,a blâmé la trop grande abondance des^/a-
tam s célibataires qui, felon fon exprelTion avoir chaf-
fc l’orme, appui de la vigne. La culture du p la tam
étoit devenue une forte de culte ; on lui fail'oit des
libations de vin, qui lui procuroit, dit-on, une végétation
étonnante.
Long-tems cct arbre a été oublié en Europe ; mais
après avoir été le témoin des débauches des Romains
dans le tems de leur brillant efclavage, il devoir
encore unetbisorner les afyles relpcélables de
la philofophie. Le lord Bacon, qui a tracé ou deviné
celle dont notre fiecle s’hoitore, en a le premier
fait venir en Angleterre, dont il a embelli fa
retraite de Vernlam. En France, M. de Bufîbn en a
élevé une prodigieufe quantité à Mont-bard. La bonne
culture qu’il leur a fait donner, m’avertit de terminer
cet article & de recommander la îefture de
l’excellent article Platane du D i ü . raif. des Scien ces
, 6cc. fait par M. d’Aubenton, fubdclcgué, quide-
puis long-tems a fous fes yeux & fous Ion admini-
llratlon , les belles collerions du Pline moderne.
Nous nous bornerons à un petit nombre d’obfer-
vations que nous avons été à portée de faire dans nos
jardins; U plaçant d t Virginie nous paroît former
l’arbre le plus élevé de tous & croître le plus vite ;
fa fige conferve fort haut la grofleur qu’ elle a par le
bas ; & quoique ce foit un des arbres du monde les
plus élevés, il étend fes branches au loin horizontalement
comme un plafond, ce qui eR commun aux
autresplata/vs^ comme le témoigne leur nom qui
vient de l’adjeélif grec p la tée s, qui fignifie lar^e.
Miller dit que le platane ne prend fes feuilles
qu’au mois de juin & les quitte de bonne heure,
dans nos jardins il verdoie dès la fin d’avril & ne fe
dépouille que vers la mi-novembre : les feuilles ne
changent pas de couleur avant de tomber ; mais
celles qui ont été développées par la premiere fev e,
jaunilTent & tombent au mois d’août. Le platane de
Bourgogne croît plus lentement, a l’écorce rabo-
teufe & eft bien plus rameux ; il s’étend moins &
raffemble fes branches plus régulièrement, ce qui le
rend précieux pour l’ornement des jardins. Le platane
à feuilles d’érable eft celui dont le verd eft le plus
tendre. La variété n'* 5 z. fon feuillage d’un verd aflez
obfcLir. Le pla tan e d’Angleterre a fes feuilles nouvelles
teintes d’une nuance couleur de rofe ; mais le
platan e d’Efpagne eft celui qui a les plus larges &
plus agréablement découpées.
Miller confeille de femer la graine du platan e peu
de tems après fa maturité, dans une terre fraîche &
ombragée; j’en ai fait l’expérience avec quelques
fuccès. Il a tort d’imaginer que les platanes d’Orient
& d’Efpagne ne reprennent pas de boutures ; je les
ai fait reufiir en leur donnant un peu plus de foin
qu’aux autres ; mais j’ai éprouvé qu’il a raifon de
confeiller de fixer les platanes fort jeunes aux lieux
où ils doivent demeurer. Ceux que j’ai plantés petits,
ont furmontéen peu d’années ceux que j’avois plantés
grands & forts. ( M . le Baron d e T s c h o u d i . )
PLATTE, en efpagnol/’/d/û, eft de
la monnoie d’argent dont il y avoit de deux fortes
en Efpagne ; favoir, de vieilleplatie & de nouvelle
f la t t e . Cette derniere étoit de vingt-cinq pour cent
moindre que l’autre : la vieille f la t te avoit cours
à Cadix ôc à Séville, & la nouvelle à Madrid, à
Bilbao &Saint*Sébaftien : aujourd’hui on ne fe fert
dans les paiemens que de la monnoie de p la n e neuve.
En Hollande on donne le nom de plaite aux pieces
de cuivre de figure quarrée , marquées au poinçon
de Suede. ( - f )
, PLAUEN, (^Géogr.') château, ville & feigneurie
d’Allemagne, dans la haute Saxe & dans la moyenne
Marche de Brandebourg, au cercle de Havelland ,
fur la riviere de Havel. La ville eft petite, mais le
P L E chateau eft magnifique, & îrès-bienfituc: la feigneurie
comprend la ville & deux villages. Des barons
de Plotho , d’Arnim &de Gorne en ont été fiiccefti-
vement poffefleurs pendant quelques fiecles , & de
nos jours , un gentilhomme , du fang illuftre d’An-
ha lt, aide-de-camp général du roi Frédéric I I , en a
fait 1 achat. Au relie, c’eft aux portes de cette ville
qu’aboutit le beau canal de communication entre
l’Elbe 6c le Havel, crciifc aux années 1743, 1744
& 1745, à la longueur de 865 5 verges du Rhin , à
la largeur de 26 pieds , & à la pi\ f ndeur nccefiaire
pour la navigation des plus groifes barques. Le trajet
par eau de Magdeboiirgà Berlin eft abrégé de moitié
à la faveur de ce canal. ( D . G . )
Pl a u en , (Géogr.) petite ville d’Allemagne , dans
le cercle de haute Saxe 6c dans la principauté de
Schv-artzbourg - Sondershaufen , fur la riviere de
Géra. L’on y perçoit un péage, dont l’inftitution
releve de l'empire , en nature de fief ; 6c il y avoit
autrefois des falines , où depuis long-tems on ne
travaille plus. Les Suédois mirent le feu à cette ville
l’an 1640. (Z>. G .)
PLECTRONIA , (^Botan.') genrede plante à fleur
completie, dont le calice eft d’une feule piece en
godet, bordée de cinq dents peu marquées , fermé
par cinq écailles velues. La corolle eft de cinq pétales
attachés à remboiichure du calice : au-dedans
font cinq étamines à aniheres doubles , couvertes
chacune d’une des écailles du calice; 6c un ftyle
porté par un ovaire placé fous la fleur , lequel
devient une baie ;i deux loges, contenant plufieurs
femences. Linn. Gen. p i . pentan. monog.
On n’en connoît qu’une efpcce qui eft un arbiifte
du cap de Boune - Efpérance , alTez femblable au
nerprun. ( .D. )
PLEIN, adj. m. ( terme de B la fo n . ) fe dit d’un ccu
rempli d’un foui émail, où il ne fe trouve par confé-
quent aucune piece ni meuble.
Duvivier de Sarraute , de Lanfac, de LilTac, dio-
cefes d’Alet 6c de Rieux, en Languedoc ; plein de
gueules. '•
Pleines , adj. f. plur. ( terme de B la fo n .) fc dit
des armoiries qui font fans aucune écansiLire ni bri-
fure , telles que les portent les aînés d’une maiion
illuftre 6c ancienne. Ce terme s’emploie , lorfque
les branches cadettes font obligées de mettre des
Ïambe!, bâton ou abyme , bordure , & c . pour faire
des diftinclions entr’elles ; alors on dit la branche
aînée portant les armes pleines. (G . D . L . T . )
PLEIN-JEU, (^M u fiq .) lé dit du jeu de l’orgue ,
lorfqu’on a mis tous les regiftres, 6c aulTi lorfqu’on
remplit toute l’harmonie ; il fe dit encore des inftru-
mens d’archet, lorfqu’on en tire tout le fon qu’ils
peuvent donner. ( '■^ )
PLÉSION , ( A n milit. TaHlque Grecque. ) Le
pUfion chez les Grecs étoit une ordonnance particii-
licre â l’infanterie. Elle conliftoit en un quarre long,
tantôt à centre plein, tantôt à centre vuide. Quelquefois
on préfentoit à l’ennemi fon plus grand
côté , 6c d’autres fois on marchoit contre lui par le
plus petit : ainfi cette évolution formoit une véritable
colonne , & fe changeoit encore dans les différentes
fortes de quarrés que l’on connoît. La longueur
de ce quarre excédoit fa hauteur. Les frondeurs
6c lesarchers en occupoient le dedans, couvert
de toutes parts en dehors de foldats pefamment armés.
On employoit contre cette difpofnion la phalange
implexe. Voyeq^ Phalange implexe au mot Phalange
, S u p p l, fig . 44 3 p l . I l , A r t, milit. Tactique
des Grecs 3 S u p p l. ( ^ 0
PLETTENBERG, (^Geogr.) ville d’Allemagne,
dans le cercle de Weftphalie & clan« le comté de la
Mark , proche des rivieres d’Elfe & d’CEfter. L’on
y profelfe les religions luthérienne 6ccalvinifte. L’on
. ' I l i
P L O y travaille beaucoup en fer 6c en acier, 6c l'on y
nourrit quantité de bétail. C^’eft le chef-lieu d’un
bon bailliage ; 6c de l’ancien château qu’on y trouve,
font fortis les comtes 6c barons de Plettcnberg, jadis
feigneurs de cette ville & de fes environs , 6c encore
aujourd’hui feudataires de quelques lieux épars dans
la contrée. ( Z?. G. )
PLIÉ , ÉE , adj. ( terme de B la fo n . ) fe dit du chevron,
de la fafee ÔC de quelques autres pieces de longueur
dont la fuperficie eft creufe ou concave. Voy.
p i. I V 3 f ig . 200 de B la fo n , D ic lio n n . raif. des S c ien ces
, 6cc.
Saumefede Bouze, duThil Saint-Loup, en Bourgogne
; d'azur au chevron p lié d ’or , accompagné
de trois glandes de même 3 à la bordure de gueules.
( G. D . L . T . )
PLINTHE, f. m. {^An milit. Tactique des G r e c s.)
Le plinthe chez les Grecs étoit une ordonnance quar-
rce dans laquelle une troupe préfentoit de toute part
un front exaéfement égal, quant au no.mbre 6cquant
à l'étendue , parce qu’elle avoit autant de files que
de rangs , de forte qu’elle occupoit autant de terrein
en tout fens. Pour que les faces du plinthe fuftent
capables d’un grand effort, on ne les garnifibit pour
l’ordinaire que de pefamment armés , fans mêler
avec eux ni archers ni frondeurs. Voye'^ les mots
A r c h e r s & Fr o n d e u r s , S uppl.
On formoit un plinthe 3 en donnant a uns troupe
une dimerie de longueur 6c une dimene de hauteur.
F o y e iD lM É R lE , S u p p l, fig . ^ 6 3 p l . / / , A r t milit.
Taclique des Grecs , S u p p l. ( ^- )
PLIQUE , {M u j îq . ) forte de ligature dans nos
anciennes mufiqiies. La plique étoit un ligne de
retardement ou de lenteur (^(ignum morofitatis3 dit
Mûris ). Elle fe faifoit en paffant d’un fon à un autre,
depuis le fémi-ton jufqu’à la quinte, foit en montant,
foit en defeendant ; 6c il y en avoit de quatre fortes.
1®. La plique longue afeendante eft une figure qua-
dranguiaire avec un feul trait afeendant à droite,
ou avec deux traits , dont celui de la droite eft' le
plus grand. 2°. La plique longue defeendante a deux
traits defeendant, dont celui de la droite eft le plus
grand. 3°. La plique breve afeendante a le trait montant
de la gauche plus long que celui de la droite.
4°. Et la defeendante a le trait defeendant de la gauche
plus grand que celui de la droite. Voyn^ pl. /-Y,
f ig . 18 de Mufique , S u p p l. ( 6' )
§ PLOMBIERES , ( Géogr. ) bourg de Lorraine,
diocefe de T ou l, bailliage de Remiremont, entre
de hautes montagnes 6c des rochers , Iraverfé par
l’Eaugrogne qui inonda le bourg, 6c caufabeaucoup
de dommage en 17 7 1 , à trois lieues de Remiremont,
cinq d’Epinal, dix-fept de Nanci. La partie de la
paroifTe du Val-d’Ajol eft du diocefe de Befançon.
En I 292 , Ferri III y bâtit un château pour la fureté
des baigneurs , 6c donna Plombières pour apanage
au prince Ferri fon fils. En 1498, un incendie con-
fiima entièrement ce bourg. Les capucins s’y établirent
en 1651. Le 11 mai 1682 , il y eut un tremblement
de terre confidérable. L’hôpitaJ fut fondé en
1401. Sraniflas le Bicnfaifant y a fondé douze lits
pour ceux de fes fujets pauvres, que leurs infirmités
obligeront d’y aller prendre les eaux.
Comme ces lits ne font occupés que pendant vingt
jours par chaque malade , on y en envoie cinq fois
par an ; ce qui multiplie les places jufqu’au nombre
de foixante. Ce bon roi a encore accordé d’autres
graces à cet hôpital , 6c en a fait augmenter tes bâ-
timens. On a travaillé par fes ordres à rendre plus
praticable ôi moins roide la defeente dans Plombières,
dont les eaux minérales font célébrés. On peut voir
dans Expilly , t. [ v ^ j(5j , les qualités de ces
eaux , 6i clans un ouvraee in-afi. imprime à Nanci,
■ *7 5 4 > le titre de 'M émoire f u r la Lorraine par
P L U 415
M. Diinval, lieutenant-général de police à Nanci.
I! feroit à fouhaiter que nous enflions de pareils mémoires
pour toutes les autres provinces de la France ;
la defeription en feroit alors des plus exactes & des
plus complettes. On y peut joindre le v o \ .in - fo l. de
400 pages des bienfaits publics de Stanillas. On ne
peut lire ce recueil de fondations 6i d’établifTemens ,
lans être frappé d’admiration & laifi d’attendrifie-
ment, à la vue d’un fi grand nombre de monumens
de religion , de magnificence , de fagefle & d’humanité.
( G. )
§ PLUIE, f. f. {P h y f .) Quoique la pluie vienne le
plus fouvent des nuées, l’on a cependant remarqué
qu’il pleuvoir auflî en été, quoiqu’il ne parut aucun
nuage dans l’air ; mais cette p lu ie n’eft pas abondante :
elle ne tombe qu’après une chaleur excelTive de
comme ctoufl'ante , lorfque l’air eft calme depr.ls
quelque tems ; ce qui paroît venir de ce qu’une fi
grande chaleur éleve dans Pair une plus grande
quantité de vapeurs que celle que ce fluide peut fou-
tenir, ou de ce que ces vapeurs entourées d’une
atmofphere éleélriquc, fufltlântc à la vérité pour
s’élever, perdent cette vertu, 6c en font dépouillées
lorl'qu’elles fe font élevées dans une région plus
haute & plus froide: joignez encore à cela que la
chaleur venant â diminuer, ces vapeurs fe conden-
fent ; elles perdent alors une partie de la force avec
laquelle elles s’élevoient, 6c s’unilTent les unes aux
autres , 6c elles forment des gouttes d’eau qui fe précipitent
& tombent fur la furface de notre globe.
Voîci de quelle maniéré la pluie fe forme. La nuée
eft compofée de parties aqueufes qui, étant fcparées
les unes des autres, fe tiennent fufpendues dans
Pair. Lorfque ces parties s’approchent un peu davantage
, enlorte qu’elles puilTent s’attirer rautuelle-
ment, elles fe joignent, 6c elles forment une petite
goutte qui commence à tomber lorfqu’elle eft devenue
plus pefante que l’air ambiant ; comme celte petite
goutte rencontre dans fa chute un plus grand nombre
de particules ou de petites gouttes d’eau , elle
fe réunir encore avec elles, 6i augmente par confo-
quent de plus en plus en grolTeur, elle acquiert
inl'enfiblement lagrolfeur que nous lui remarquons
lorfqu’elle tombe fur notre globe.
Les gouttes de font fluides , lorfque la nuée
qui les a formées eft fufpendue au-defToiis de la région
de la neige , 6d que les parties qui forment ces
gouttes tombent à travers un air chaud, ou au moins
qui n’eft pas affez froid pouiTes congeler; c’eft pour
cette raiiôn que la p lu ie peut tomber de différentes
hauteurs : mais fi ces gouttes tombent des régions
les plus élevées, régions qui appartiennent à celle
qu’on appelle la région de la neige; elles fe convertiront
d'abord en neige, 6c fi cette neige defeend
plusbas, 6c qu’elle tombe à travers une malTe d’air
chaud, cette neige pourra fe fondre, fe convertir
en eau , 6c former une pluie aulfi fluide que la première
; ce qui eft confirmé par les obfervations de
J. Hen. Lambert.
En effet, comme la ville de Coire eft dans le vol-
finage du mont Calanda, qui eft prefque continuellement
couvert de neige, lorfqu’il tombe de la neige
fur cette montagne pendant le printems ou pendant
l’été , on voit tomber la pluie dans la vallée, le dernier
terme de la neige étant placé â 1830 pieds au-
delfus du terrein de Coire.
Lorfque \z p lu ie eft furie point de tomber, on
remarque plufieurs nuées blanches qui flottent dans
le ciel où elles font éparfes : ces nuées s’approchent
les unes des autres, 6c elles forment, par leur concours
, une nuée uniforme; elles couvrent toute
l’étendue de notre horizon , elles fe condenfent,
elles defeendent, elles perdent alors un peu de leur
blancheur, elles dérobent à nos yeux une plus grande
m