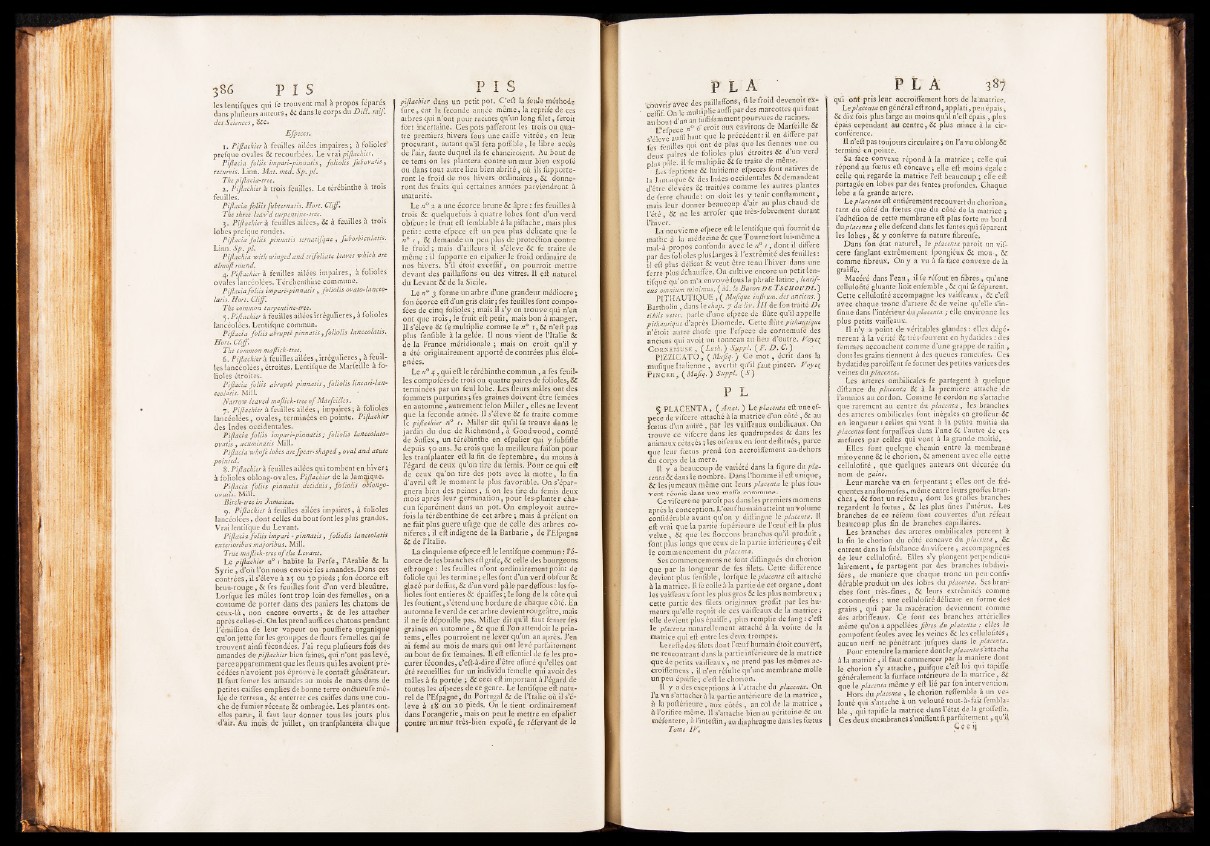
'î'Ifî
I t s
Hi l l tf ?'-jf
, w in
l i r f
>86 P I S les lentlfques qui trouvent mal à propos féparés
dans plurieui'S auteurs, & dans le corps du Dûi, vaij,
des Sciences, &LC.
Efpcccs.
1. Piflachierk feuilles allées impaires; à folioles
prel'que ovales & recourbées. Le v ra ipijl.ichkr.
PifLicin foiiis impari-plnnaCis ^ folioÜs fubovuiis,
recurvis. Linn. Mat. med, Sp. pl,
The pijluicia-tree.
2. Ptjlachier à trois feuilles. Le térébiathe trois
feuilles.
Pijîucia follis fubternatis. Mort. Cllf.
The three leaved turpentine-trec.
3. P'ijiiichïer Z feuilles ailées, à feuilles à trois
lobes profquc rondes.
Pilhida ‘joliis pinnatis tcrnatlfque , fuborbiculatis.
Sp. pL
Pijiachuî with winded and trifoliate leaves which are
almoji round.
4. Pif.ichicr k feuilles allées Impaires, à folioles
ovales lancéolées. Tércbenthme comimme.
Pijîacia follis impari-pinnatis , foliolis ovato-lando-
lacis. Hort. Cliff.
The common turpentine-tree.
5. P if adder à feuilles ailées irrégulières, à folioles
lancéolées. Lentifque commun.
P fa d a folds abruptb pinnatis, foliolis lanceolaùs.
Hort. Cliff.
The common mafick-tru.
6. Piflachier à feuilles ailées, irrégulières , à feuilles
lancéolées, étroites. Lentilque de Marfeille à folioles
étroites.
P fa d a folds abrupt^ pinnatis., foliolis lineari-lan-
ceolatis. Mill.
Narrow leaved mafick-tree o f MarfdlUs.
7. P f adder à feuilles ailées, impaires ; à folioles
lancéolées, ovales, terminées en pointe. Piflachier
des Indes occidentales.
P facia folds impari-pinnatis; foliolis lanaolaio-
ovatis y acuminatis Mill.
P fa d a whofe lobes arc fpear-shaped , oval and acute
pointed.
8. Pfachlcrk feuilles ailées qui tombent en hiver;
à folioles oblong-ovales. Pfachier de la Jamaïque.
P fa d a folds pinnatis deciduis y foliolis oblonoo-
ovails. Mill.
Birch-tree in Jamaica.
9. PfachUr à feuilles ailées impaires, à folioles
lancéolées, dont celles du bout font les plus grandes.
Vrai lentifque du Levant.
P fa d a folds impari - pinnatis, foliolis lanceolaùs
extedoribus majoribus. Mill.
True nufick-tree o f the Levant.
Le piflachier rP i habite la Perfe, l’Arabie & la
Syrie , d’oii l’on nous envoie fes amandes. Dans ces
contrées, il s’élève à 25 ou 30 pieds ; fon écorce eft
brun-rouge , & fes feuilles font d’un verd bleuâtre.
Lorfque les mâles font trop loin des femelles, on a
coutume de porter dans des paniers les chatons de
ceux-là, non encore ouverts, & de les attacher
apres celles-ci. On les prend aufli ces chatons pendant
l’émilTion de leur vapeur ou pouffiere organique
qu’on jette fur les grouppes de fleurs femelles qui fe
trouvent ainfi fécondées. J’ai reçu plufieurs fois des
amandes de pfachier bien faines, qui n’ont pas levé,
parce apparemment que les fleurs qui les avoient précédées
n’avoient pas éprouvé le contaéf générateur.
Il faut femer les amandes au mois de mars dans de
petites cailTes emplies de bonne terre onûueufe mêlée
de terreau, & enterrer ces cailTes dans une couche
de fumier récente & ombragée. Les plantes ont-
elles paru , il faut leur donner tous les jours plus
d’air. Au mois de juillet, on tranfplantera chaque
P I S
pfachier dans un petit pot. C ’elT la feule méthode
litre , car la fécondé année même, la reprife de ces
arbres qui n’ont pour racines qu’un long filet, feroit
fort incertaine. Ces pots pafl'eront les trois ou quatre
premiers, hivers fous une caille vitrée, en leur
procurant, autant qu’il fera polT.ble, le libre accès
de l’air, faute duquel ils fe chanciroient. Au bout de
ce lems on les plantera contre un imir bien e.xpofc
ou dans tout autre lieu bien abrité , où ils fiipporte-
ront le froid de nos hivers ordinaires, & donneront
des fruits qui certaines années parviendront à
maturité.
Le i a une écorce brune & âpre : fes feuilles à
trois & quelquefois à quatre lobes font d’un verd
oblcur: le fruit eil l'cmblable à la pidache, mais plus
petit: cette efpece efl un peu plus délicate que le
«° /, & demande un peu plus de proteélion contre
le froid ; mais d’ailleurs il s’élève de fe traite de
meme : il fupporie en el'palier le froid ordinaire de
nos hivers. S’il étoit exceffif, on pourroit mettre
devant des paillaiïbns ou des vitres. Il ed naturel
du Levant ôî de la Sicile.
Le 3 forme un arbre d’une grandeur médiocre ;
fon écorce edd’un gris clair; fes feuilles font compo-
fées de cinq folioles ; mais il s’y en trouve qui n’en
ont que trois, le fruit ed petit, mais bon à manger.
Il s’élève de fe multiplie comine le n° i , & n’ed pas
plus fenfible à la gelée. Il nous vient de Tltalie &
de la France méridionale ; mais on croit qu’il y
a été originairement apporté de contrées plus éloignées.
Le n°4y qui ed le térébinthe commun , a fes feuilles
compolées de trois ou quatre paires de folioles, de
terminées par un feul lobe. Les ileurs mâles ont des
fommets purpurins ; fes graines doivent être femées
en automne , autrement lelon Miller, elles ne lèvent
que la fécondé année. II s’élève ÔC fe traite comme
le pfachier n° 1. Miller dit qu’ il fe trouve dans le
jardin du duc de Richmond, à Goodwood, comté
de Sudex, un térébinthe en efpalier qui y fubfide
depuis 50 ans. Je crois que la meilleure faifon pour
les irani'planter ed la fin de feptembre, du moins à
l’égard de ceux qu’on tire du femis. Pour ce qui eft
de ceux qu’on tire des pots avec la motte, la fin
d’avril ed le moment le plus favorable. On s’épargnera
bien des peines, fi on les lire du femis deux
mois après leur germination, pour les planter chacun
féparcment dans un pot. On employoit autrefois
la térébenthine de cet arbre ; mais à préfent on
ne fait plus guere ufage que de celle des arbres conifères
; il ed indigene de la Barbarie , de l’Efpagne
& de l’Italie.
La cinquième efpece ed le lentifque commun : l’écorce
de fes branches edgrife, 6c celle des bourgeons
ed rouge: les feuilles n’ont ordinairement point de
foliole qui les termine ; elles font d’un verd obfcur Sc
glacé pardeffus, 6c d’un verd pâle par delTous: les folioles
font entières 6c épailTes ; le long de la côte qui
les foutient, s’ étend une bordure de chaque coté. En
automne le verd de cet arbre devient rougeâtre, mais
il ne fe dépouille pas. Miller dit qu’il huit femer fes
graines en automne , 6c que fi l’on attendoit le prin-
tems , elles pourroient ne lever qu’un an après. J’en
ai femé au mois de mars qui ont levé parfaitement
au bout de fix femaines. Il ed edenticl de fe les procurer
fécondes, c’ed-à-dire d’être alTuré qu’elles ont
été recueillies fur un individu femelle qui avoit des
mâles à fa portée ; & ceci ed important à l’égard de
toutes les efpeces de ce genre. Le lentifque ed naturel
de l’Efpagne, du Portugal 6c de l’Italie où il s’élève
à 18 ou 10 pieds. On le tient ordinairement
dans l’orangerie, mais on peut le mettre en efpalier
contre un mur très-bien expofc,fe réfervantde le
P L A
couvrir avec des paillaffons, fi le froid devenok ex-
■ ceffif. On le multiplie atilfi par des marcottes qttt font
au bout d'ttn an fitiSfammenî pourvues de raetnes.
L’ efpece (f croit aux environs de Marleille
s’élève auin haut que le précédent: il en différé par
lis feuilles t|iii ont de plus que les fiennes une ou
deux paires de folioles plus étroites & d’un verd
plus pâle. U fe multiplie (5c fe traite de même.
Lts feptieme 6c huitième efpeces font natives de
I.'i Jtim-fique 6c des Indes occidentales ^demandent
d’être élevées 6c traitées comme les autres plantes
de ferre chaude: on doit les y tenir conftamment,
mais leur donner beaucoup d’air au plus chaud de
l ’é té , 6c ne les arrofer que très-fobremenc durant
^ ^Ya^neuvisme efpece efi le lentifque qui fournit de
mall'.c à Li médecine & que Tournefort lui-même a
niul'à propos confondu avec le /, dont il différé
par des folioles pluslarges à l’extrémité des feuilles :
il efi plus dclic-at & veut être tenu l’hiver dans une
ferre plus échauffée. On cultive encore un petit len-
tifque qu’on m’a envoyé fous la ph- afe h û n e , lentif-
cus omrdium minimus. le Baron DE TSCH OU DI.')
PITHAUTIQUE , ( Mufiqiie infhum. des anciens. )
Bartholin , dans le clmp. y du Üv. I l l de fon traité De
dbdsveier. parle d’une efpece de flûte qu’il appelle
pithautlquc d’après Diomede. Cette flûte pithautlque
n’étoic autre chofe que l’efpcce de cornemufe des
anciens qui avoit un tonneau au lieu d’outre. Voye^
COR.XEMUSE , {Luth.) Suppl. {F. D .C . )
PIZZICATO, {M ujîq.) Ce mot, écrit dans la
mufique Italienne , avertit qu’il fimt pincer. Foyei
P in c e r , {M u fq .) Suppl. { S )
P L
§ PLACENTA, ( Anat. ) Le placenta eft une efpece
de vifeere attaché à la matrice d’un côté , 6c au
foetus d'un autre , par les vaiffeaux ombilicaux. On
trouve ce vifeere dans les quadrupèdes & dans les
animaux cétacés ; les oileaux on font deflitues, parce
que leur foetus prend fon accroüTemenc au-dehors
du corps de la mere.
I l y a beaucoup de variété dans la figure du pla-
ccnraScdansle nombre. Dans l’homme il efi unique,
& les jumeaux même ont leurs placenta le plus fou-
vent réunis dans une mafié commune.
Ce vifeere ne paroîtpas dans les premiers momens
après la conception. L’oeuf humain atteint un volume
confidérable avant qu’on y difiingue le placenta. Il
efi vrai que la partie fupérieurc de l’oeut efi la plus
velue, 6c que les floccons branchus qu’il produit,
font plus longs que ceux de la partie inférieure ; c’efi
le commencement du placenta.
Sescommcncemensnc font diftingués du chorion
que par la longueur de fes filets. Cette différence
devient plus fenfible, lorfque le placenta efi attaché
à la matrice. Il fe colle à la partie de cet organe, dont
les vaiffeaux font les plus gros 6c les plus nombreux ;
cette partie des filets originaux groflit par les hu-
meurs qu’elle reçoit de ces vaiffeaux de la matrice ;
elle devient plus épaiffe , plus remplie de fang : c’efi
le placenta naturellement attaché à la voûte de la
matrice qui efi entre les deux trompes.
Le refic des filets dont l’oeuf humain ctolt couvert,
ne rencontrant dans la partie inférieure delà matrice
que de petits vaiffeaux, ne prend pas les mêmes ac-
Croiffemens , il n’en réfultc qu’une membrane molle
un peu épaiffe ; c’efi le chorion.
Il y a des exceptions à l’attache du placenta. On
l’a vu s’attacher à la partie antérieure de la matrice ,
à la poftcricurc , aux côtés , au col de la matrice ,
à l’orifice même. Il s’attache bien au péritoine 6c au
méfentere, à l’intcfiin, au diaphragme dans les foetus
Tome IV,
P L A 387
qui oftt pris leur accroiffement hors de la matrice.
Le placenta en général efi rond, applati, peu épais,
6c dix fois plus large au moins qu’il n’eft épais , plus
épais cependant au centre, 6c plus mince à la cir-
conférence.
Il n’eft pas toujours circulaire ; on l’a vu oblong 6c
terminé en pointe.
Sa face convexe répond à la matrice ; celle qui
répond au foetus efi concave ; elle efi moins égale :
celle qui regarde la matrice l’eft beaucoup ; elle ell
partagée en lobes par des fentes profondes. Chaque
lobe a fa grande artere.
Le placenta efi entièrement recouvert du chorion,
tant du côté du foetus que du côté de la matrice ;
l’adhéfion de cette membrane efi plus forte au bord
du placenta ; elle defcend dans les fentes qui Icparent
les lobes , & y conferve fa nature fibreufe.
Dans fon état naturel, le placenta paroît un vifeere
fanglant extrêmement fpongieux 6c mou , 6c
comme fibreux. On y a vu à fa tàce convexe de la
graiffe.
Macéré dans l’eau , il fe refout en fibres , qu’une
ccllulofité gluante lioit enfemble , 6c qui fe féparent.
Cette celliilofitc accompagne les vaiffeaux , 6c c’efi
avec chaque tronc d'artere 6c de veine qu’elle s’in-
finue dans l’intérieur du placenta ; elle environne les
plus petits vaifi'eaux.
Il n’y a point de véritables glandes : elles dégénèrent
à la vérité 6c Iiès-fotivent en hydaiides : des
femmes accouchent comme d’une grappe de raifin ,
dont les grains tiennent à des queues rameufes. Ces
hydaiides paroîffcnt fc former des petites varices des
veines du placenta.
Les arteres ombilicales fe partagent à quelque
difiance du placenta & à la premiere attache de
l’amnios au cordon. Comme le cordon ne s’acraclie
que rarement au centre du placenta , les branche.s
des arteres ombilicales font inégales en groffeur 6c
en longueur : celles qui vont à la petite moitié du
placenta font furpaffées dans l’une 6c Tautie de ces
mefures par celles qui vont à la grande moitié.
Elles font quelque chemin entre la membrane
mitoyenne 6c le chorion, 6c amènent avec elle cette
cellulofité , que quelques auteurs ont décorée du
nom de gaine.
Leur marche va en ferpentant ; elles ont de fréquentes
anafiomoles, même entre leurs grofles branches
, 6c font un réfeau, dont les großes branches
regardent le foetus, & les plus fines l’utérus. Les
branches de ce réfeau font couvertes d’un refeau
beaucoup plus fin de branches capillaires.
Les branches des arteres ombilicales percent à
la fin le chorion du côté concave du placenta , 6c
entrent dans la fubftance du vifeere , accompagnées
de leur cellulofitc. Elles s’y plongent perpendiculairement,
fe partagent par des branches lubdivi-
fées, de maniéré que chaque tronc un peu confidérable
produit un des lobes àw placenta. Scs branches
font très-fines , 6c leurs extrémités comme
cotoiineufes : une cellulofité délicate en forme des
grains , qui par la macération deviennent comme
des arbriffeaux. Ce font ces branches artérielles
même qu’on a appellées fibres du pUcenta : elles le
compofent feules avec les veines & les celliilolirés,
aucun nerf ne pénétrant jufques dans le placenta.
Pour entendre la maniéré placentas attachu
à la matrice , il faut commencer par la manière dont
le chorion s’y attache, puifque c’efi lui qui tapiffe
généralement la furface intérieure de la matrice, 6c
que le placenta même y efi lié par fon intervention.
Hors à\i placenta , le chorion reflemble à un velouté
qui s’attache à un velouté tout-à-faù fcmbla-
ble , qui tapiffe la matrice dans l’état de la groffeflm
Ces deux membranes s’uniffentfi parfaitement, qu’i.1
C c c ij