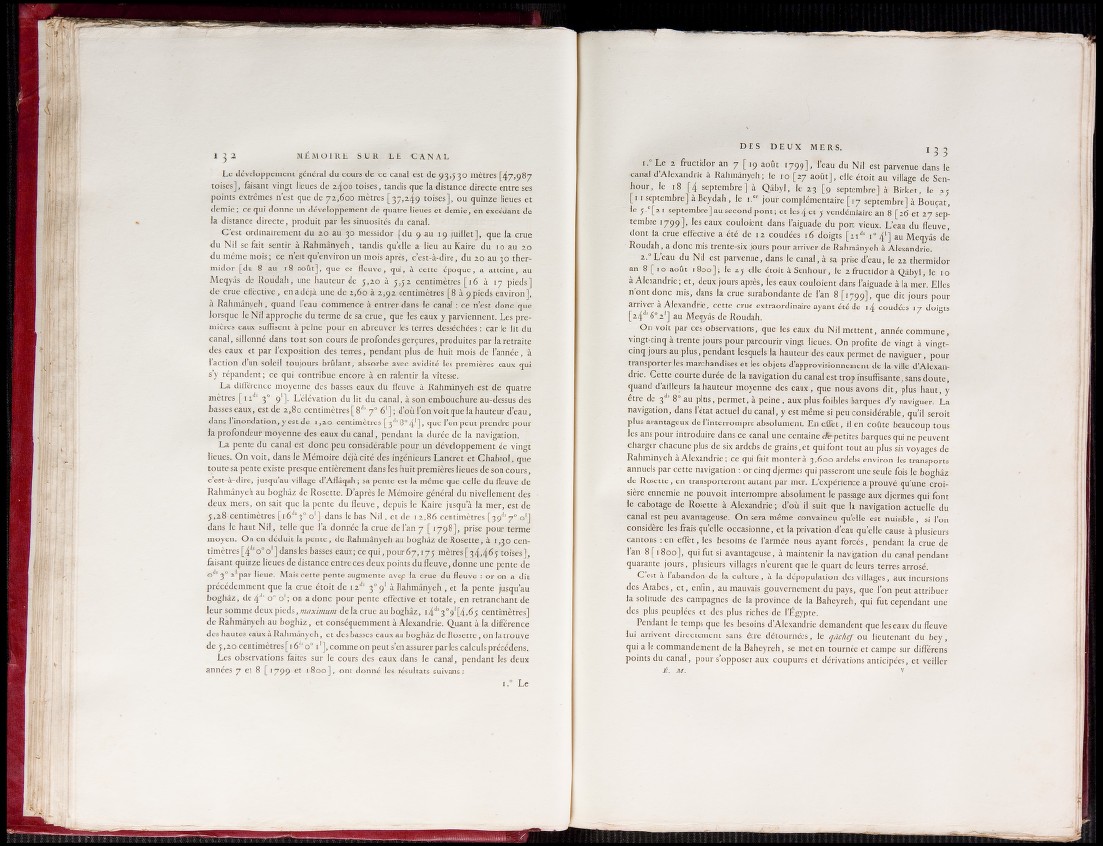
Le développement général du cours de ce canal est de 93,530 mètres [47,987
toises], faisant vingt lieues de 2400 toises, tandis que la distance directe entre ses
points extrêmes n’est que de 72,600 mètres [37,249 toises], ou quinze lieues et
demie; ce qui donne un développement de quatre lieues et demie, en excédant de
la distance directe, produit par les sinuosités du canal.
C ’est ordinairement du 20 au 30 messidor [du 9 au 19 juillet], que la crue
du Nil se fait sentir à Rahmânyeh , tandis qu’elle a lieu au Kaire du 10 au 20
du même mois; ce n’est qu’environ un mois après, c’est-à-dire, du 20 au 30 thermidor
[du 8 au 18 août], que ce fleuve, qui, à cette époque, a atteint, au
Meqyâs de Roudah, une hauteur de 5,20 à 5,52 centimètres [16 à 17 pieds]
de crue effective , en a déjà une de 2,60 à 2,92 centimètres [8 à 9 pieds environ],
à Rahmânyeh, quand l’eau commence à entrer dans le canal : ce n’est donc que
lorsque le Nil approche du terme de sa crue, que les eaux y parviennent. Les premières
eaux suffisent à peine pour en abreuver les terres desséchées : car le lit du
canal, sillonné dans tout son cours de profondes gerçures, produites par la retraite
des eaux et par l’exposition des terres, pendant plus de huit mois de l’année, à
l’action d’un soleil toujours bridant, absorbe avec avidité les premières eaux qui
s’y répandent ; ce qui contribue encore à en ralentir la vitesse.
La différence moyenne des basses eaux du fleuve à Rahmânyeh est de quatre
mètres [ 12ds 30 91]. L’élévation du lit du canal, à son embouchure au-dessus des
basses eaux, est de 2,80 centimètres [8ds 70 61]; d’où l’on voit que la hauteur d’eau,
dans 1 inondation, y est de 1,20 centimètres [3^ 8° 4'], que l’on peut prendre pour
la profondeur moyenne des eaux du canal, pendant la durée de la navigation.
La pente du canal est donc peu considérable pour un développement de vingt
lieues. On voit, dans le Mémoire déjà cité des ingénieurs Lancret et Chabrol, que
toute sa pente existe presque entièrement dans les huit premières lieues de son cours,
c’est-à-dire, jusqu’au village d’Aflâqah; sa pente est la même que celle du fleuve de
Rahmânyeh au boghâz de Rosette. D ’après le Mémoire général du nivellement des
deux mers, on sait que la pente du fleuve , depuis le Kaire jusqu’à la mer, est de
5,28 centimètres [16di 30 o'] dans le bas Nil, et de 12,86 centimètres [39^y° o1]
dans le haut Nil, telle que l’a donnée la crue de l’an 7 [1798], prise pour terme
moyen. On en déduit la pente, de Rahmânyeh au boghâz de Rosette, à 1,30 centimètres
[4dso°o'] dans les basses eaux; ce qui, pour 67,175 mètres [34,465 toises],
faisant quinze lieues de distance entre ces deux points du fleuve, donne une pente de
ods 30 21 par lieue. Mais cette pente augmente avep la crue du fleuve : or on a dit
précédemment que la crue étoit de 12* 3° 91 à Rahmânyeh , et la pente jusqu’au
boghâz, de 4ds 0° o1; on a donc pour pente effective et totale, en retranchant de
leur somme deux pieds, maximum de la crue au boghâz, t4ds3°9l[4.65 centimètres]
de Rahmânyeh au boghâz, et conséquemment à Alexandrie. Quant à la différence
des hautes eaux à Rahmânyeh, et des basses eaux au boghâz de Rosette, on la trouve
de 5,20 centimètres [ 16ds o° 1 '], comme on peut s’en assurer parles calculs précédens.
Les observations faites sur le cours des eaux dans le canal, pendant les deux
années 7 et 8 [ 1799 et 1800] , ont donné les résultats suivans :
i.° Le
D E S D E U X M E R S . r 3 ,
J J
H Le 2 fructidor an 7 [ 19 août 1799], l’eau du Nil est parvenue dans le
canal dAlexandrie à Rahmânyeh; le ro [27 août], elle étoit au village de Sen-
hour, le 18 [4 septembre] à Qâbyl, le 23 [9 septembre] à Birket, le 25
[ 11 septembre] à Beydah, le 1 ,er jour complémentaire [ 17 septembre] à Bouçat,
le 5.'[21 septembre] au second pont; et les 4 et 5 vendémiaire an 8 [26 et 27 septembre
1799], les eaux couloicnt dans l’aiguade du port vieux. L’eau du fleuve,
dont la crue effective a été de 12 coudées 16 doigts [ 2 ids i° 4‘ ] au Meqyâs de
Roudah, a donc mis trente-six jours pour arriver de Rahmânyeh à Alexandrie.
2.0 L’eau du Nil est parvenue, dans le canal, à sa prise d’eau, le 22 thermidor
an 8 [ 10 août 1800]; le 25 elle étoit àSenhour, le 2 fructidor à Qâbyl, le to
à Alexandrie; et, deux jours après, les eaux couloient dans l’aiguade à la mer. Elles
n’ont donc mis, dans la crue surabondante de l’an 8 [1799], que dix jours pour
arriver à Alexandrie, cette crue extraordinaire ayant été de 14 coudées 17 doigts
[24ds6°.2l] au Meqyâs de Roudah.
On voit par ces observations, que les eaux du Nil mettent, année commune,
vingt-cinq à trente jours pour parcourir vingt lieues. On profite de vingt à vingt-
cinq jours au plus, pendant lesquels la hauteur des eaux permet de naviguer, pour
transporteries marchandises et les objets d’approvisionnement de la ville d’Alexandrie.
Cette courte duree de la navigation du canal est trop insuffisante, sans doute,
quand dailleurs la hauteur moyenne des eaux, que nous avons dit, plus haut, y
etre de 3 8° au plus, permet, à peine, aux plus foibles barques d’y naviguer. La
navigation, dans l’état actuel du canal, y est même si peu considérable, qu’il seroit
plus avantageux de l’interrompre absolument. En effet, il en coûte beaucoup tous
les ans pour introduire dans ce canal une centaine petites barques qui ne peuvent
charger chacune plus de six ardebs de grains, et qui font tout au plus six voyages de
Rahmânyeh à Alexandrie; ce qui fait monter à 3,600 ardebs environ les transports
annuels par cette navigation : or cinq djermes qui passeront une seule fois le boghâz
de Rosette, en transporteront autant par mer. L’expérience a prouvé qu’une croisière
ennemie ne pouvoit interrompre absolument le passage aux djermes qui font
le cabotage de Rosette à Alexandrie ; d’où il suit que la navigation actuelle du
canal est peu avantageuse. On sera même convaincu qu’elle est nuisible, si l’on
considère les frais qu’elle occasionne, et la privation d’eau qu’elle cause à plusieurs
cantons : en effet, les besoins de l’armée nous ayant forcés, pendant la crue de
l’an 8 [ 1800], qui fut si avantageuse, à maintenir la navigation du canal pendant
quarante jours, plusieurs villages n’eurent que le quart de leurs terres arrosé.
C est à 1 abandon de la culture, à la dépopulation des villages, aux incursions
des Arabes, et, enfin, au mauvais gouvernement.du pays, que l’on peut attribuer
la solitude des campagnes de la province de la Baheyreh, qui fut cependant une
des plus peuplées et des plus riches de l’Égypte.
Pendant le temps que les besoins d Alexandrie demandent que les eaux du fleuve
lui arrivent directement sans être détournées, le qâchef ou lieutenant du bey,
qui a le commandement de la Baheyreh, se met en tournée et campe sur différens
points du canal, pour s opposer aux coupures et dérivations anticipées, et veiller