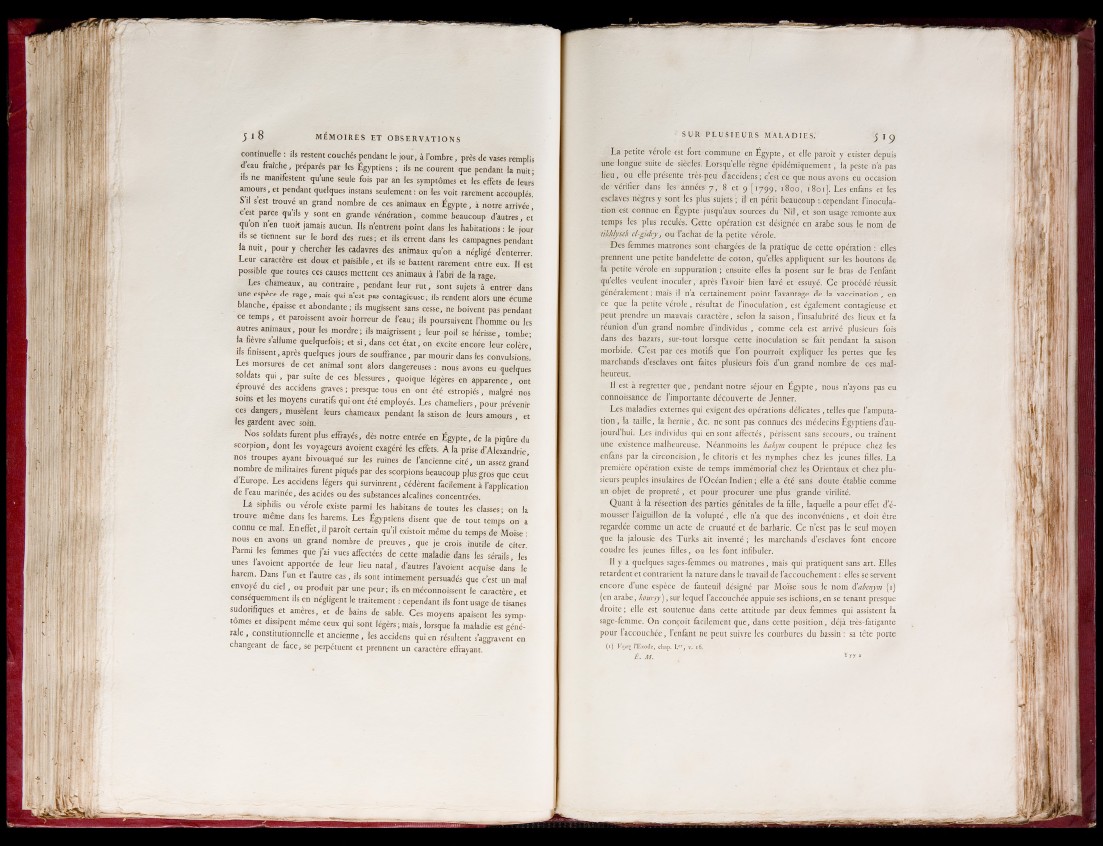
continuelle : ils restent couchés pendant le jour, à l’ombre, près de vases remplis
d eau fraîche, préparés par les Égyptiens ; ils ne courent que pendant la nuit ;
ils ne manifestent qu une seule fois par an les symptômes et les effets de leurs
amours, et pendant quelques instans seulement : on les voit rarement accouplés.
S il s est trouvé un grand nombre de ces animaux en Égypte, à notre arrivée,
cest parce qu’ils y sont en grande vénération, comme beaucoup d’autres, et
qu’on n’en tuoit jamais aucun. Ils n’entrent point dans des habitations : le jour
ils se tiennent sur le bord des rues; et ils errent dans les campagnes pendant
la nuit, pour y chercher les cadavres des animaux qu’on a négligé d’enterrer.
Leur caractère est doux et paisible, et ils se battent rarement entre eux. Il est
possible que toutes ces causes mettent ces animaux à l’abri de la rage.
Les chameaux, au contraire, pendant leur rut, sont sujets à entrer dans
une espèce de rage, mais qui n’est pas contagieuse ; ils rendent alors une écume
blanche, épaisse et abondante ; ils mugissent Sans cesse, ne boivent pas pendant
ce temps , et paroissent avoir horreur de l’eau; ils poursuivent l’homme ou les
autres animaux, pour les mordre; ils maigrissent; leur poil se hérisse, tombe;
la fièvre s’allume quelquefois; et si, dans cet état, on excite encore leur colère]
ils finissent, après quelques jours de souffrance, par mourir dans les convulsions.
Les morsures de cet animal sont alors dangereuses : nous avons eu quelques
soldats qui , par suite de ces blessures, quoique légères en apparence, ont
éprouvé des accidens graves; presque tous en ont été estropiés, malgré nos
soins et les moyens curatifs qui ont été employés. Les chameliers, pour prévenir
ces dangers, musèlent leurs chameaux pendant la saison de leurs amours et
les gardent avec soin.
Nos soldats furent plus effrayés, dès notre entrée en Égypte, de la piqûre du
scorpion, dont les voyageurs avoient exagéré les effets. A la prise d’Alexandrie,
nos troupes ayant bivouaqué sur les ruines de l’ancienne cité, un assez grand
nombre de militaires furent piqués par des scorpions beaucoup plus gros que ceux
d Europe. Les accidens légers qui survinrent, cédèrent facilement à l’application
de leau marinée, des acides ou des substances alcalines concentrées.
La siphdis ou vérole existe parmi les habitans de toutes les classes ; on la
trouve même dans les harems. Les Égyptiens disent que de tout temps on a
connu ce mal. En effet, il paroît certain qu’il existoit même du temps de Moïse :
nous en avons un grand nombre de preuves, que je crois inutile de citer
Parmi les femmes que j’ai vues affectées de cette maladie dans les sérails, les
unes 1 avoient apportée de leur lieu natal, d’autres l’avoient acquise dans le
harem. Dans l’un et l’autre cas, ils sont intimement persuadés que c’est un mal
envoyé du ciel, ou produit par une peur; ils en méconnoissent le caractère, et
conséquemment ils en négligent le traitement : cependant ils font usage de tisanes
sudorifiques et amères, et de bains de sable. Ces moyens apaisent les symptômes
et dissipent même ceux qui sont légèrs; mais, lorsque la maladie est générale
, constitutionnelle et ancienne, les accidens qui en résultent s’aggravent en
changeant de face, se perpétuent et prennent un caractère effrayant.
La petite verole est fort commune en Égypte, et elle paroît y exister depuis
une longue suite de siècles. Lorsqu’elle règne épidémiquement, la peste n’a pas
lieu, ou elle présente très-peu d accidens ; c’est ce que nous avons eu occasion
■de’ vérifier dans les années'7/ 8 et 9 [1799, 1800, i'8oi]! Les enfkns et les
esclaves negresy sont les plus sujets ; il en périt beaucoup ‘. cependant l’inoculation
est connue en Égypte jusqu’aux sources du Nil, et son usage remonte aux
temps les plus reculés. Cette opération est désignée en arabe sous le nom de
rik/i/yseh cl-gidry, ou l’achat de la petite vérole.
Des femmés matrones sont chargées de la pratique de cette opération : elles
prennent une petite bandelette de coton, qu’elles appliquent sur les boutons de
la petite vérole en suppuration ; ensuite elles la posent sur le bras de 1’enfànt
qu’elles veulent inoculer,: après l’avoir bien lavé et essuyé. Ce procédé réussit %
généralement ; mais il n’a certainement point l’avantage de la vaccination , en
ce que la petite vérole, résultat de l’inoculation, est également contagieuse et
peut prendre un mauvais caractère, selon la saison, l’insalubrité des lieux et la
reunion dun grand nombre d’individus , comme cela est arrivé plusieurs fois
dans des bazars, sur-tout lorsque cette inoculation se fait pendant la saison
morbide. C est par ces motifs que l’on pourroit expliquer les pertes que les
marchands d’esclaves ont faites plusieurs fois d’un grand nombre de ces malheureux.
Il est à regretter que, pendant notre séjour en Égypte, nous n’ayons pas eu
connoissance de l’importante découverte de Jenner.
Les maladies externes qui exigent des opérations délicates, telles que l’amputation,
la taille, la hernie, &c. ne sont pas connues des médecins Égyptiens d’au-
jourdhui. Les individus qui en sont affectés, périssent sans secours, ou traînent
une existence malheureuse. Néanmoins les hakym coupent le prépuce chez les
enfans par la circoncision, le clitoris et les nymphes chez les jeunes filles. La
première opération existe de temps immémorial chez les Orientaux et chez plusieurs
peuples insulaires de l’Océan Indien ; elle a été sans doute établie comme
un objet de propreté , et pour procurer une plus grande virilité.
Quant à la résection des parties génitales de la fille, laquelle a pour effet d’é-
mousser l’aiguillon de la volupté , elle n’a que des inconvéniens, et doit être
regardée comme un acte de cruauté et de barbarie. Ce n’est pas le seul moyen
que la jalousie des Turks ait inventé ; les marchands d’esclaves font encore
coudre les jeunes filles, ou les font infibuler.
Il y a quelques sages-femmes ou matrones, mais qui pratiquent sans art. Elles
retardent et contrarient la nature dans le travail de l’accouchement : elles se servent
encore d’une espèce de fauteuil désigné par Moïse sous le nom d'abenym (1)
(en arabe, koursy),s\xs lequel l’accouchée appuie ses ischions,en se tenant presque
droite ; elle est. soutenue dans cette attitude par deux femmes qui assistent la
sage-femme. On conçoit facilement que, dans cette position, déjà très-fatigante
pour l’accouchée, l’enfant ne peut suivre les courbures du bassin : sa tête porte
II), Voye^ l'Exode, chap. 1.” , v. 16.
Ê. M. Y!’>’ ?