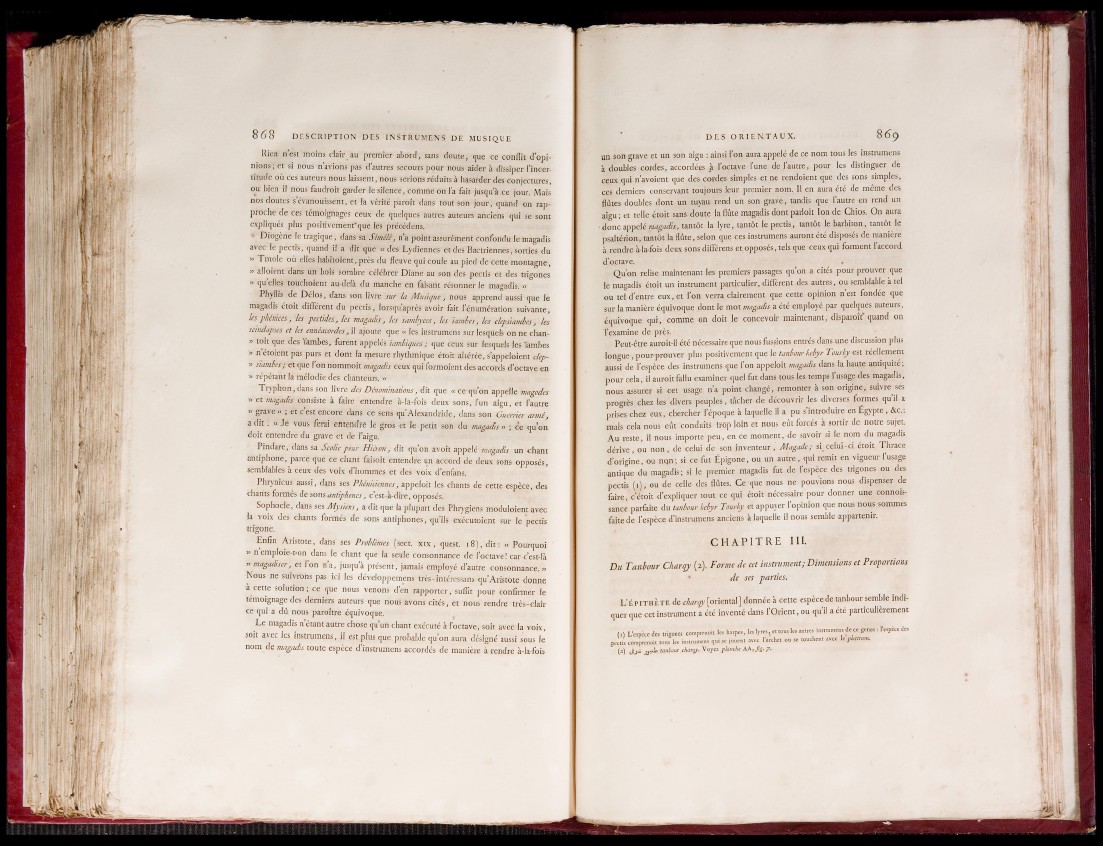
868 D E S C R I P T I O N D E S I N S T R U M E N S D E M U S I Q U E
Rien n’est moins clair au premier abord, satis doute, que ce conflit d’opinions
; et si nous n avions pas d’autres secours pour nous aider à dissiper l’incertitude
où ces auteurs nous laissent, nous serions réduits à hasarder des conjectures,
ou bien il nous faudroir garder le silence, comme on l’a fait jusqu’à ce jour. Mais
nos doutes s évanouissent, et la vérité paroît dans tout son jour, quand on rapproche
de ces témoignages ceux de quelques autres auteurs anciens qui se sont
expliqués plus posirivement'que lés précédens.
Diogène le tragique, dans sa Sémélé, n’a point assurément confondu le magadis
avec le pectis, quand il a dit que « des Lydiennes et des Bactriênnes, sorties du
» Tmole où elles habitoient,près du fleuve qui coule au pied de cette montagne,
» alloient dans un bois sombre célébrer Diane au son des pectis et des trigones
» qu elles touchoient au-dela du manche en faisant résonner le magadis. »
Phyllis de Délos, dans son livre sur la Musique, nous apprend aussi que le
magadis etoit différent du pectis, lorsquaprès avoir fait i’énumération suivante,
les phénices, les pectides, les magadis, les samlyces, les ïambes, les clepsiambes, les
scmdàpses et les ennéacordes, il ajoute que « les instrumens sur lesquels on ne chan-
» toit que des iambes, furent appelés ïambiques; que ceux sur lesquels les ïambes
» nétoient pas purs et dont la mesure rhythmique étoit altérée, s’appeloient clep-
51 BjKP® et que 1 on nommoit magadis ceux qui formoient des accords d’octave en
» répétant la mélodie des chanteurs. »
Tryphon, dans son livre des Dénominations, dit que « ce qu’on appelle magodes
» et magadis consiste a faire entendre à-la-fois deux sons, l’un aigu, et l’autre
» grave» ; et c’est encore dans ce sens qu’Aiexandride, dans son Guerrier armé,
a dit : « Je vous ferai entendre le gros et le petit son du magadis » ; ce qu’on
doit entendre du grave et de l’aigu.
Pindare, dans sa Scolie pour Hiéron, dit qu’on avoit appelé magadis un chant
antiphone, parce que ce chant faisoit entendre un accord de deux sons opposés,
semblables a ceux des voix d hommes et des voix d’enfans.
Phrynicus aussi, dans ses Phéniciennes, appeloit les chants de cette espèce, des
chants formés de sons antiphones, c’est-à-dire, opposés.
Sophocle, dans ses Mysiens, a dit que la plupart des Phrygiens moduloient avec
la voix des chants formés de sons antiphones, qu’ils exécutoient sur le pectis
trigone.
Enfin Aristote, dans ses Problèmes (sect. x ix , quest. 18 ), dit : « Pourquoi
» nemploie-t*on dans le chant que la seule consonnance de l’octave! car c’est-là
» magadiser, et Ion n’a, jusqu’à présent, jamais employé d’autre consonnance.»
Nous ne suivrons pas ici les développemens très-intéressans qu’Aristote donne
à cette solution; ce que nous venons d’en rapporter, suffit pour confirmer le
témoignage des derniers auteurs que nous avons cités, et nous rendre très-clair
ce qui a dû. nous paroître équivoque.
Le magadis n étant autre chose qu’un chant exécuté à l’octave, soit avec la voix,
soit avec les instrumens, il est plus que probable qu’on aura désigné aussi sous le
nom de magadis toute espèce d’instrumens accordés de manière à rendre à-la-fois
un son grave et un son aigu ; ainsi l’on aura appelé de ce nom tous les instrumens
à doubles cordes, accordées à l’octave lune de 1 autre, pour les distinguer de
ceux qui n’avoient que des cordes simples et ne rendoient que des sons simples,
ces derniers conservant toujours leur premier nom. Il en aura ete de meme des
flûtes doubles dont un tuyau rend un son grave, tandis que l’autre en rend un
aigu ; et telle étoit sans doute la flûte magadis dont parloit Ion de Chios. On aura
donc appelé magadis, tantôt la lyre, tantôt le pectis, tantôt le barbiton, tantôt le
psaltérion, tantôt la flûte, selon que ces instrumens auront été disposés de manière
à rendre à-la-fois deux sons différens et opposés, tels que ceux qui forment 1 accord
d’octave. .
Qu’on relise maintenant les premiers passages qu on a cites pour prouver que
le magadis étoit un instrument particulier, différent des autres, ou semblable à tel
ou tel d’entre eux, et l’on verra clairement que cette opinion n est fondée que
sur la manière équivoque dont le mot magadis a été employé par quelques auteurs,
équivoque qui, comme on doit le concevoir maintenant, disparoît* quand on
l’examine de près.
Peut-être auroit-il été nécessaire que nous fussions entrés dans une discussion plus
longue, pour-prouver plus positivement que le tanbour lebyr Tourky est réellement
aussi de l’espèce des instrumens que l’on appeloit magadis dans la haute antiquité ;
pour cela, il auroit fallu examiner quel fut dans tous les temps 1 usage des magadis,
nous assurer si cet usage n’a point changé, remonter a son origine, suivre ses
progrès chez les divers peuples, tâcher de découvrir les diverses formes qu il a
prises chez eux, chercher l’époque à laquelle il a pu s introduire enÉgypte, &c.:
mais cela nous eût conduits trop loin et nous eût forcés à sortir de notre sujet.
Au reste, il nous importe peu, en ce moment, de savoir si le nom du magadis
dérive, ou non, de celui de son inventeur, Magade; si_ celui-ci étoit T-hrace
d’origine, ou nqn ; si ce fut Épigone, ou un autre, qui remit en vigueur 1 usage
antique du magadis; si le premier magadis fut de l’espèce des trigones ou des
pectis (i), ou de celle des flûtes. Ce que nous ne pouvions nous dispenser de
faire, cetoit d’expliquer tout ce qui étoit nécessaire pour donner une connois-
sancé parfaite du tanbour kebyr Tourky et appuyer l’opinion que nous nous sommes
faite de l’espèce d’instrumens anciens à laquelle il nous semble appartenir.
C H A P I T R E III .
Du Tanbour Charqy (2). Forme de cet instrument; Dimensions et Proportions
• de ses parties.
L ’ É P ITH È T E de charqy [oriental] donnée! cette e spè c e de tanbour semble indiquer
que cet instrument a été inventé dans l’Orient, ou qu’il a été particulièrement
(,) L ’espèce des trigones comprenoit les harpes, les lyres , et tons les autres instrumente ce genre: I’espècedes
,pectis comprenoit tous les instrumens qui se jouent avec l'archet ou se touchent avec le yketrum.
■ (2) j > ! tanbour chartpt. Voyez .planche AA, Jig. y.