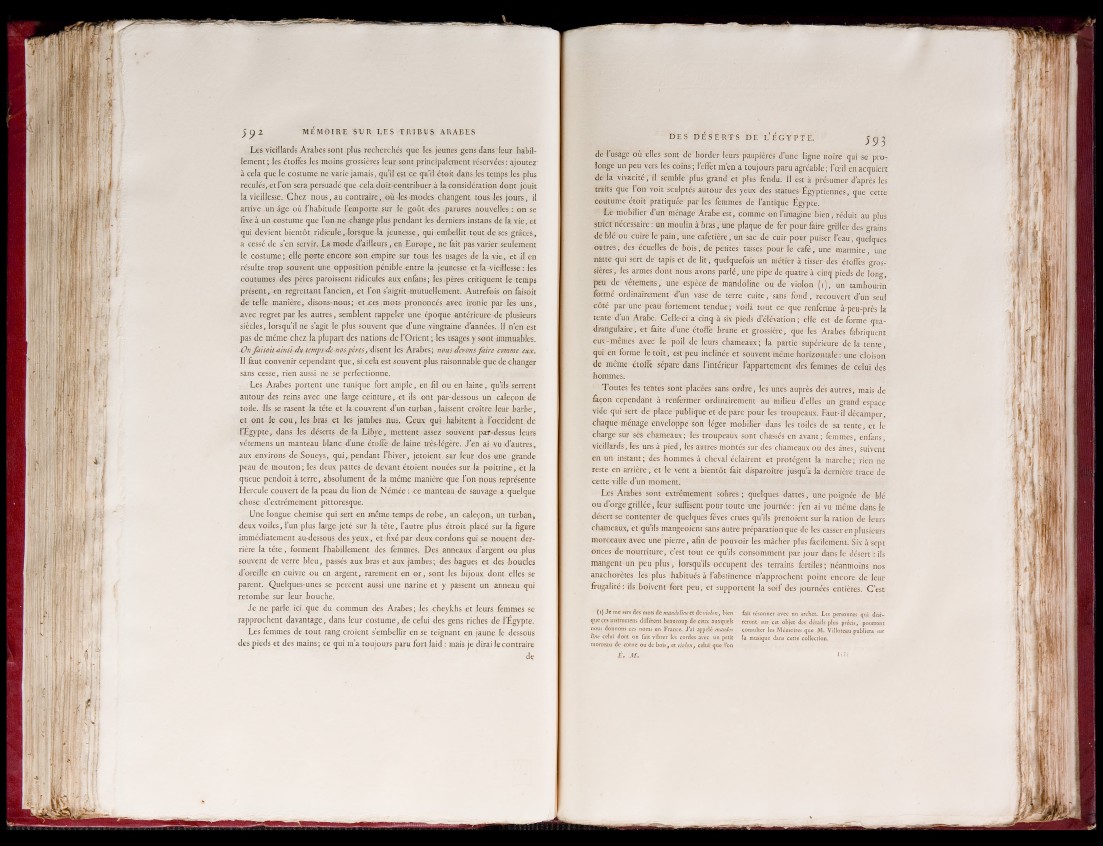
Les vieillards Arabes-sont plus recherchés que les jeunes gens dans leur habillement;
les étoffes les moins grossières leur sont principalement réservées: ajoutez
à cela que le costume ne varie jamais, qu’il est ce qu’il étoit dans les temps les plus
reculés, et l'on sera persuadé que cela doit-contribuer-à la considération dont jouit
la vieillesse. Chez nous, au contraire, où-les-modes changent tous-les jours, il
arriye un âge où l’habitude Remporte sur le goût des parures nouvelles : on se
fixe à nn-costume que l’on ne change plus pendant les derniers instans de la vie, et
qui devient bientôt ridicule., lorsque la jeunesse, quiem'bellit tout de ses grâces ,
a cessé de s’en servir. La mode d’ailleurs, en Europe, ne fait pas varier seulement
le costume; elle.porte encore son empire sur tous les usages de la vie., et il en
résulte trop souvent une opposition pénible entre la jeunesse et la-vieillesse : les
coutumes des pères paroissent ridicules aux. enfàns; les pères critiquent le temps
présent, en regrettant l’ancien, et l’on s’aigrit -mutuellement. Autrefois on faisoit
de telle manière, disons-nous; et ces mots prononcés avec ironie par lès uns,
avec regret par les autres, semblent rappeler une époque antérieure de plusieurs
siècles, lorsqu’il ne s’agit le plus souvent que d’une vingtaine d’années. Il n’en est
pas de même chez la plupart des nations de l’Orient ; les usages y sont immuables.
On faisoit ainsidu umps'de-nospères, disent les Arabes; nous devons faire comme eux.
Il faut convenir cependant que, si cela est-souvent plus raisonnable que de changer
sans cesse, rien aussi ne se perfectionne.
Les Arabes portent une tunique fort ample, en fil ou en laine, qu’ils serrent
autour des reins avec une large ceinture, et ils ont par-dessous un caleçon de
toile. Ils se rasent la tête et la couvrent d’un -turban, laissent croître leur barbe,
et ont le cou, les bras et les jambes nu?. Ceux qui habitent à l’occident de
l’Egypte, dans les déserts de la Libye, mettent assez souvent par-dessus leurs
vêtemens un manteau blanc d’une étoffe de laine très-légère. J’en ai vu d’autres,
aux environs de Soueys, qui, pendant Thiver, jetoient sur leur dos une grande
peau de mouton ; les deux pattes de devant étoient nouées sur -la poitrine, et la
queue pendoit à terre, absolument de la même manière que l’on nous représente
Hercule couvert de la peau du lion de Némée : ce manteau de sauvage a quelque
chose d’extrêmement pittoresque.
Une longue chemise qui sert en même temps de robe, un caleçon, un turban,
deux voiles, l’un plus large jeté sur la tête, l’autre plus étroit placé sur la figure
immédiatement au-dessous des yeux, et fixé par deux cordons qui se nouent derrière
la tête, forment l’habillement des femmes. Des anneaux d’argent ou plus
souvent de verre bleu, passés aux bras et aux jambes; des bagues et des boucles
d’oreille en cuivre ou en argent, rarement en or, sont les bijoux dont elles se
parent. Quelques-unes se percent aussi une narine et y passent un anneau qui
retombe sur leur bouche.
Je ne parle ici que du commun des Arabes ; les cheykhs et leurs femmes se
rapprochent davantage, dans leur costume, de celui des gens riches de l’Égypte.
Les femmes de tout rang croient s’embellir en se teignant en jaune le dessous
des pieds et des mains; ce qui m’a toujours paru fort laid : mais je dirai le contraire
de
de 1 usage ou elles sont de border leurs paupières d’une ligne noire qui se prolonge
un peu vers les coins ; I effet m en a toujours paru agréable ; l’ceil en acquiert
de la vivacité, il semble plus grand et plus fendu. II est à présumer d’après les
traits que Ion voit sculptés autour des yeux des statues Égyptiennes, que cette
coutume étoit pratiquée par les femmes de l’antique Égypte.
Le mobilier d’un ménage Arabe est, comme on l’imagine bien, réduit au plus
strict nécessaire : un moulin à bras, une plaque de fer pour faire griller des grains
de blé ou cuire le pain, une cafetière, un sac de cuir pour puiser l’c-au, quelques
outres ; des écuelles de bois, de petites tasses pour le café, une marmite, une
natte qui sert de tapis et de lit, quelquefois un métier à tisser des étoffes grossières
, les armes dont nous avons parlé, une pipe de quatre à cinq pieds de long,
peu de vêtemens, une espèce de mandoline ou de violon (i), un tambourin
formé ordinairement d’un vase de terre cuite, sans fond, recouvert d’un seul
côté par une peau fortement tendue; voilà tout ce que renferme à-peu-près la
tente d’un Arabe. Celle-ci a cinq à six pieds d’élévation ; elle est de forme qua-
drangulaire, et faite d’une étoffe brune et grossière, que les Arabes fabriquent
eux-memes avec le poil de leurs chameaux; la partie supérieure de la tente,
qui en forme le toit, est peu inclinée et souvent même horizontale: une cloison
de même étoffe sépare dans l’intérieur l’appartement des femmes de celui des
hommes.
Toutes les tentes sont placées sans ordre, les unes auprès dés autres, mais de
façon cependant à renfermer ordinairement au milieu d’elles un grand espace
vide qui sert de place publique et de parc pour les troupeaux. Faut-il décamper,
chaque ménage enveloppe son léger mobilier dans les toiles de sa tente, et le
charge sur ses chameaux; les troupeaux sont chassés en avant; femmes, enfans,
vieillards, les uns à pied, les autres montés sur des chameaux ou des ânes, suivent
en un instant ; des hommes à cheval éclairent et protègent la marche ; rien ne
reste en arrière, et le vent a bientôt fait disparoître jusqu’à la dernière trace de
cette ville d’un moment.
Les Arabes sont extrêmement sobres ; quelques dattes, une poignée de blé
ou d’orge grillée, leur suffisent pour toute une journée : j’en ai vu même dans le
désert se contenter de quelques fèves crues qu’ils prenoient sur la ration de leurs
chameaux, et qu’ils mangeoient sans autre préparation que de les casser en plusieurs
morceaux avec une pierre, afin de pouvoir les mâcher plus facilement. Six à sept
onces de nourriture, c’est tout ce qu’ils consomment par jour dans le désert : ils
mangent un peu plus, lorsqu’ils occupent des terrains fertiles ; néanmoins nos
anachorètes les plus habitués à l’abstinence n’approchent point encore de leur
frugalité: ils boivent fort peu, et supportent la soif des journées entières. C’est
(i) Je me sers des mots de mandoline et de violon > bien fait résonner avec un archet. Les personnes qui de'sique
ces instrumens diffèrent beaucoup de ceux auxquels reront sur cet objet des détails plus précis, pourront
nous donnons ces noms en France. J’ai appelé mando- consulter les Mémoires que M . Villoteau publiera sur
line celui dont on fait vibrer les cordes avec un petit la musique dans morceau de corne ou de bois, et cette collection, violon, celui que l’on
Ê. M. liîi