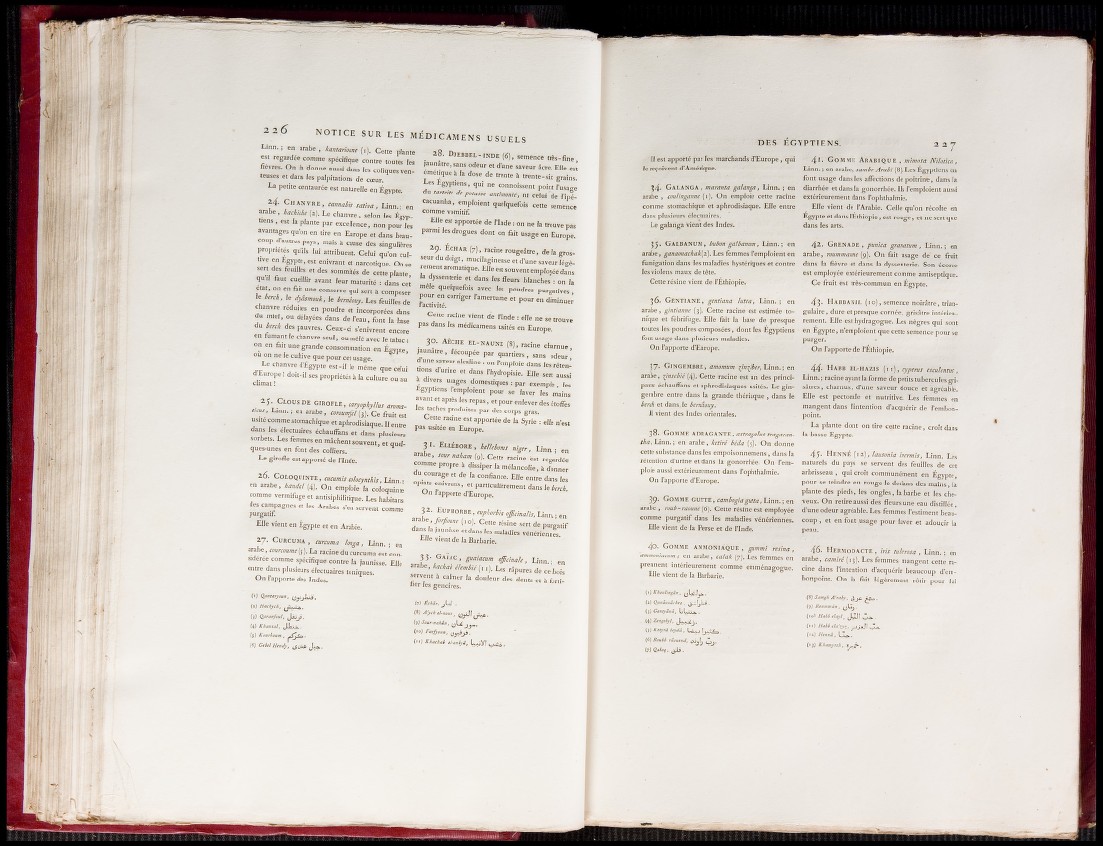
2 2 0 n o t i c e s u r l e s
’ en arabe> kantarioune [i). Cette plante
“ t «gardée comme spécifique contre toutes les
fièvres. On la donne aussi dans les coliques venteuses
et dans les palpitations de coeur.
La petite centaurée est naturelle en Égypte.
24- C h a n v r e , cannabis sa liv a , Linn.; en
arabe, hachichc (a). Le chanvre, selon les Égyp-
nens , est ia plante par excellence, non pour les
avantages qu’on en tire en Europe et dans beaucoup
d'autres pays, mais à cause des singulières
propriétés qu’ils lui attribuent. Celui qu’on cultive
en Egypte, est enivrant et narcotique. On se
sert des feuilles et des sommités de cette plante,
quil faut cueillir avant leur maturité : dans cet
état, on en frit une conserve qui sert à composer
le t i r e t , le dyâsmouk, le bcmâouy. Les feuilles de
chanvre réduites en poudre et incorporées dans
du miel, ou délayées dans de l’eau, font la base
du bereh des pauvres. Ceux-ci s’enivrent encore
en fumant le chanvre seul, ou mêlé avec le tabac :
on en fait une grande consommation en Égypte
ou on ne le cultive que pour cet usage.
Le chanvre d’Égypte est-il le même que celui
d Europe ! doit-il ses propriétés à la culture ou au
climat l
2 y C lous de girofle, caryophyllus aromat
e s Linn. ; en arabe, coroumfil (3). Ce fruit est
usité commestomachique et aphrodisiaque. Il entre
dans les électuaires échauffons et dans plusieurs
sorbets. Les femmes en mâchent souvent, et quelques
unes en font des colliers.
Le girofle est apporté de l’Inde.
M E D I C A M E N S U S U E L S
28. D je b b e l-ind e (6), semence très-fine,
jaunâtre, sans odeur et d’une saveur âcre. Elle est
émétique à la dose de trente à trente-six grains.
es Egyptiens, qui ne coiinoissent point l’usage
du tartrite dépotasse antimonié, ni celui'de l’ipé-
cacuanha, emploient quelquefois cette semence
comme vomitif.
Elle est apportée de Tlnde : on ne la trouve pas
parmi les drogues dont on foit usage en Europe.
2 p . É c h a r (7 ) , racine rougeâtre, de la grosseur
du doigt, mucilagineuse et d’une saveur légèrement
aromatique. Elle est souvent employée dans
la dyssenterie et dans les fleurs blanches : on la
mêle quelquefois avec les poudres purgatives
pour en corriger l’amertume et pour en diminuer
1 activité.
Cette racine vient de l’Inde : elle ne se trouve
pas dans les médicamens usités en Europe.
30. Aèche el- naune (8), racine charnue,
jaunâtre, découpée par quartiers, sans odeur
d’une saveur alcaline : on l’emploie dans les rétentions
d urine et dans l’hydropisie. Elle sert aussi
divers usages domestiques : par exemple , les
Egyptiens remploient pour se laver les mains
avant et après les repas, et pour enlever des étoffes
les taches produites par des corps gras.
Cette racine est apportée de la Syrie : elle n’est
pas usitée en Europe.
26. C olo quinte, cucumisco/ocynthis, Linn.•
en arabe, handal (4). On emploie la coloquinte
comme vermifuge et antisiphilitique. Les habitans
des campagnes et les Arabes s’en servent comme
purgatif.
Elle vient en Égypte et en Arabie.
2 7 . C urcuma , curcuma longa, Linn. ; en
arabe, courcoume (5). La racine du curcuma est considérée
comme spécifique contre la jaunisse. Elle
entre dans plusieurs électuaires toniques.
On l’apporte des Indes.
(0 Qantaryoun,
(») Hachych, jjUàa,.
(3) Qaranfoul, J j ü j i .
(4) K h a n ta i, JJîâ». .
(f) Kourkoum, ..
(6) C e bel H t n J } , J a i s . .
3 1 . E l l é b o r e , helhborus niger, Lin n . - e
« a b e , sour naham (9). C e tte racine est regard*
comme p ropre à dissiper la m é lan co lie , à donn,
du cou rag e e t de la confiance. E lle entre dans 1*
opiats en tv ran s , e t particulièrement dans le berei
O n 1 apporte d’Europe .
3 2 . E u p h o r b e , euphorbia officinalis, L i „ n. • ei
a ra b e , forfioune ( , o). C e tte résine sert de purgati
dans la jaunisse et dans les maladies vénériennes
E lle v ient de la Barbarie.
3 3 . G a i a c , guaiacum officinale, Lin n . - en
ara b e , kaehab élembié ( , , ) . Le s râpures de c e bois
servent à calmer la douleu r des dents et à forti-
ner les g enciv es .
(7) Échâr, J U i .
(!) A>cO.
{9) Sour-nahâtt, y ^ ,
(10) UyjjJ.
( ‘ i) Kl,achat U - i V | ■ ,
D E S É G Y P T I E N S .
Il est apporté par les marchands d’Europe, qui
le reçoivent d’Amérique.
2 4 - G A LAN G A , maranta galanga, L in n . ; en
arabe , coulinganne ( i) . O n emploie cette racine
comme stomachique e t aphrodisiaque. E lle entre
dans plusieurs électuaires.
Le galanga viént des Indes. ,
35« Galbanum , bubon gaibanum, Linn.; en
arabe, ganaouachak (2). Les femmes l’emploient en
fumigation dans les maladies hystériques et contre
les violens maux de tête.
Cette résine vient de.i’Ethiopiev
36. Ge n t ia n e , gentiana lutea, Linn.; en
arabe, gintianne (3). Cette racine est estimée tonique
et fébrifuge. Elle fait la base de presque
toutes les poudres composées, dont les Égyptiens
font usage dans plusieurs maladies.
On l’apporte d’Europe.
37* Gingembre, amomum ^in^iber, Linn.; en
arabe, ÿnsebiê (4). Cette racine est un des principaux
échaufïàns et aphrodisiaques usités. Le gingembre
entre dans la grande thériaque, dans le
berch et dans. le bernâouy.
II vient des Indes orientales.
38- Gomme adragante , astragalus tragacan-
tha, Linn.; en arabe, ketiré béda (j). On donne
cette substance dans les empoisonnemens, dans la
rétention d’urine et dans la gonorrhée. On l’emploie
aussi extérieurement dans l’ophthalmie.
On l’apporte d’Europe.
39' Gomme g u t t e , cambogïagutta, Linn. ; en
arabe , roub-raoune (6). Cette résine est employée
comme purgatif dans les maladies vénériennes.
Elle vient de la Perse et de l’Inde.
4o. G omme ammoniaque , gummi résina,
ammoniacum ; en arabe, calak (7). Les femmes en
prennent intérieurement comme emménagogue.
Elle vient de la Barbarie.
(1) Khoulingân, .
(а) Qanâouâcheq,
( j ) Getttyânâ, liL xX a . •
14) Ztngebyl,
( i ) Ketyrâ btydâ, i X o f
(б) Roubb râouend, ¿ J j -
(7) ÿ k Ü .
2 2 J
4 L Gomme A r a b 1 q u e , mimosa Nilotica ,
Linn. ; en arabe, sambr Arabi (8),Les Égyptiens en
font usage dans les affections de poitrine, dans la
diarrhée et dans la gonorrhée. Ils l’emploient aussi
extérieurement dans l’ophthalmie.
Elle vient de l’Arabie. Celle qu’on récolte en
Egypte et dans l’Ethiopie, est rouge, et ne sert que
dans les arts.
42. Grenade , punica granatum , Linn. ; en
arabe, roummanne (9). On fait usage de ce fruit
dans la fièvre et dans la dyssenterie. Son écorce
est employée extérieurement comme antiseptique.
Çe fruit est très-commun en Égypte.
43* Habbanil (10) , semence noirâtre, triangulaire,
dure et presque cornée, grisâtre intérieurement.
Elle est hydragogue. Les nègres qui sont
en Egypte, n’emploient que cette semence pour se
purger.
On l’apporte de I’Éthiopie.
44* Habb e l-h a z is (11), cyperus esculentus,
Linn. ; racine ayant la forme de petits tubercules grisâtres,
charnus, d’une saveur douce et agréable.
Elle est pectorale et nutritive. Les femmes en
mangent dans l’intention d’acquérir de l’embonpoint.
La plante dont on tire cette racine, croît dans
la basse Egypte.
4y- Henné (i 2) , lausonia inermis, Linn. Lès
naturels du pays se servent des feuilles de cet
arbrisseau , qui croît communément en Égypte,
pour se teindre en rouge le dedans des mains, la
plante des pieds, les ongles, la barbe et les cheveux.
On retire aussi des fleurs une eau distillée ,
d’une odeur agréable. Les femmes l’estiment beaucoup
, et en font .usage pour laver et adoucir la
peau.
46. Hermodacte , iris tuberosa , Linn. ; en
arabe, camiré (i 3). Les femmes mangent cette racine
dans l’intention d’acquérir beaucoup d’embonpoint.
On la foit légèrement rôtir pour lui
(8) Santgh A'raby, ¿ j a .
(?) Rottmmân, q U L .
( 10 ' Habb elaylt J U I i f .
( 1 1 ) Habbela’zyz, JJLa..
(>2) Hennâ , L L s . .
(13) Khamyreh, 8 ^ ^ .