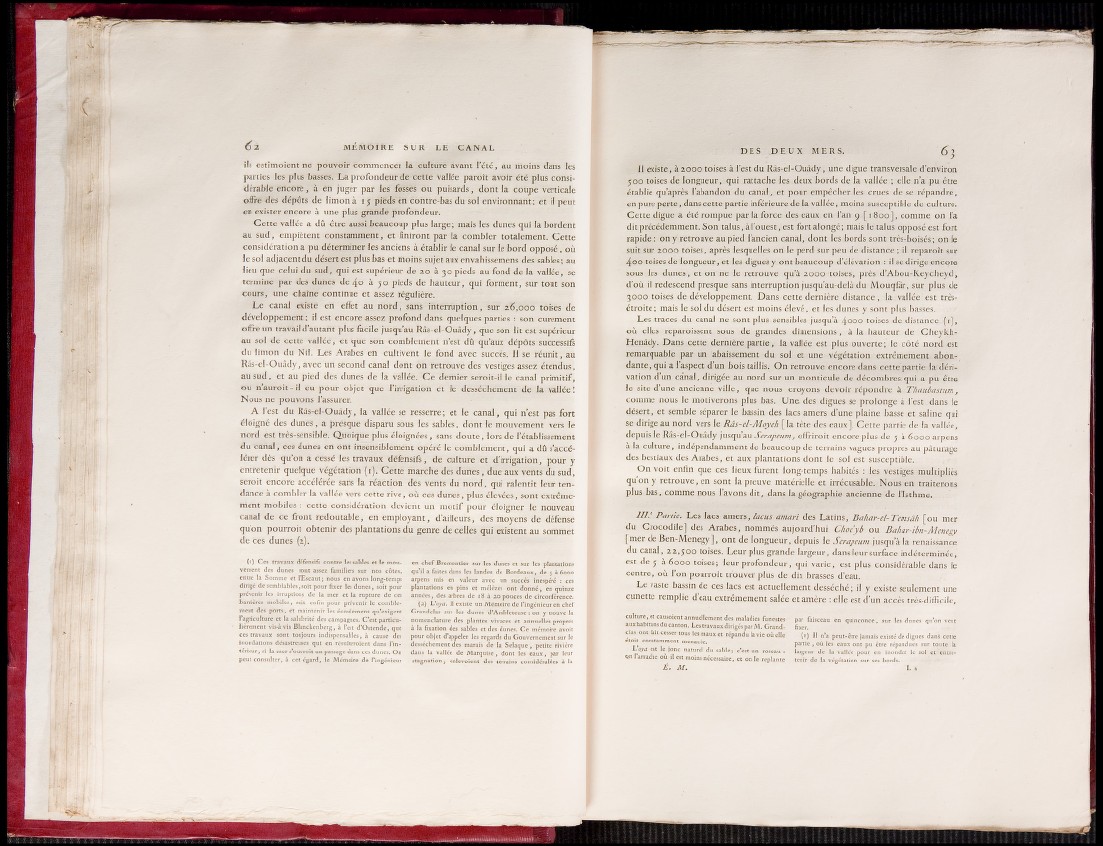
ils estimoient ne pouvoir commencer la culture avant Jeté, au moins dans les
parties les plus basses. La profondeur de cette vallée paraît avoir été plus considérable
encore, à en juger par les fossés ou puisards, dont la coupe verticale
offre des dépôts de limon à 15 pieds èn contre-bas du sol environnant; et il peut
en exister encore à une plus grande profondeur.
Cette vallée a dû être aussi beaucoup plus large; mais les dunes qui la bordent
au sud, empiètent constamment, et finiront par la combler totalement. Cette
considération a pu déterminer les anciens à établir le canal sur le bord opposé, où
le sol adjacent du désert est plus bas et moins sujet aux envahissemens des sables; au
lieu que celui du sud, qui est supérieur de 20 à 30 pieds au fond de la vallée, se
termine par des dunes de 4o à 50 pieds de hauteur, qui forment, sur tout son
cours, une chaîne continue et assez régulière.
Le canal existe en effet au nord, sans interruption, sur 26,000 toises de
développement ; il est encore assez profond dans quelques parties : son curement
offre un travail d’autant plus facile jusqu’au Râs-el-Ouâdy, que son lit est supérieur
au sol de cette vallée, et que son comblement n’est dû qu’aux dépôts successifs
du limon du Nil. Les Arabes en cultivent le fond avec succès. Il se réunit, au
Râs-el-Ouâdy, avec Un second canal dont on retrouve des vestiges assez étendus,
au sud, et au pied des dunes de la vallée. C e dernier seroit-il le canal primitif,
ou n aurait-il eu pour objet que l’irrigation et le dessèchement de la vallée î
Nous ne pouvons l’assurer.
A l’est du Râs-el-Ouâdy, la vallée se resserre; et le canal, qui n’est pas fort
éloigné des dunês, a presque disparu sous les sables, dont le mouvement vers le
nord est très-sensible. Quoique plus éloignées, sans doute, lors de l’établissement
du canal, ces dunes en ont insensiblement opéré le comblement, qui a dû s’accélérer
des quon a cesse les travaux défensifs, de culture et d’irrigation, pour y
entretenir quelque végétation (1). Cette marche des dunes, due aux vents du sud,
seroit encore accélérée sans la réaction dés vents du nord, qui ralentit leur tendance
à combler la vallée vers cette rive, où ces dunes, plus élevées, sont extrêmement
mobiles : cette considération devient un motif pour éloigner le nouveau
canal de ce front redoutable, en employant, d’ailleurs, des moyens de défense
qu’on pouiToit obtenir des plantations du genre de celles qui existent au sommet
de ces dunes (2).
(0 Ces travaux défensifs contre les sables et le mou- en ch e f Bremontier sur les dunes et sur les plantations
ventent des dunes sont assez familiers sur nos côtes, qu’il a faites dans les landes de Bordeaux, de 5 à 6000
entre la Somme et l’Escaut; nous en avons long-temps arpens mis en valeur avec un succès inespéré : ces
dirigé de semblables, soit pour fixer les dunes, soit pour plantations en pins et mélèzes ont d onné , en quinze
prévenir les irruptions de la mer et la rupture de ces années, des arbres de 18 à 20 pouces de circonférence,
barrières mobiles, soit enfin pour prévenir le comble- (a) L'oya. II existe un Mémoire de l‘ ingénieur en chef
ment des ports, et maintenir les écoulemens qu’exigent Grandclas sur les dunes d’Ambleteuse : on y trouve la
l’agriculture et la salubrité des campagnes. C ’est partira- nomenclature des plantes vivaces et annuelles propres
lièrement vis-à vis Blanckenberg, à l’est d’Ostende, que à la fixation des sables et des dunes. C e mémoire avoit
ces travaux sont toujours indispensables, à cause des pour objet d’appeler les regards du Gouvernement sur le
inondations désastreuses qui en résulteraient dans l’in - dessèchement des marais de la S elaqu e, petite rivière
térieur, si la mer s’ouvroit un passage dans ces dunes. On dans la vallée de Marquise, dont les eaux, par leur
peut consulter, à cet égard, le Mémoire de l’ingénieur stagnation, enlevoient des terrains considérables à la
Il existe, à 2000 toises à l’est du Râs-el-Ouâdy, une digue transversale d’environ
jo o toises de longueur, qui rattache les deux bords de la vallée ; elle n’a pu être
établie qu’après l’abandon du canal, et pour empêcher les crues de se répandre,
en pure perte, dans cette partie inférieure de la vallée, moins susceptible de culture.
Cette digue a été rompue par la force des eaux en l’an 9 [1800], comme on l’a
dit précédemment. Son talus, à l’ouest, est fortalongé; mais le talus opposé est fort
rapide : ony retrouve au pied l’ancien canal, dont les bords sont très-boisés; on le
suit sur 2000 toises, après lesquelles on le perd sur peu de distance ; il reparaît sur
4oo toises de longueur, et les digues y ont beaucoup d’élévation : il se dirige encore
sous les dunes, et on ne le retrouve qu’à 2000 toises, près d’Abou-Keycheyd,
d’où il redescend presque sans interruption jusqu’au-delà du Mouqfâr, sur plus de
3000 toises de développement. Dans cette dernière distance, la vallée est très-
étroite; mais le sol du désert est moins élevé, et les dunes y sont plus basses.
Les traces du canal ne sont plus sensibles jusqu’à 4ooo toises de distance (1),
où elles reparaissent sous de grandes dimensions, à la hauteur de Cheykh-
Henâdy. Dans cette dernière partie, la vallée est plus ouverte; le côté nord est
remarquable par un abaissement du sol et une végétation extrêmement abondante,
qui a 1 aspect d’un bois taillis. On retrouve encore dans cette partie, la dérivation
d un canal, dirigée au nord sur un monticule de décombres: qui a pu être
le site d’une ancienne ville, que nous croyons devoir répondre à Thaubastum,
comme nous le motiverons plus bas. Une des digues se prolonge à l’est dans le
désert, et semble séparer le bassin des lacs amers d’une plaine basse et saline qui
se dirige au nord vers le Râs-cl-Moyeh [la tête des eaux]. Cette partie de la vallée,
depuis le Râs-el-Ouâdy jusqu’au Serapeum, offrirait encore plus de 5 à 6000 arpens
à la culture, indépendamment de beaucoup de terrains vagues propres au pâturage
des bestiaux des Arabes, et aux plantations dont le sol est susceptible.
On voit enfin que ces lieux furent long-temps habités : les vestiges multipliés
qu’on y retrouve, en sont la preuve matérielle et irrécusable. Nous en traiterons
plus bas, comme nous lavons dit, dans la géographie ancienne de l’Isthme.
bll. Partie. Les lacs amers, lacus atuan des Latins, Bahar-el-Temsâfi [ou mer
du Crocodile] des Arabes, nommés aujourd’hui Choe’yb ou Bahar-ibn-Menegy
[mer de Ben-Menegy], ont de longueur, depuis le Serapeum jusqu’à la renaissance
du canal, 22,500 toises. Leur plus grande largeur, dans leur surface indéterminée,
est de 5 à 6000 toises; leur profondeur, qui varie, est plus considérable dans le
centre, ou 1 on pourrait trouver plus de dix brasses d’eau.
Le vaste bassin de ces lacs est actuellement desséché; il y existe seulement une
cunette remplie d’eau extrêmement salée et amère : elle est d’un accès très-difficile,
culture, et causoient annuellement des maladies funestes par faisceau en quinconce, sur les dunes qu’on veut
auxhabitansdu canton. Les travaux dirigés par M. Grand- fixer.
cïas ont fait cesser tous les maux et répandu la vie ou elle (i) Il n*a peut-être jamais existé de digues dans cette
etoit constamment menacée. partie , où les eaux ont pu être répandues sur toute la
oya est e joue naturel du sable; ces t un roseau : largeur de la vallée pour en inonder le sol et'entre-
Qn arrac e ou i est moins nécessaire, et on le replante tenir de la végétation sur ses bords.
Ê . M . L 2