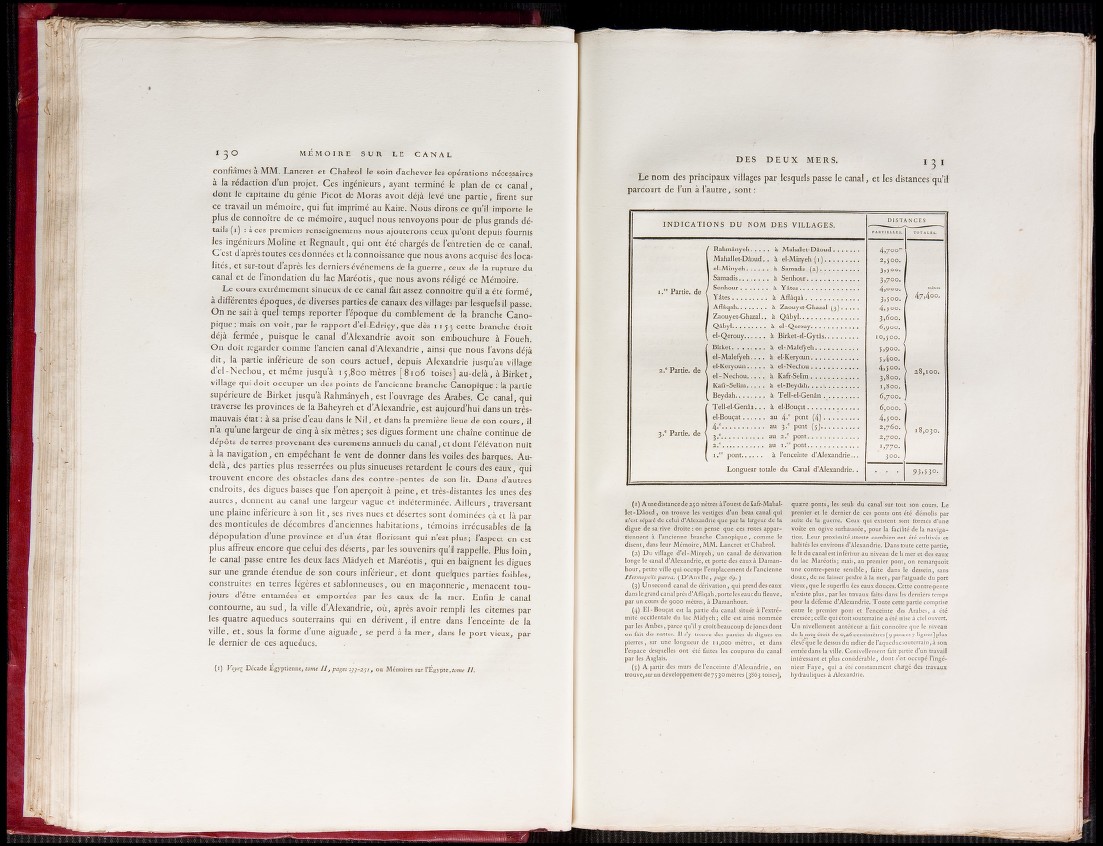
confiâmes à MM. Lancret et Chabrol le soin d’achever les opérations nécessaires
à la rédaction d’un projet. Ces ingénieurs, ayant terminé le plan de ce canal,
dont le capitaine du génie Picot de Moras avoit déjà levé une partie, firent sur
ce travail un mémoire, qui fut imprimé au Kaire. Nous dirons ce qu’il importe le
plus de connoître de ce mémoire, auquel nous renvoyons pour de plus grands détails
(i) : à ces premiers renseignemens nous ajouterons ceux qu’ont depuis fournis
les ingénieurs Moline et Regnault, qui ont été chargés de l’entretien de ce canal.
C est d après toutes ces données et la connoissance que nous avons acquise des localités,
et sur-tout d’après les derniers événemens de la guerre, ceux de la rupture du
canal et de 1 inondation du lac Maréotis, que nous avons rédigé ce Mémoire.
Le cours extrêmement sinueux de ce canal fait assez connoître qu’il a été formé,
à différentes époques, de diverses parties de canaux des villages par lesquels il passe.
On ne sait à quel temps reporter l’époque du comblement de la branche Cano-
pique; mais on voit,par le rapport d’el-Edriçy, que dès i 153 cette branche étoit
déjà fermée, puisque le canal d’Alexandrie avoit son embouchure à Foueh.
On doit regarder comme l’ancien canal d’Alexandrie, ainsi que nous l’avons déjà
dit, la partie inférieure de son cours actuel, depuis Alexandrie jusqu’au village
d’el-Nechou, et même jusqu’à 15,800 mètres [8106 toises] au-delà, à Birket,
village qui doit occuper un des points de l’ancienne branche Canopique : la partie
supérieure de Birket jusqu’à Rahmânyeh, est l’ouvrage des Arabes. Ce canal, qui
traverse les provinces de la Bahcyreh et d’Alexandrie, est aujourd’hui dans un très-
mauvais état : à sa prise d eau dans le Nil, et dans la première lieue de son cours, il
n’a qu’une largeur de cinq à six mètres ; ses digues forment une chaîne continue de
dépôts de terres provenant des curemens annuels du canal, et dont l’élévation nuit
à la navigation, en empêchant le vent de donner dans lés voiles des barques. Au-
delà, des parties plus resserrées ou plus sinueuses retardent le cours des eaux, qui
trouvent encore des obstacles dans des contre-pentes de son lit. Dans d’autres
endroits, des digues basses que l’on aperçoit à peine, et très-distantes les unes des
autres, donnent au canal une largeur vague et indéterminée. Ailleurs, traversant
une plaine inférieure à son lit, ses rives nues et désertes sont dominées çà et là par
des monticules de décombres d’anciennes habitations, témoins irrécusables de la
dépopulation d’une province et d’un état florissant qui n’est plus ; l’aspect en est
plus affreux encore que celui des déserts, par les souvenirs qu’il rappelle. Plus loin
le canal passe entre les deux lacs Mâdyeh et Maréotis, qui en baignent les digues
sur une grande étendue de son cours inférieur, et dont quelques parties foibles,
construites en terres légères et sablonneuses, ou en maçonnerie, menacent toujours
d’être entamées' et emportées par les eaux de la mer. Enfin Je canal
contourne, au sud, la ville d’Alexandrie, où, après avoir rempli les citernes par
les quatre aqueducs souterrains qui en dérivent, il entre dans l’enceinte de la
ville, et, sous la forme d’une aiguade, se perd à la mer, dans le port vieux, par
le dernier de ces aqueducs.
(0 V°ytl D écade E gyptienne, tome I I , pages o jj- z p , ou M ém oires sur l’E gypte, tome I I .
Le nom des principaux villages par lesquels passe le canal, et les distances qu’il
parcourt de l’un à l’autre, sont :
I N D I C A T I O N S D U N O M D E S V I L L A G E S .
D I S T A N C E S
PARTIELLES. TOTALES.
R ahm ân y eh . . . . à M aha llet-D âou d ................. 4 ,7 0 0 "
Mahallet-Dâoud. à el-Minyeh ( 1 ) ....................... 2 ,50 0 .
3 ,50 0.
Samadis................. à Senh ou r................................... 3,70 0 .
i . ie Partie, d e 1
S en h o u r ...............
Y á t e s .......................
à Y â t e s ........................................
à A f lâ q a h ....................................
4 ,o o o .
3 ,50 0.
mètres
) 4 7 ,4 o o .
I Aflâqah.................... à Zaouyet-Ghazal ( 3 ) ............ 4 ,50 0 .
Za ou y e t-G h a zal.. à Q â b y l........................................ 3 ,600 .
Q â b y l...................... à e l-Q e ro u y ................................• 6,90 0.
e l-Q e rou y .............. à Birket-e l-Gytâs...................... 10 ,500 .
B irk e t...................... à. e l-M a le fy eh ............................ 5,900.
e l -M a le fy e h .. . . à el-Keryoun............................... 5,4o o .
2 .0 Partie, de <
el-Keryoun............
e l-N e c h o u ............
à e l-N e c h o u ...............................
à. Kafr-Se lim............................. ..
0 o’
0 0
tst OO
PO
1 2 8 ,10 0 .
Kafr-Se lim............ à e l-B e y d a h .. . . -....................... I ,80 0 .
Beydah................... à T e ll-e l-G en ân . .................... d ,7 00.
T ell-el-G enân. . . à el-B ou ça t.................................. 6,000.
el-B ou ca t.............. au 4 *° p o n t (4 ) .....................
00
3*c Partie, d e { 4 .” ............................
3-°- ■ ■ • ................
au 3.® pont (5 ) .........................
au 2.® p o n t ..................................
2 ,7 6 0 .
2 ,70 0 .
5 l8 ,0 3 0 .
O c 1 ,7 7 0 .
i . cr p on t.............. à l ’enceinte d’Alex an d r ie . . . 300. 1
Longueur totale du C an a l d’A le x a n d r ie .. 9 3>53°*
(1) A une distance de 250 mètres àl’ouest de Kafr-M ahal-
let-D â o u d , on trouve les vestiges d’un beau canal qui
n’est séparé de celui d’A lexandrie que par la largeur de la
digue de sa rive droite : on pense que ces restes appartiennent
à l’ancienne branche C an o p iq u e, com m e le
disent, dans leur M ém oire, M M . L ancret et C habrol.
(2) D u village d’el-M inyeh, un canal de dérivation
longe le canal d’A lexandrie, et porte des eaux à D am an-
ho u r, petite ville qui occupe l’em placem ent de l’ancienne
Hermopolis parva, (D ’A nville, page 6p. )
(3) U n second canal de dérivation, qui prend des eaux
dans le grand cariai près d’A flâqah, porte les eaux du fleuve,
par un .cours de 9000 m ètres, à D am anhour.
(4) E l - Bouçat est la partie du canal située à l’extrém
ité occidentale du lac M âdyeh ; elle est ainsi nom m ée
par les A rabes, parce qu’il y croîtbeaucoup de joncs dont
on fait des nattes. II s’y trouve des parties de digues en
pierres, sur une longueur de 11,000 m ètres, et dans
l’espace desquelles o n t été faites les coupures du canal
par les Anglais.
(5) A partir des m urs de l’enceinte d’A lexandrie, on
trouve,sur un développem ent d ey jjo m è tre s [3863 toises],
quatre p onts, les seuls du canal sur tout son cours. Le
prem ier et le dernier de ces ponts ont été dém olis par
suite de la guerre. C eux qui existent sont formés d’une
voûte en ogive surhaussée, pour la facilité de la navigation.
L eur proxim ité atteste com bien ont été cultivés et
habités les environs d’A lexandrie. D ans toute cette partie,
le lit du canal est inférieur au niveau de la m er et des eaux
du lac M aréotis; m ais, au prem ier p o n t, on rem arquoit
une contre-pente sensible, faite dans le dessein, sans
d o u te, de ne laisser perdre à la m er, par l’aiguade du port
vieux, que le superflu des eaux douces. C ette contre-pente
n’existe plus, par les travaux faits- dans les derniers temps
pour la défense d’A lexandrie. T ou te cette partie comprise
entre le prem ier pont et l’enceinte des A rabes, a été
creusée; celle qui étoit souterraine a été mise à ciel ouvert.
U n nivellem ent antérieur a fait connoître que le niveau
de la m er étoit de 0,26 centim ètres [9 pouces 7 lignes]plus
élevé*que le dessus du radier de l’aqueduc souterrain,à son
entrée dans la ville. C e nivellem ent fait partie d’un travail
intéressant et plus considérable, dont s’est occupé l’ingénieur
F ay e, qui a été constam m ent chargé des travaux
hydrauliques à Alexandrie.
s i l i í f l i H I L Î 4 S t ; ' 1 î