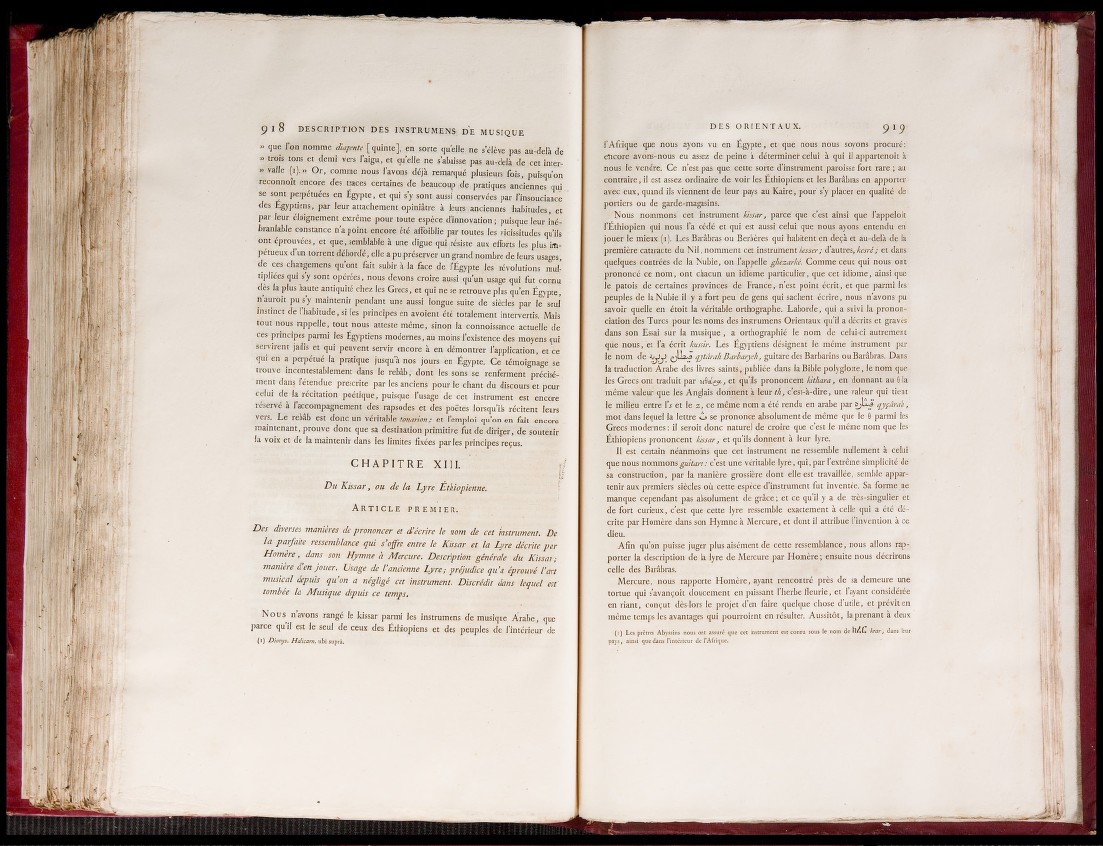
» que Ton nomme diapentc[quinte], en sorte quelle ne s’élève pas au-delà de
« trois tons et demi vers l’aigu, et qu’elle ne s’abaisse pas au-delà de cet inter-
» valle (,i).» O r, comme nous l’avons déjà remarqué plusieurs fois, puisqu’on
reconnoît encore des traces certaines de beaucoup de pratiques anciennes qui
se sont perpétuées en Égypte, et qui s’y sont aussi conservées par l’insouciance
des Egyptiens, par leur attachement opiniâtre à leurs anciennes habitudes, et
par leur éloignement extrême pour toute espèce d’innovation ; puisque leur inébranlable
constance n’a point encore été affoiblie par toutes les vicissitudes qu’ils
ont éprouvées, et que, semblable à une digue qui résiste aux efforts les plus impétueux
d’un torrent débordé, elle a pu préserver un grand nombre de leurs usages,
de ces changemens qu’ont fait subir à la face de l’Égypte les révolutions multipliées
qui s y sont opérées, nous devons croire aussi qu’un usage qui fut connu
dès la plus haute antiquité chez les Grecs, et qui ne se retrouve plus qu’en Égypte,
n aurbit pu s’y maintenir pendant une aussi longue suite de siècles par le seul
instinct de 1 habitude, si les principes en avoient été totalement intervertis. Mais
tout nous rappelle, tout nous atteste même, sinon la connoissance actuelle de
ces principes parmi les Égyptiens modernes, au moins l’existence des moyens qui
servirent jadis et qui peuvent servir encore à en démontrer l’application, et ce
qui en a perpétué la pratique jusqua nos jours en Égypte. Ce témoignage se
tiouve incontestablement dans le rebâb; dont les sons se renferment précisément
dans l’étendue prescrite par les anciens pour le chant du discours et pour
celui de la recitation poétique, puisque l’usage de cet instrument est encore
réservé à l’accompagnement des rapsodes et des poètes lorsqu’ils récitent leurs
vers. L e rebâb est donc un véritable tonarion; et l’emploi qu’on en fait encore
maintenant, prouve donc que sà destination primitive fut de diriger, de soutenir
la voix et de la maintenir dans les limites fixées par les principes reçus.
C H A P I T R E X I I I .
D u K issa r, ou de la Lyre Éthiopienne.
A r t i c l e p r e m i e r .
D es diverses maniérés de prononcer et d’écrire le nom de cet instrument. D e
la parfaite ressemblance qui s ’offre entre le Kissar et la Lyre décrite par
H om ere, dans son Hymne à Mercure. Description générale du Kissar ;
maniéré d en jouer. Usage de l ’ancienne Lyre; préjudice qu’a éprouvé l ’art
musical depuis qu ’on a négligé cet instrument. Discrédit dans lequel est'
tombée la M usique depuis ce temps.
N o u s n avons rangé le kissar parmi les instrumens de musique Arabe, que
parce quil est le seul de ceux des Éthiopiens et des peuples de l’intérieur de
(0 Dionys. Halicam. ubi suprà.
l’Afrique que nous ayons vu en Égypte, et que nous nous soyons procuré :
ehcore avons-nous eu assez de peine à déterminer celui à qui il appartenoit à'
nous le vendre. Ce n’est pas que cette sorte d’instrument paroisse fort rare ; au
contraire, il est assez ordinaire de voir les Éthiopiens et les Barâbras en apporter
avec eux, quand ils viennent de leur pays au Kaire, pour' s’y placer en qualité de
portiers ou de garde-magasins.
Nous nommons cet instrument kissar, parce que c’est ainsi que l’appeloit
l’Éthiopien qui nous l’a cédé et qui est aussi celui que nous ayons entendu en
jouer le mieux (i). Les Barâbras ou Berbères qui habitent en deçà et au-delà de la
première cataracte du N il, nomment cet instrument kesser; d’autres, kesré; et dans
quelques contrées de la Nubie, on l’appelle gliezarké. Comme ceux qui nous ont
prononcé ce nom, ont chacun un idiome particulier, que cet idiome, ainsi que
le patois de certaines provinces de France,-n’est point écrit, et que parmi les'
peuples de la Nubie il y a fort peu de gens qui sachent écrire, nous n’avons pu
savoir quelle en étoit la véritable orthographe. Laborde, qui a suivi la prononciation
des Turcs pour les noms des instrumens Orientaux qu’il a décrits et gravés
dans son Essai sur la musique , a orthographié le nom de celui-ci autrement
que nous, et l’a écrit kussir. Les Égyptiens désignent le même instrument par
le nom de qytârali Barbaiyeh, guitare des Barbarins ou Barâbras. Dans
la traduction Arabe des livres saints, publiée dans la Bible polyglotte, le nom que
les Grecs ont traduit par i et qu’ils prononcent kitliara, en donnant au 6 la
même valeur que les Anglais donnent à leur tli, c'est-à-dire, une valeur qui tient
le milieu entre ïs et le z , ce même nom a été rendu en arabe par qyçârah,
mot dans lequel la lettre *L> se prononce absolument de même que le 9 parmi les
Grecs modernes : il seroit donc naturel de croire que c’est le même nom que les
Éthiopiens prononcent kissar, et qu’ils donnent à leur lyre.
Il est certain néanmoins que cet instrument ne ressemble nullement à celui
que nous nommons guitare : c’est une véritable lyre, qui, par l’extrême simplicité dé
sa construction, par la manière grossière dont elle est travaillée, semble appartenir
aux premiers siècles où cette espèce d’instrument fut inventée. Sa forme ne
manque cependant pas absolument de grâce ; et ce qu’il y a de très-singulier et
de fort curieux, c’est que cette lyre ressemble exactement à celle qui a été décrite
par Homère dans son Hymne à Mercure, et dont il attribue 1 invention à ce
dieu.
Afin qu’on puisse juger plus aisément de cette ressemblance, nous allons rapporter
la description de la lyre de Mercure par Homère ; ensuite nous décrirons
celle des Barâbras.
Mercure, nous rapporte Homère, ayant rencontré près de sa demeure une
tortue qui s’avançoit doucement en paissant l’herbe fleurie, et 1 ayant considérée
en riant, conçut dès-lors le projet d’en faire quelque chose d’utile, et prévit en
même temps les avantages qui pourroient en résulter. Aussitôt, la prenant à deux
([) Les prêtres Abyssins nous ont assuré que cet instrument est connu sous le nom de ïlltl. kr:ir, dans leur
pays, ainsi que dans l’intérieur de l’Afrique.