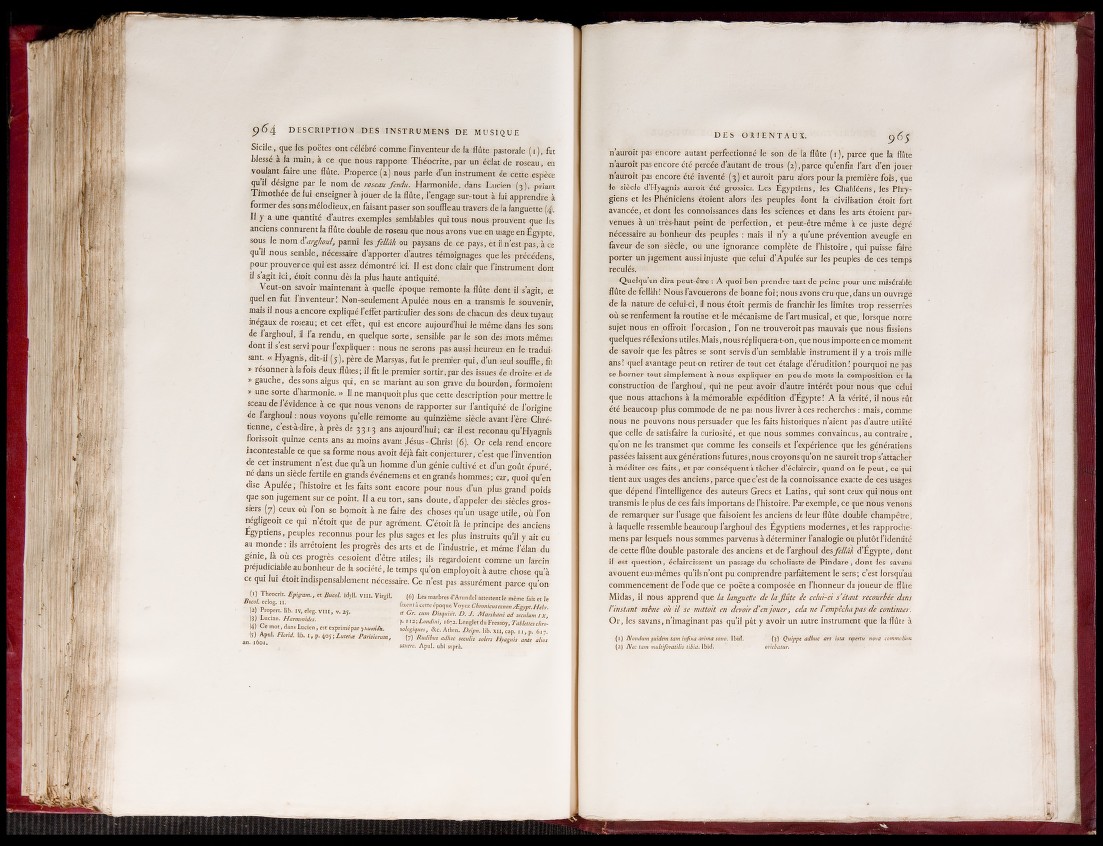
Sicile, que les poëtes ont célébré comme Finventeur de la flûte pastorale ( 1 ), fut
blessé a la main, à ce que nous rapporte Théocrite, par un éclat de roseau, en
voulant faire une flûte. Properce (2) nous parle d’un instrument de cette espèce
quil désigne par le nom de roseau fendu. Harmonide, dans Lucien (3), priant
Timothée de lui enseigner à jouer de la flûte, l’engage sur-tout à lui apprendre à
former des sons mélodieux, en faisant passer son soufHe au travers de la languette (4).
Il y a une quantité d autres exemples semblables qui tous nous prouvent que les
anciens connurent la flûte double de roseau que nous avons vue en usage en Égypte,
sous le nom Sarghoul, parmi les fellâli ou paysans de ce pays, et il n’est pas, à ce
quil nous semble, nécessaire d’apporter d’autres témoignages que les précédées,
pour prouver ce qui est assez démontré ici. Il est donc clair que l’instrument dont
il s agit ici, ¿toit connu dès la plus haute antiquité.
Veut-on savoir maintenant à quelle époque remonte la flûte dont il s’agit, et
quel en fut 1 inventeur! Non-seulement Apulée nous en a transmis le souvenir,
mais il nous a encore expliqué l’effet particulier des sons de chacun des deux tuyaux
inégaux de roseau; et cet effet, qui est encore aujourd’hui le même dans les sons
de larghoul, il la rendu, en quelque sorte, sensible par le son des mots mêmes
dont il s’est servi pour l’expliquer : nous ne serons pas aussi heureux en le tradu'i-
sant. « Hyagnis, dit-il (y), père de Marsyas, fut le premier qui, d’un seul souffle, fit
» résonner à la fois deux flûtes ; il fit le premier sortir, par des issues de droite et de
» gauche, des sons aigus qui, en se mariant au son grave du bourdon, formoient
» une sorte d harmonie. » Il ne manquoit plus que cette description pour mettre le
sceau de 1 évidence à ce que nous venons de rapporter sur 1 antiquité de l’origine
de 1 arghoul : nous voyons quelle remonte au quinzième siècle avant l’ère Chrétienne,
cest-à-dire, à près de 3313 ans aujourd’hui; car il est reconnu qu’Hyagnis
florissoit quinze cents ans au moins avant Jésus- Christ (6). Or cela rend encore
incontestable ce que sa forme nous avoit déjà fait conjecturer, ¿est que l’invention
de cerinstrument n est due qu’à un homme d’un génie cultivé et d’un goût épuré,
né dans un siècle fertile en grands événemens et en grands hommes ; car, quoi qu’en
dise Apulée, 1 histoire et les faits sont encore pour nous d’un plus grand poids
que son jugement sur ce point. Il a eu tort, sans doute, d’appeler des siècles grossiers
(7) ceux où l’on se bomoit à ne faire des choses qu’un usage utile, où l’on
negiigeoit ce qui n’étoit que de pur agrément. C etoit là le principe des anciens
Egyptiens, peuples reconnus pour les plus sages et les plus instruits qu’il y ait eu
au monde : ils arrêtoient les progrès des arts et de l’industrie, et même l’élan du
génie, là où ces progrès cessoient detre utiles; ils regardoient comme un larcin
préjudiciable au bonheur de la société, le temps qu’on employoit à autre chose qu’à
ce qui lui étoit indispensablement nécessaire. Ce n’est pas assurément parce qu’on
(0 Theocrit.eclog. 11.
Epigram., et Bucol. idylL v in . Virgil. (6) Les marbres d’Arundel attestent le même fait et le Bucol,(2) Propert. lîb. I V , efeg. v iil, v. 25.
fixent à cette époque. Voyez Chronicus canon Ægypt. Hebr.
(3) Lucian. et Gr. cum Disquisit. 1). J. JVIarshami ad seculum Harmonides.
I X , (4) C e m ot, dans L ucien, est exprimé par p. 1 \ Londini, 1672. Lenglet du Fresnoy, (5) Apui. lib. I , p. yxuùdJk. 4°5> &c. Athen. Deipn. Iib. x n , cap.Tablettes 11, p. chronologiques,
6.17.
an. 1601.
Florid,Lutetice Parisiorum, (7) Rudibus adhuc seeuhs solcrs Hyagnis ante alios
cancre, Apui., ubi suprà.
n’auroit pas encore autant perfectionné le son de la flûte ( i) , parce que la flûte
n’auroit pas encore été percée d’autant de trous (2), parce qu’enfin Fart d’en jouer
n’auroit pas encore été inventé (3) et auroit paru alors pour la première fois, que
le siècle d’Hyagnis auroit été grossier. Les Égyptiens, les Chaldéens, les Phrygiens
et les Phéniciens étoient alors des peuples dont la civilisation étoit fort
avancée, et dont les connoissances dans les sciences et dans les arts étoient parvenues
à un très-haut point de perfection, et peut-être même à ce juste degré
nécessaire au bonheur des peuples : mais il n y a qu’une prévention aveugle en
faveur de son siècle, ou une ignorance complète de l’histoire, qui puisse faire
porter un jugement aussi injuste que celui d’Apulée sur les peuples de ces temps
reculés.
Quelqu’un dira peut-être : A quoi bon prendre tant de peine pour une misérable
flûte de fellâh! Nous l’avouerons de bonne foi; nous avons cru que, dans un ouvragé
de la nature de celui-ci, il nous étoit permis de franchir les limites trop resserrées
où se renferment la routine et le mécanisme de Fart musical, et que, lorsque notre
sujet nous en offroit l’occasion, l’on ne trouveroit pas mauvais que nous fissions
quelques réflexions utiles. Mais, nous répliquera-t-on, que nous importe en ce moment
de savoir que les pâtres se sont servis d’un semblable instrument il y a trois mille
ans! quel avantage peut-on retirer de tout cet étalage d’érudition! pourquoi ne pas
se borner tout simplement à nous expliquer en peu de mots la composition et la
construction de l’arghoul, qui ne peut avoir d’autre intérêt pour nous que celui
que nous attachons à la mémorable expédition d’Égypte! A la vérité, il nous eût
été beaucoup plus commode de ne pas nous livrer à ces recherches : mais, comme
nous ne pouvons nous persuader que les faits historiques n’aient pas d’autre utilité
que celle de satisfaire la curiosité, et que nous sommes convaincus, au contraire,
qu’on ne les transmet que comme les conseils et l’expérience que les générations
passées laissent aux générations futures, nous croyons qu’on ne sauroit trop s’attacher
à méditer ces faits, et par conséquent à tâcher d’éclaircir, quand on le peut, ce qui
tient aux usages des anciens, parce que c’est de la connoissance exacte de ces usages
que dépend l’intelligence des auteurs Grecs et Latins, qui sont ceux qui nous ont
transmis le plus de ces faits importans de l’histoire. Par exemple, ce que nous venons
de remarquer sur l’usage que faisoient les anciens de leur flûte double champêtre,
à laquelle ressemble beaucoup Farghoul des Égyptiens modernes, et les rapproche-
mens par lesquels nous sommes parvenus à déterminer l’analogie ou plutôt l’identité
de cette flûte double pastorale des anciens et de Farghoul des fellâh d’Egypte, dont
il est question, éclaircissent un passage du scholiaste de Pmdare, dont les savans
avouent eux-mêmes qu’ils n’ont pu comprendre parfaitement le sens; c’est lorsqu’au
commencement de l’ode que ce poëte a composée en l’honneur du joueur de flûte
Midas, il nous apprend que la languette de la flûte de celui-ci s’étant recourbée dans
l ’instant même ou il se mettait en devoir d ’en jouer, cela ne l ’empêcha pas de continuer.
Or, les savans, n’imaginant pas qu’il pût y avoir un autre instrument que la flûte à
(1) (2) JVondum quidem tam infixa anima I bi<f.
(3) Nec tam multiforatilis tibia, lbid.
sono.Quippe adhuc ars ista repertu nova commodùm
oriebatur.