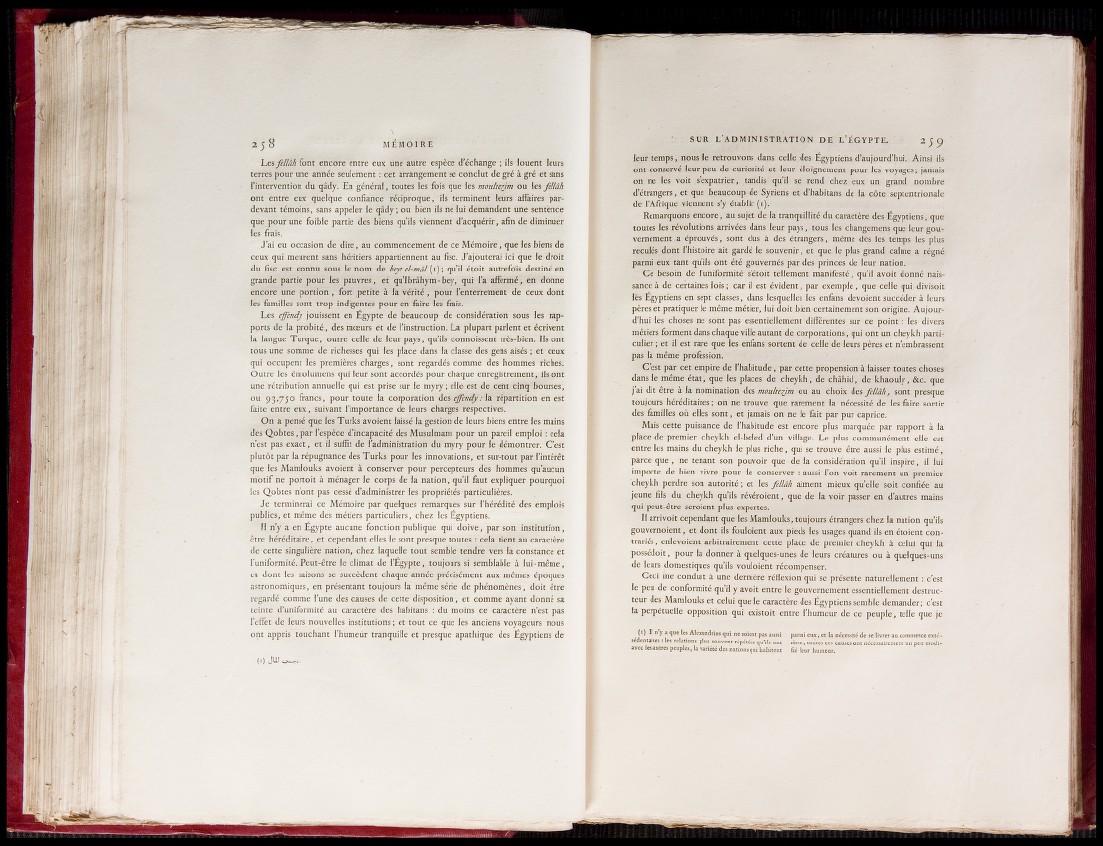
Les fellâh font encore entre eux une autre espèce d’échange ; ils louent leurs
terres pour une année seulement : cet arrangement se conclut de gré à gré et sans
l’intervention du qâdy. En général, toutes les fois que les moultefim ou les fil!Ah
ont entre eux quelque confiance réciproque, ils terminent leurs affaires par-
devant témoins, sans appeler le qâdy; ou bien ils ne lui demandent une sentence
que pour une foible partie des biens qu’ils viennent d’acquérir, afin de diminuer
les frais.
J’ai eu occasion de dire, au commencement de ce Mémoire, que les biens de
ceux qui meurent sans héritiers appartiennent au fisc. J’ajouterai ici que le droit
du fisc est connu sous le nom de beyt el-mâl (i); qu’il étoit autrefois destiné en
grande partie pour les pauvres, et qu’Ibrâhym-bey, qui l’a affermé, en donne
encore une portion , fort petite à la vérité, pour l’enterrement de ceux dont
les familles sont trop indigentes pour en faire les frais.
Les effendy jouissent en Egypte de beaucoup de considération sous les rapports
de la probité, des moeurs et de l’instruction. La plupart parlent et écrivent
la langue Turque, outre celle de leur pays, qu’ils connoissent très-bien. Ils ont
tous une somme de richesses qui les place dans la classe des gens aisés ; et ceux
qui occupent les premières charges, sont regardés comme des hommes riches.
Outre les émolumens qui leur sont accordés pour chaque enregistrement, ils ont
une rétribution annuelle qui est prise sur le myry ; elle est de cent cinq bourses,
ou 93,750 francs, pour toute la corporation des effendy: la répartition en est
faite entre eux, suivant l’importance de leurs charges respectives.
On a pensé que les Turks avoient laissé la gestion de leurs biens entre les mains
des Qobtes, par l’espèce d’incapacité des Musulmans pour un pareil emploi : cela
n’est pas exact, et il suffit de l’administration du myry pour le démontrer. C ’est
plutôt par la répugnance des Turks pour les innovations, et sur-tout par l’intérêt
que les Mamlouks avoient à conserver pour percepteurs des hommes qu’aucun
motif ne portoit à ménager le corps de la nation, qu’il faut expliquer pourquoi
les Qobtes n’ont pas cessé d’administrer les propriétés particulières.
Je terminerai ce Mémoire par quelques remarques sur l’hérédité des emplois
publics, et même des métiers particuliers, chez les Egyptiens.
Il n’y a en Egypte aucune fonction publique qui doive, par son institution,
être héréditaire, et cependant elles le sont presque toutes : cela tient au caractère
de cette singulière nation, chez laquelle tout semble tendre vers la constance et
l’uniformité. Peut-être le climat de l’Egypte, toujours si semblable à lui-même,
et dont les saisons se succèdent chaque année précisément aux mêmes époques
astronomiques, en présentant toujours la même série de phénomènes, doit être
regardé comme l’une des causes de cette disposition, et comme ayant donné sa
teinte d’uniformité au caractère des habitans : du moins ce caractère n’est pas
l’effet de leurs nouvelles institutions ; et tout ce que les anciens voyageurs nous
ont appris touchant l’humeur tranquille et presque apathique des Egyptiens de
leur temps, nous le retrouvons dans celle des Egyptiens d’aujourd’hui. Ainsi ils
ont conservé leur peu de curiosité et leur éloignement pour les voyages; jamais
on ne les voit s’expatrier, tandis qu’il se rend chez eux un grand nombre
d’étrangers, et que beaucoup de Syriens et d’habitans de la côte septentrionale
de l’Afrique viennent s’y établir (1).
Remarquons encore, au sujet de la tranquillité du caractère des Égyptiens, que
toutes les révolutions arrivées dans leur pays, tous les changemens que leur gouvernement
a éprouvés, sont dus à des étrangers, même dès les temps les plus
reculés dont l’histoire ait gardé le souvenir, et que le plus grand calme a régné
parmi eux tant qu’ils ont été gouvernés par des princes de leur nation.
Ce besoin de l’uniformité s’étoit tellement manifesté, qu’il avoit donné naissance
à de certaines lois ; car il est évident, par exemple, que celle qui divisoit
lès Egyptiens en sept classes, dans lesquelles les enfàns devoient succéder à leurs
pères et pratiquer le même métier, lui doit bien certainement son origine. Aujourd’hui
les choses ne sont pas essentiellement différentes sur ce point : les divers
métiers forment dans chaque ville autant de corporations, qui ont un cheykh particulier
; et il est rare que les enfans sortent de celle de leurs pères et n’embrassent
pas la même profession.
C ’est par cet empire de l’habitude, par cette propension à laisser toutes choses
dans le même état, que les places de cheykh, de châhid, de khaouly, &c. que
j’ai dit être à la nomination des moultefnn ou au choix des fellâh, sont presque
toujours héréditaires ; on ne trouve que rarement la nécessité de les faire sortir
des familles où elles sont, et jamais on ne le fait par pur caprice.
Mais cette puissance de l’habitude est encore plus marquée par rapport à la
place de premier cheykh el-beled d’un village. Le plus communément elle est
entre les mains du cheykh le plus riche, qui se trouve être aussi le plus estimé,
parce que , ne tenant son pouvoir que de la considération qu’il inspire, il lui
importe de bien vivre pour le conserver : aussi l’on voit rarement un premier
cheykh perdre son autorité ; et les fellâh aiment mieux qu’elle soit confiée au
jeune fils du cheykh qu’ils révéraient, que de la voir passer en d’autres mains
qui peut-être seraient plus expertes.
Il arrivoit cependant que les Mamlouks, toujours étrangers chez la nation qu’ils
gouvernoient, et dont ils fouloient aux pieds les usages quand ils en étoient contrariés
, enlevoient arbitrairement cette place de premier cheykh à celui qui la
possédoit, pour la donner à quelques-unes de leurs créatures ou à quelques-uns
dé leurs domestiques qu’ils vouloient récompenser.
Ceci me conduit à une dernière réflexion qui se présente naturellement : c’est
le peu de conformité qu il y avoit entre le gouvernement essentiellement destructeur
des Mamlouks et celui que le caractère des Egyptiens semblé demander; c’est
la perpétuelle opposition qui existoit entre l’humeur de ce peuple, telle que je
(0 II n y a que les Alexandrins qui ne soient pas aussi parmi eux, et la nécessité de selivrer au com m erce exté-
sédentaires : les relations plus souvent répétées qu’ils ont rieur, toutes ces causes ont nécessairement avec les autres peuples, la variété des nations qui habitent fié leur hum eur. un peu m odi-