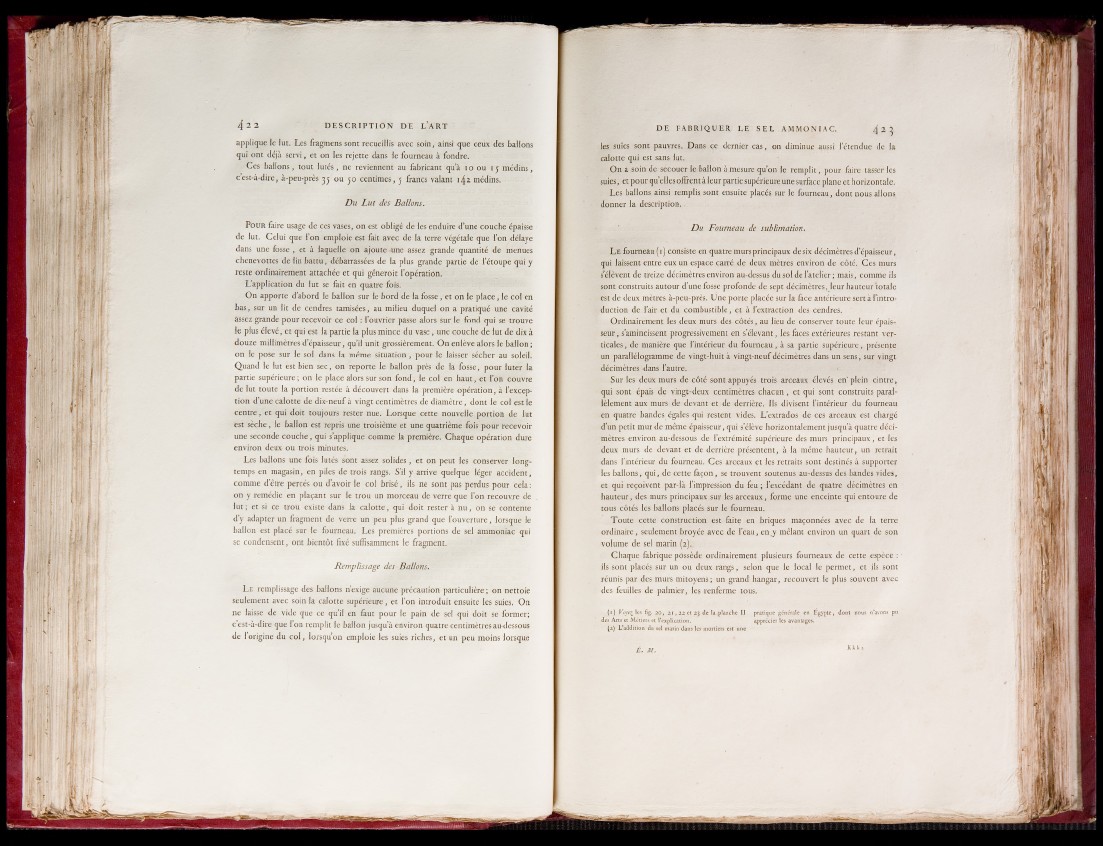
D E S C R I P T I O N D E L ’A R T
applique le lut. Les fragmens sont recueillis avec soin, ainsi que ceux des ballons
qui ont déjà servi, et on les rejette dans le fourneau à fondre.
Ces ballons, tout lutés, ne reviennent au fabricant qu’à 10 ou 15 médins,
c’est-à-dire, à-peu-près 35 ou 50 centimes, y francs valant médins.
Du Lut des Ballons.
P o u r faire usage de ces vases, on est obligé de les enduire d’une couche épaisse
de lut. Celui que l’on emploie est fait avec de la terre végétale que l’on délaye
dans une fosse , et à laquelle on ajoute une assez grande quantité de menues
chenevottes de lin battu, débarrassées de la plus grande partie de i’étoupe qui y
reste ordinairement attachée et qui gêneroit l’opération.
L’application du lut se fait en quatre fois.
On apporte d’abord le ballon sur le bord de la fosse, et on le place, le col en
bas, sur un lit de cendres tamisées, au milieu duquel on a pratiqué une cavité
assez grande pour recevoir ce col : l’ouvrier passe alors sur le fond qui se trouve
le plus élevé, et qui est la partie la plus mince du vase, une couche de lut de dix à
douze millimètres d’épaisseur, qu’il unit grossièrement. On enlève alors le ballon;
on le pose sur le sol dans la même situation , pour le laisser sécher au soleil.
Quand le lut est bien sec, on reporte le ballon près de la fosse, pour luter la
partie supérieure; on le place alors sur son fond, le col en haut, et l’on couvre
de lut toute la portion restée à découvert dans la première opération, à l’exception
d’une calotte de dix-neuf à vingt centimètres de diamètre, dont le col est le
centre, et qui doit toujours rester nue. Lorsque cette nouvelle portion de lut
est sèche, le ballon est repris une troisième et une quatrième fois pour recevoir
une seconde couche, qui s’applique comme la première. Chaque opération dure
environ deux- ou trois minutes.
Les ballons une fois lutés sont assez solides, et on peut les conserver longtemps
en magasin, en piles de trois rangs. S’il y arrive quelque léger accident,
comme d’être percés ou d’avoir le col brisé, ils ne sont pas perdus pour cela :
on y remédie en plaçant sur le trou un morceau de verre que l’on recouvre de
lut; et si ce trou existe dans la calotte, qui doit rester à nu, on se contente
d’y adapter un fragment de verre un peu plus grand que l’ouverture, lorsque le
ballon est placé sur le fourneau. Les premières portions de sel ammoniac qui
se condensent, ont bientôt fixé suffisamment le fragment.
Remplissage des Ballons.
L e remplissage des ballons n’exige aucune précaution particulière ; on nettoie
seulement avec soin la calotte supérieure, et l’on introduit ensuite les suies. On
ne laisse de vide que ce qu’il en faut pour le pain de sel qui doit se former;
c’est-à-dire que l’on remplit le ballon jusqu’à environ quatre centimètres au-dessous
de l’origine du col, lorsqu’on emploie les suies riches, et un peu moins lorsque
D E F A B R I Q U E R L E S E L A M M O N I A C . 4 2 3.
les suies sont pauvres. Dans ce dernier cas, on diminue aussi l’étendue de la
calotte qui est sans lut.
On a soin de secouer le ballon à mesure qu’on le remplit, pour faire tasser les
suies, et pour quelles offrent à leur partie supérieure une surface plane et horizontale.
Les ballons ainsi remplis sont ensuite placés sur le fourneau, dont nous allons
donner la description.
Du Fourneau de sublimation.
L e fourneau ( 1 ) consiste en quatre murs principaux de six décimètres d’épaisseur,
qui laissent entre eux un espace carré de deux mètres environ de côté. Ces murs
s’élèvent de treize décimètres environ au-dessus du sol de l’atelier ; mais, comme ils
sont construits autour d’une fosse profonde de sept décimètres, leur hauteur totale
est de deux mètres à-peu-près. Une porte placée sur la face antérieure sert à l’intro»
duction de l’air et du combustible, et à l’extraction des cendres.
Ordinairement les deux murs des côtés, au lieu de conserver toute leur épaisseur
, s’amincissent progressivement en s’élevant, les faces extérieures restant verticales,
de manière que l’intérieur du fourneau, à sa partie supérieure, présente
un parallélogramme de vingt-huit à vingt-neuf décimètres dans un sens, sur vingt
décimètres dans l’autre.
Sur les deux murs de côté sont appuyés trois arceaux élevés en'plein cintre,
qui sont épais de vingt-deux centimètres chacun, et qui sont construits parallèlement
aux murs de devant et de derrière. Ils divisent l’intérieur du fourneau
en quatre bandes égales qui restent vides. L’extrados de ces arceaux est chargé
d’un petit mur de même épaisseur, qui s’élève horizontalement jusqu’à quatre décimètres
environ au-dessous de l’extrémité supérieure des murs principaux, et les
deux murs de devant et de derrière présentent, à la même hauteur, un retrait
dans l’intérieur du fourneau. Ces arceaux et les retraits sont destinés à supporter
les ballons, qui, de cette façon, se trouvent soutenus au-dessus des bandes vides,
et qui reçoivent par-là l’impression du feu ; l’excédant de quatre décimètres en
hauteur, des murs principaux sur les arceaux, forme une enceinte qui entoure de
tous côtés les ballons placés sur le fourneau.
Toute cette construction est faite en briques maçonnées avec de la terre
ordinaire, seulement broyée avec de l’eau, en .y mêlant environ un quart de son
volume de sel marin (2).
Chaque fabrique possède ordinairement plusieurs fourneaux de cette espèce :
ils sont placés sur un ou deux rangs, selon que le local le permet, et ils sont
réunis par des murs mitoyens; un grand hangar, recouvert le plus souvent avec
des feuilles de palmier, les renferme tous.
(1) Voyeç les fig. 20, 21, 22 et 23 de la .plan che II pratique générale en Egypte, dont nous n’avons pu
des Arts et Métiers et l’explication. apprécier les avantages.
(2) L’addition du sel marin dans les- mortiers est une
É. M. Kkk‘