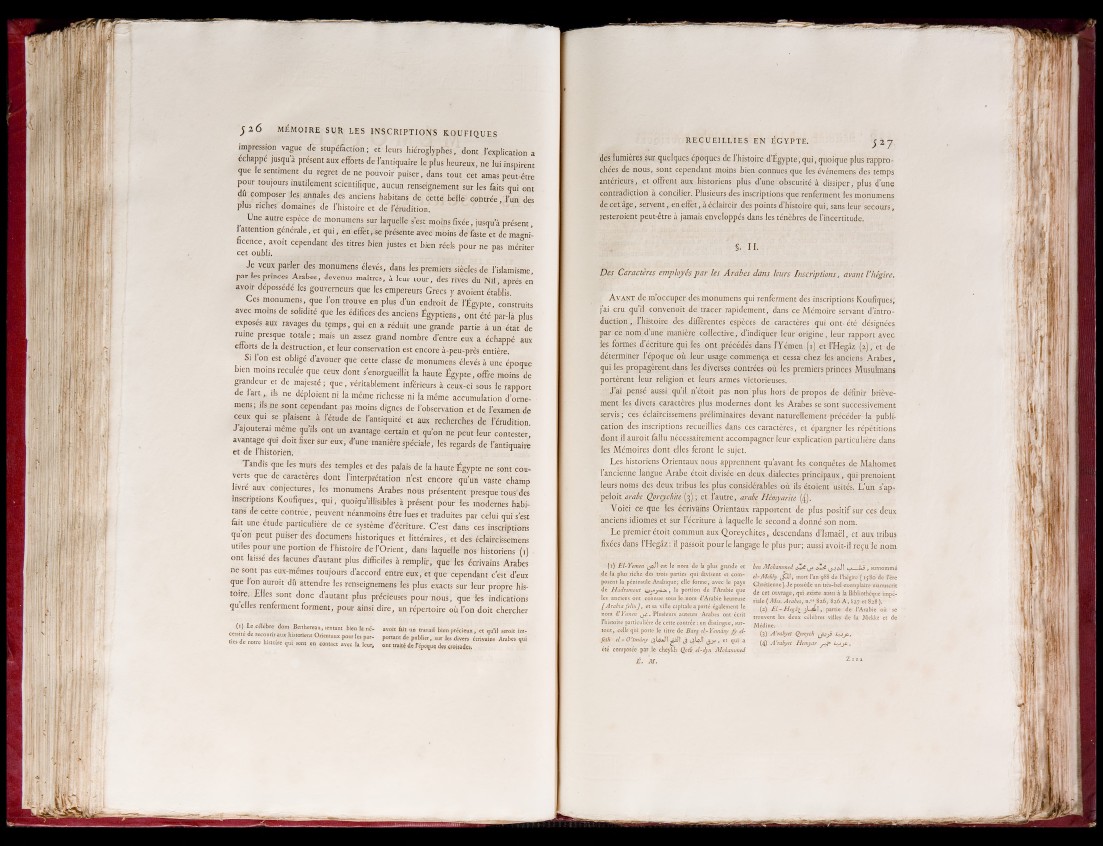
impression vague de stupéfaction; et leurs hiéroglyphes, dont l’explication a
échappé jusqu’à présent aux efforts de l’antiquaire le plus heureux, ne lui inspirent
que le sentiment du regret de ne pouvoir puiser, dans tout cet amas peut-être
pour toujours inutilement scientifique, aucun renseignement sur les faits qui ont
du composer les annales des anciens habitans de cette belle contrée, l’un des
plus riches domaines de l’histoire et de l’érudition.
Une autre espèce de monumens sur laquelle s’est moins fixée, jusqu’à présent,
1 attention générale, et qui, en effet, se présente avec moins de faste et de magnificence,
avoit cependant des titres bien justes et bien réels pour ne pas mériter
cet oubli. ___.
Je veux parler des monumens élevés, dans les premiers siècles de l’islamisme,
par les princes Arabes, devenus maîtres, à leur tour, des rives du Nil, après en
avoir dépossédé les gouverneurs que les empereurs Grecs y avoient établis.
Ces monumens, que l’on trouve en plus d’un endroit de l’Égypte, construits
avec moins de solidité que les édifices des anciens Égyptiens, ont été par-là plus
exposés aux ravages du temps, qui en a réduit une grande partie à un état de
ruine presque totale ; mais un assez grand nombre d’entre eux a échappé aux
efforts de la destruction, et leur conservation est encore à-peu-près entière.
Si l’on est obligé d’avùuer que cette classe de monumens élevés à une époque
bien moins reculée que ceux dont s’enorgueillit la haute Égypte, offre moins de
grandeur et de majesté ; que, véritablement inférieurs à ceux-ci sous le rapport
de 1 art,. ils ne déploient ni la même richesse ni la même accumulation d'ome-
mens; ils ne sont cependant pas moins dignes de l’observation et de l’examen de
ceux qui se plaisent à l’étude de l’antiquité et aux recherches de l’érudition.
J ajouterai même qu’ils ont un avantage certain et qu’on ne peut leur contester
avantage qui doit fixer sur eux, d’une manière spéciale, les regards de l’antiquaire
et de l’historien.
Tandis que les murs des temples et des palais de la haute Égypte ne sont couverts
que de caractères dont l’interprétation n’est encore qu’un vaste champ
livré aux conjectures, les monumens Arabes nous présentent presque tous’des
inscriptions Koufiques, qui, quoiqu’illisibles à présent pour les modernes habitans
de cette contrée, peuvent néanmoins être lues et traduites par celui qui s’est
fait une étude particulière de ce système d’écriture. C’est dans ces inscriptions
qu’on peut puiser des documens historiques et littéraires, et des éclaircissemens
utiles pour une portion de l’histoire de l’Orient, dans laquelle nos historiens (1)
ont laissé des lacunes d’autant plus difficiles à remplir, que les écrivains Arabes
ne sont pas eux-mêmes toujours d’accord entre eux, et que cependant c’est d’eux
que 1 on aurait dû attendre les renseignemens les plus exacts sur leur propre histoire.
Elles sont donc d’autant plus précieuses pour nous, que les indications
quelles renferment forment, pour ainsi dire, un répertoire où l’on doit chercher
(i)_Le.céIèbre dom BertherM „, sentant bien la né- avoit fait un travail bien précieux, et qu’il serait im-
cesstte de reconnu au* Instar,eus Orientaux pour les par- portant de publier, sur les divers écrivains de notre histoire qui sont en contact avec la leur, ont traité de fépoque des croisades. Arabes qui
des lumières sur quelques époques de 1 histoire d’Égypte, qui, quoique plus rapprochées
de nous, sont cependant moins bien connues que les événemens des temps
antérieurs, et offrent aux historiens plus d’une obscurité à dissiper, plus d’une
contradiction a concilier. Plusieurs des inscriptions que renferment les monumens
de cet âge, servent, en effet, à éclaircir des points d’histoire qui, sans leur secours,
resteroient peut-être à jamais enveloppés dans les ténèbres de l’incertitude.
§. II.
Des Caractères employés par les Arabes dans leurs Inscriptions, avant l’hégire.
A v a n t de m’occuper des monumens qui renferment des inscriptions Koufiques;'
j’ai cru qu’il çonvenoit de tracer rapidement, dans ce Mémoire servant d’introduction,
l’histoire des différentes espèces de caractères qui ont. été désignées
par ce nom d’une manière collective, d’indiquer leur origine, leur rapport avec
les formes d’écriture qui les ont précédés dans l’Yémen (1) et l’Hegâz (2), et de
déterminer l’époque où leur usage commença et cessa chez les anciens Arabes,
qui les propagèrent dans les diverses contrées où les premiers princes Musulmans
portèrent leur religion et leurs armes victorieuses.
J ai pense aussi' qu il n etoit pas non plus hors de propos de définir brièvement
les divers caractères plus modernes dont les Arabes se sont successivement
servis ; ces éclaircissemens préliminaires devant naturellement précéder la publication
des inscriptions recueillies dans ces caractères, et épargner les répétitions
dont il auroit fallu nécessairement accompagner leur explication particulière dans
les Mémoires dont elles feront le sujet.
Les historiens Orientaux nous apprennent qu’avant les conquêtes de Mahomet 1 ancienne langue Arabe etoit divisée en deux dialectes principaux, qui prenoient
leurs noms des deux tribus les plus considérables où ils étoient usités. L’un s’ap-
peloit arabe Qoreychite (3) ; et l’autre, arabe Hémyarite (4).
Voici ce que les écrivains Orientaux rapportent de plus positif sur ces deux
anciens idiomes et sur l’écriture à laquelle le second a donné son nom.
Le premier etoit commun aux Qoreychites, descendans d’Ismaël, et aux tribus
fixées dans l’Hegâz: il passoit pour le langage le plus pur; aussi avoit-il reçu le nom
• (1) El-Yemen est le nom de la plus grande et
de la plus riche des trois parties qui divisent et composent
la péninsule Arabique; elle forme, avec le pays
de Hadramout , la portion de l’Arabie que
les anciens ont connue sous le* nom d’Arabie heureuse
n[oAmra bdia felix] , et sa ville capitale a porté également le ’Yemen qA . Plusieurs auteurs Arabes ont écrit
l’histoire particulière de cette contrée : on distingue, surtout,
celle qui porte le titre de Barq el-Yemâny fy el-
feth cl - O’tmâny Jpül j ^LçJI , et qui a
été composée par le cheykh Qotb el-dyn Mohammed
É. M.
ben Mohammed ^ <_>__Là , surnommé
el-Meldy J U l, mort l’an 988 de l’hégire [1580 de l’ère
Chrétienne]. Je possède un très-bel exemplaire manuscrit
de cet ouvrage, qui existe aussi à la Bibliothèque impériale
( Mss. Arabes, n.°‘ 826, 826 A , 827 et 828 ). ‘
tro(u-v) enEt l-leHs edgeâuxi jcLélè^bIre,s pvairltliees ddee la1- AMraebkiek e oeùt ■ dsee Médine.-
(3) A ’rabyet Qoreych Loje..
(4) A ’ràbyet Hemyar ü jjc .
Z z z a