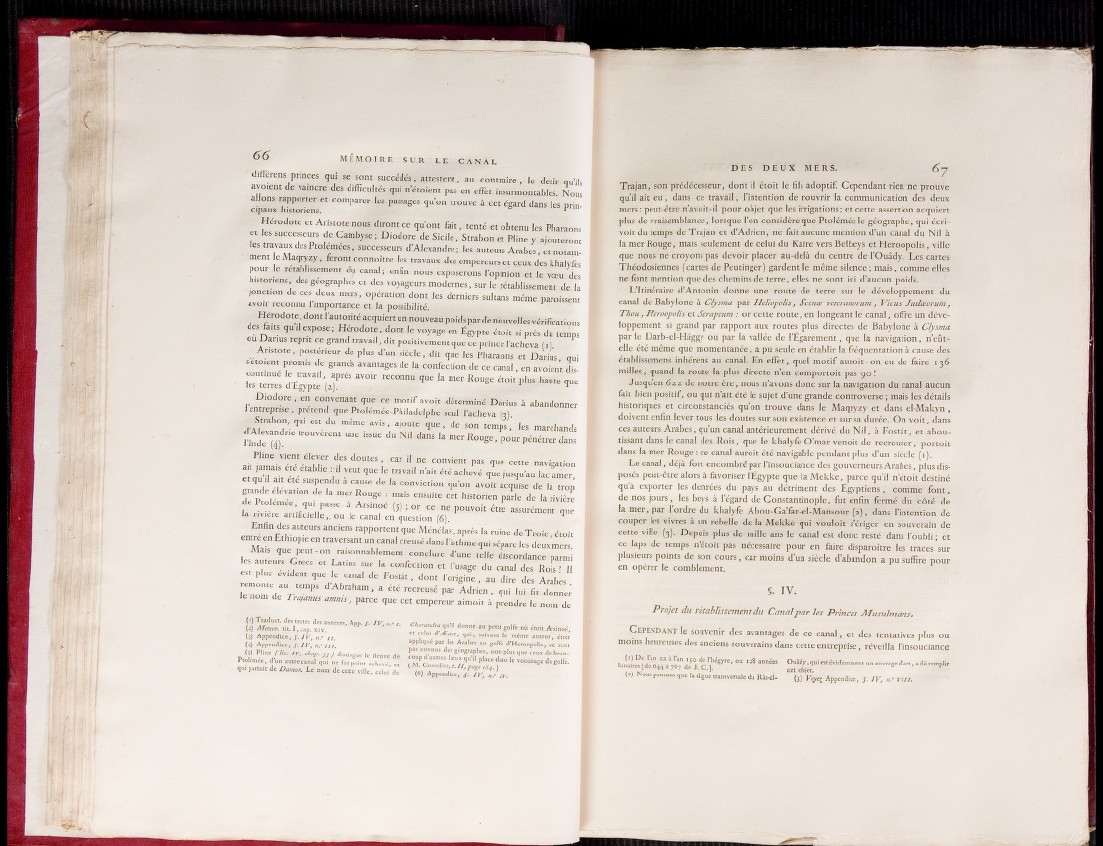
ifferens princes qui se sont succédés, attestent, au contraire, le désir cru’ils
avoient de vaincre des difficultés qui n’étoient pas en effet insurmontables. Nous
allons rapporter et comparer les passages qu’on trouve à cet égard dans les principaux
historiens. r
Hérodote et Aristote nous diront ce qu’ont fait, tenté et obtenu les Pharaons
et les successeurs de Cambyse; Diodore de Sicile, Strabon et Pline y ajouteront
les travaux desPtoiémées, successeurs d’Alexandre; les auteurs Arabes; et notamment
e Maqryzy, feront connoître les travaux des. empereurs et ceux des khalyfes
pour le rétablissement dq canal; enfin nous exposerons l’opinion et le voeu des
historiens des géographes et des voyageurs modernes, sur le rétablissement de la
jonction de ces deux mers, opération dont les derniers sultans même paraissent
avoir reconnu 1 importance et la possibilité.
Herodote dont l’autorité acquiert un nouveau poidspar de nouvelles vérifications
desTa.ts qud expose; Hérodote, dont le voyage en Égypte étoit si près du temps
ou Darius reprit ce grand travail, dit positivement que ce prince l’acheva (il
Aristote, postérieur de plus d’un siècle, dit que les Pharaons et Darius oui
seraient promis de grands avantages de la confection de ce canal, en avoient discontinue
le travail après avoir reconnu que la mer Rouge étoit plus haute que
les terres d Egypte (2). *
Diodore, en convenant que ce motif avoit déterminé Darius à abandonner
1 entreprise, prétend que Ptolémée-Philadelphe seul l’acheva (3)
Suaton. est du même avis, ajoute ,u e . de son temps, les marchands
" ° ‘,r" em “ “ issue Ju Na 1* mer Rouge, pour pénétrer dans
Pline vient élever des doutes, car il ne convient pas que cette navigation
m jamats ete etablte çd veut que le travail n’ai, été achevé que jus,«’au lae ame,
et qu 1 ait ete suspendu a cause de la conviction qu’on avoit acquise de la trop
grande élévation de la mçr Rouge : mais ensuite cet historien parie de la r ivS e
à, Arsinoé (5) ; or ce ne pouvoit être assurément que
la riviere artificielle,, ou le canal en question (6).
Enfin des auteurs anciens rapportent que Ménélas, après la ruine de Troie étoit
entre en Ethiopie en traversant un canal creusé dans l’isthme qui sépare les deux mers
_ Mais que peut-on raisonnablement conclure d’une telle discordance parmi
le auteurs Grecs et Latins sur la confection et l’usage du canal des Rois I II
plus évident que le canal de Fostàt, dont l’origine, au dire des Arabes
S S B H I Abrahamj a i reCreUSé Ü P » 3 ÉÉ « B t nom de Trajanus amms, parce que cet empereur aimoit à prendre le nom de
8 5 * A p p - 1 M - - m „ g g „ , f e o ù , - t o i , 1 1 1
(3) Appendice, } . I V , n . " “j , Æ a n t> î “ '» suivant le même auteur,' étoit
(4) Appendice, J . I V , n.° ///. aPP ique par les Arabes au golfe d’Heroopolis, ne sont
(5) Pline ( liv. i v , chap. j j ) distingue le fle»™» A* ^ C° ? nUS “ geo6raphes, non plus que ceux de beau-
Ptolémée, d’un autre canal qui ne fut point achevé, et [ a l GosTelIin '7 u ^ J c T l “ ’ ^
qui partoit de Danton. L e nom de cette v ille , celui de (6) Appendice, ’s J V n J , v .
Trajan, son prédécesseur, dont il étoit le fils adoptif. Cependant rien ne prouve
qu’il ait eu, dans ce travail, l’intention de rouvrir la communication des deux
mers: peut-être n’avoit-il pour objet que les irrigations; et cette assertion acquiert
plus de vraisemblance, lorsque l’on considère que Ptolémée le géographe, qui écri-
voit du temps de Trajan et d’Adrien, ne fait aucune mention d’un canal du Nil à
la mer Rouge, mais seulement de celui du Kaire vers Belbeys et Heroopolis, ville
que nous ne croyons pas devoir placer au-delà du centre de l’Ouâdy. Les cartes
Théodosiennes (cartes de Peutinger) gardent le même silence ; mais, comme elles
ne font mention que des chemins de terre, elles ne sont ici d’aucun poids.
L’Itinéraire d’Antonin donne une route de terre sur le développement du
canal de Babylone à Clysma par Heliopolis, Scenæ veteranorum , Viens Judoeorum,
Thon, Heroopolis etSerapeum : or cette route, en longeant le canal, offre un développement
si grand par rapport aux routes plus directes de Babylone à Clysma
par le Darb-el-Haggy ou par la vallée de l’Égarement, que la navigation, n’eût-
elle été même que momentanée, a pu seule en établir la fréquentation à cause des
établissemens inhérens au canal. En effet, quel motif auroit-on eu de Étire 136
milles, quand la route la plus directe n’en comportoit pas 90!
Jusquen 622 de notre ere, nous n’avons donc sur la navigation du canal aucun
fait bien positif, ou qui n ait été le sujet d’une grande controverse ; mais les détails
historiques et circonstanciés qu’on trouve dans le Maqryzy et dans el-Makyn,
doivent enfin lever tous les doutes sur son existence et s u r sa durée. On voit, dans
ces auteurs Arabes, qu’un canal antérieurement dérivé du Nil, à Fostàt, et aboutissant
dans le canal des Rois, que le khalyfe O ’mar venoit de recreuser, portoit
dans la mer Rouge : ce canal auroit été navigable pendant plus d’un siècle (1).
Le canal, déjà fort encombré par l’insouciance des gouverneurs Arabes, plus disposés
peut-être alors à favoriser l’Égypte que la Mekke, parce qu’il n’étoit destiné
quà exporter les denrées du pays au détriment des Égyptiens, comme font,
de nos jours, les beys à l’égard de Constantinople, frit enfin fermé du côté de
la mer, par 1 ordre du khalyfe Abou-Ga’fàr-el-Mansour (2), dans l’intention de
couper les vivres à un rebelle de la Mekke qui vouloit s’ériger en souverain de
cette ville (3). Depuis plus de mille ans le canal est donc resté dans l’oubli ; et
ce laps de temps n’étoit pas nécessaire pour en faire disparoître les traces sur
plusieurs points de son cours, car moins d’un siècle d’abandon a pu suffire pour
en opérer le comblement.
§. IV .
Projet du rétablissement du Canal par les Princes Musulmans.
C e p e n d a n t le souvenir des avantages de ce canal, et des tentatives plus ou
moins heureuses des anciens souverains dans cette entreprise, réveilla l’insouciance
lunaires f d e ^ T " ^7 67" de J 1 he£yre3 ou 128 années O u ld y , qui est évidemment un ouvrage d’art, ad û remplir
. .. ^ / / uc j . j. cet objet.
(2) ous pensons que la digue transversale du Râs-el- (3) Voyez Appendice, j\ I V , n ° v i i i .