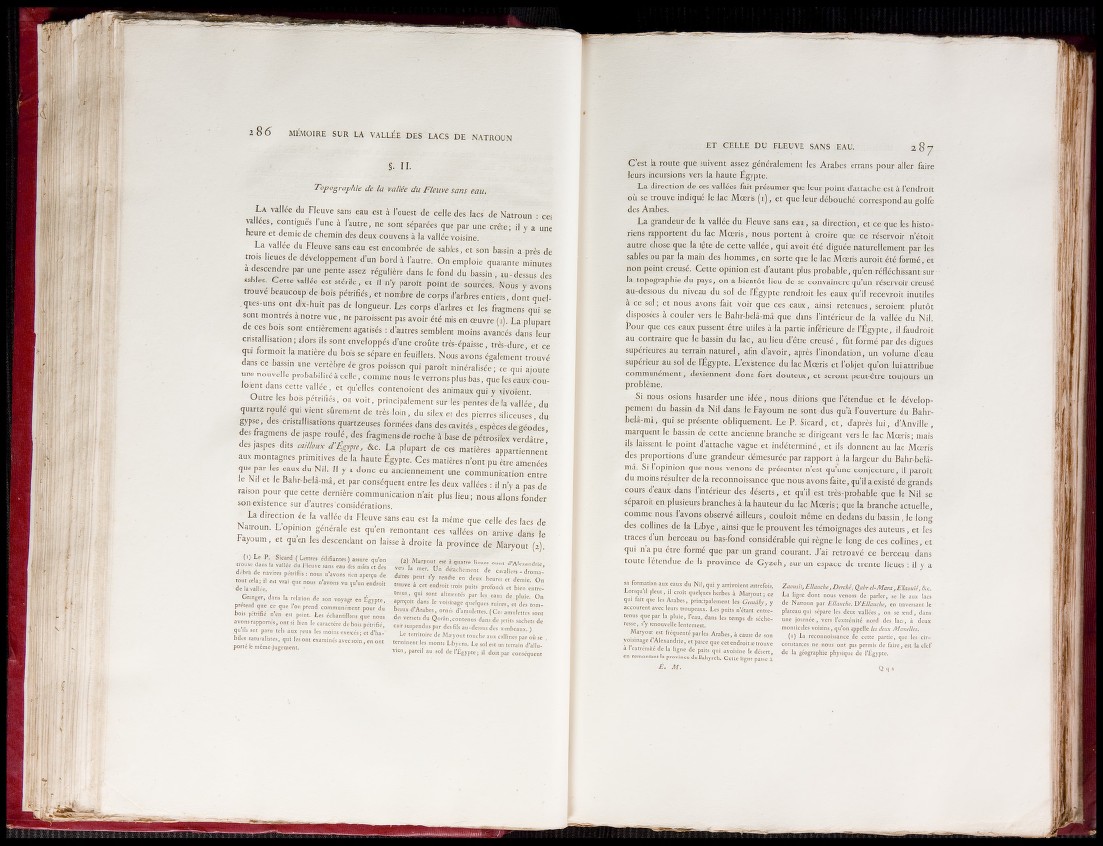
§. II.
Topographie de la vallée du Fleuve sans eau.
L a vallée du Fleuve sans eau est à l’ouest de celle des lacs de Natroun : ces
vallees, contiguës l’une à l’autre, ne sont séparées que par une crête; il y a une
heure et demie de chemin des deux couvens à la vallée voisine.
La vallée du Fleuve sans eau est encombrée de sables, et son bassin a près de
trois 1,eues de développement d’un bord à l’autre. On emploie quarante minutes
a descendre par une pente assez régulière dans le fond du bassin, au-dessus des
sables. Cette vallée est stérile, et il n’y paroît point de sources. Nous y avons
trouve beaucoup de bois pétrifiés, et nombre de corps d’arbres entiers, dont qucl-
.ques-uns ont dix-huit pas de longueur. Les corps d’arbres et les fragmens qui se
sont montrés à notre vue, ne paroissent pas avoir été mis en oeuvre (i). La plupart
de ces bois sont entièrement agatisés : d’autres semblent moins avancés dans leur
cristallisation ; alors ils sont enveloppés d’une croûte très-épaisse, très-dure, et ce
qui formoit la matière du bois se sépare en feuillets. Nous avons également trouvé
dans ce bassin une vertèbre de gros poisson qui paroît minéralisée; ce qui ajoute
une nouvelle probabilité à celle, comme nous le verrons plus bas, que les eaux cou-
loient dans cette vallée, et qu’elles contenoient des animaux qui y vivoient.
Outre les bois pétrifiés, on voit, principalement sur les pentes de la vallée du
quartz rqulé qui vient sûrement de très loin, du silex et des pierres siliceuses’ du
gypse, des cristallisations quartzeuses formées dans des cavités, espèces de géodes
des fragmens de jaspe roulé, des fragmens de roche à base de pétrosilex verdâtre’
des jaspes dits cailloux d’Egypte, &c. La plupart de ces matières appartiennent
aux montagnes primitives de la haute Égypte. Ces matières n’ont pu être amenées
que par les eaux du Nil. II y a donc eu anciennement une communication entre
te Nil et le Bahr-belâ-mâ, et par conséquent entre les deux vallées : il n’y a pas de
raison pour que cette dernière communication n’ait plus lieu; nous allons fonder
son existence sur d’autres considérations.
La direction de la vallée du Fleuve sans eau est la même que celle des lacs de
Natroun. L opinion générale est qu’en remontant ces vallées on arrive dans le
rayoum, et qu’en les descendant on laisse à droite la province de Maiyout (z)
(r) Le P. Sicard ( Lettres édifiantes) assure qu’on
trouve dans la vallée du Fleuve sans eau des mâts et des
débris de navires pétrifiés : nous n’avons rien aperçu de
tout cela; il est vrai que nous n’avons vu qu’un endroit
de la vallée. '
Granger, dans la relation de son voyage en Egypte,
prétend que ce que l’on prend communément pour du
bois pétrifié n’en est point. Les échantillons que nous
avons rapportés, ont si bien le caractère de bois pétrifié,
qu’ils ont paru tels aux yeux les moins exercés; et d’habiles
naturalistes, qui les ont examinés avec soin, en ont
porté le même jugement.
(2) Maryout est à quatre lieues ouest d’Alexandrie
ver* la mer. Un détachement de cavaliers - dromadaires
peut s’y rendre en deux heures et demie. On
trouve à cet endroit trois puits profonds et bien entretenus
, qui sont alimentés par les eaux de pluie. On
aperçoit dans le voisinage quelques ruines, et des tombeaux
d’Arabes, ornés d’amulettes. ( Ces amulettes sont
des versets du Qorân, contenus dans de petits sachets de
cuir suspendus par des «s au-dessus des tombeaux. )
Le territoire de Maryout touche aux collines par où se
terminent les monts Libyens. Le sol est un terrain d’allu- '
vton, pareil au sol de l’Égypte; il doit par conséquent
C est la route que suivent assez généralement les Arabes errans pour aller faire
leurs incursions vers la haute Égypte.
La direction de ces vallees fait présumer que leur point d’attache est à l’endroit
ou se trouve indique le lac Moeris ( 1J, et que leur débouché correspond au golfe
des Arabes.
La grandeur de la vallée du Fleuve sans eau, sa direction, et ce que les historiens
rapportent du lac Moeris, nous portent a croire que ce réservoir n’étoit
autre chose que la tçte de cette vallee, qui avoit été diguée naturellement par les
sables ou par la main des hommes, en sorte que le lac Moeris auroit été formé, et
non point creuse. Cette opinion est dautant plus probable, qu’en réfléchissant sur
la topographie du pays, on a bientôt lieu de se convaincre qu’un réservoir creusé
au-dessous du niveau du sol de I Égypte rendroit les eaux qu’il recevroit inutiles
a ce sol, et nous avons fait voir que ces eaux, ainsi retenues, seroient plutôt
disposées a couler vers le Bahr-bela-ma que dans l’intérieur de la vallée du Nil.
Pour que ces eaux pussent être utiles à la partie inférieure de l’Égypte, il faudroit
au contraire que le bassin du lac, au lieu d’être creusé, fût formé par des digues
supérieures au terrain naturel, afin d avoir, après l’inondation, un volume d’eau
supérieur au sol de 1 Égypte. L existence du lac Moeris et l’objet qu’on lui attribue
communément, deviennent donc fort douteux, et seront peut-être toujours un
problème.
Si nous osions hasarder une idée, nous dirions que l’étendue et le développement
du bassin du Nil dans le Fayoum ne sont dus qu’à l’ouverture du Bahr-
belâ-mâ, qui se présente obliquement. Le P. Sicard, et, d’après lui, d’Anville ,
marquent le bassin de cette ancienne branche se dirigeant vers le lac Moeris; mais
ils laissent le point d’attache vague et indéterminé, et ils donnent au lac Moeris
des proportions d’une grandeur démesurée par rapport à la largeur du Bahr-belâ-
mâ. Si 1 opinion que nous venons de présenter n’est qu’une conjecture, il paroît
du moins résulter de la reconnoissance que nous avons faite, qu’il a existé de grands
cours deaux dans 1 intérieur des déserts, et qu’il est très-probable que le Nil se
separoit en plusieurs branches a la hauteur du lac Moeris; que la branche actuelle,
comme nous lavons observé ailleurs, couloit même en dedans du bassin, le long
des collines de la Libye, ainsi que le prouvent les témoignages des auteurs, et les
traces d un berceau ou bas-fond considérable qui règne le long de ces collines, et
qui n’a pu être formé que par un grand courant. J’ai retrouvé ce berceau dans
toute I étendue de la province de Gyzeh, sur un espace de trente lieues : il y a
sa formation aux eaux du N il, qui y arrivoient autrefois. Zaoush, Ellauche,Dmhé, Qabr d-Mara,EUacuiê,&c
Lorsqud pleut, .1 croît quelques herbes à Maryout; ce La ligne dont nous venons de parler, se lie aux lacs
qu. fait que les Arabes, principalement les. Gtouâby, y de Natroun par Ellauche. VEllauche, en traversant le
accourent avec leurs troupeaux. Les puits n’étant entre- plateau qui sépare les deux vallées , on se rend, dans
s que par a p me, eau, dans les temps de séché- une journée, vers l’extrémité nord des lacs, à deux
resse, s y renouvelle n/s „ c . lente, ment m_o nt.i•c ulie s voisins, qu »on appelle les deux Mamelles.
I M B U freî ueme par Ies Arabes’ à — reconnoissance de cette partie, que les cir-
. a?e . , ,ex]an,,ne ’ et parcc î “ e cet endroit se trouve constances ne nous ont pas permis de faire est la clef
a extremtte de la ligne de puits qui avoisine le désert, de la géographie physique de l’Égypte.
en remontant la province de Bahyreh. Cette ligne passe à H
É . M . Q , ,