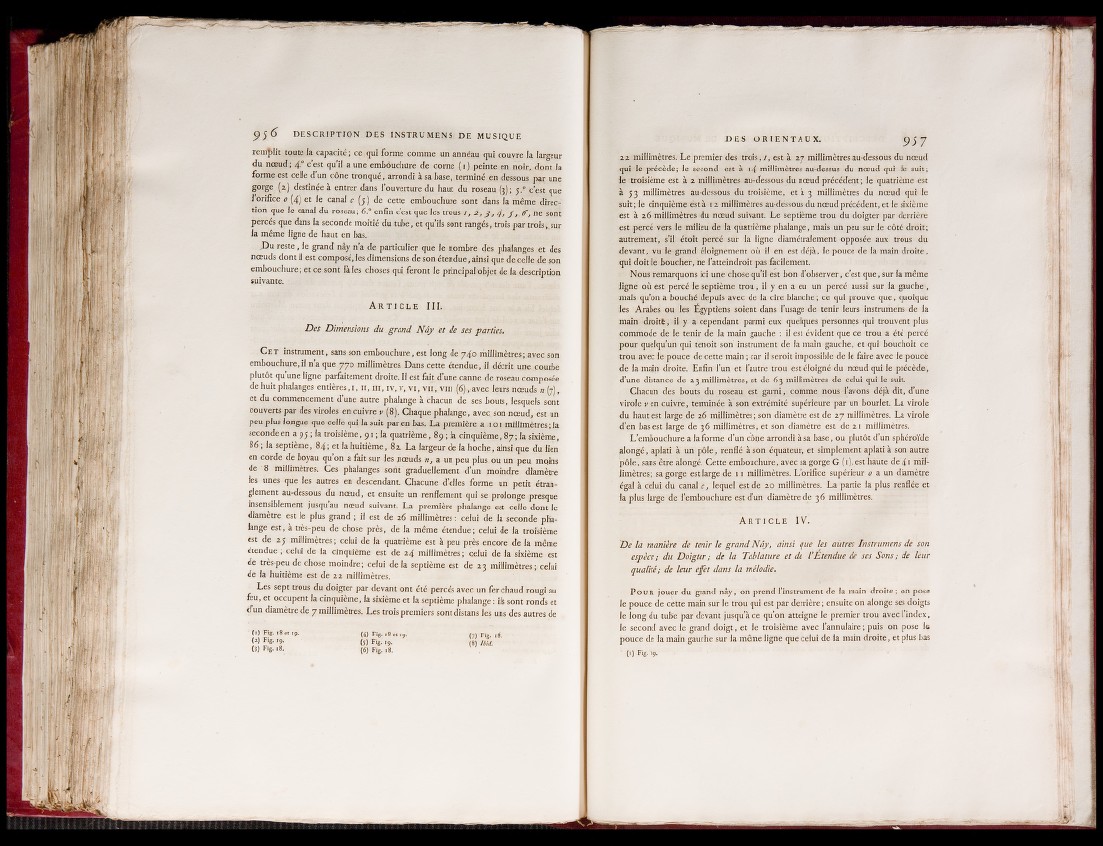
remplit toute la capacité ; ce qui Forme comme un annéau qui couvre la largeur
du noeud ; 4 ° c’est qu’il a une embouchure de corne ( i ) peinte en noir, dont la
forme est celle d un cône tronqué, arrondi à sa base, terminé en dessous par une
gorge (2) desfinçe a entrer dans l’ouverture du haut du roseau (3); y.° c’est que
1 orifice 0 (4) et le canal c (y ) de cette embouchure sont dans la même direction
que le canal du roseau; 6 ° enfin c’est que les trous 1 , 2 , y , 4 , y , C , ne sont
percés que dans la seconde moitié du tube, et qu’ils sont rangés, trois par trois, sur
la même ligne de haut en bas.
Du reste , le grand nay n a de particulier que le nombre des phalanges et des
noeuds dont il est composé, les dimensions de son étendue, ainsi que de celle de son
embouchure ; et ce sont là (es choses qui feront le principal objet de la description
suivante.
A r t i c l e I I I .
D es Dimensions du grand Nây et de ses parties.
C e t instrument, sans son embouchure, est long de 740 millimètres; avec son
embouchure, il n'a que 770 millimètres. Dans cette étendue, il décrit une courbe
plutôt qu’une ligne parfaitement droite. Il est fait d’une canne de roseau composée
de huit phalanges entières, 1, n, m , iv, v, v i , v u , vm (6); avec leurs noeuds n (7),
et du commencement d’une autre phalange à chacun de ses bouts, lesquels sont
Couverts par des viroles en cuivre t> (8). Chaque phalange, avec son noeud, est un
peu plus longue que celle qui la suit par en bas. La première a 1 o 1 millimètres ; la
seconde en a 95 ; la troisième, 91 ; la quatrième, 89 ; la cinquième, 87; la sixième,
86 ; la septième, 84; et la huitième, 82. La largeur de la hoche, ainsi que du lien
en corde de boyau qu on a fart sur les noeuds n , a un peu plus ou un peu mciins
de 8 millimétrés. Ces phalanges sont graduellement d’un moindre diamètre
les unes que les autres en descendant. Chacune d’elles forme un petit étranglement
au-dessous du noeud, et ensuite un renflement qui se prolonge presque
insensiblement jusquau noeud suivant. La première phalange est celle dont le
diametre est le plus grand ; il est de 26 millimètres : celui de la seconde phalange
est, a tres-peu de chose près, de la même étendue; celui de la troisième
est de 2y millimètres; celui de la quatrième est à peu près encore de la même
étendue ; celui de la cinquième est de 24 millimètres ; celui de la sixième est
de très-peu de chose moindre; celui de la septième est de 23 millimètres; celui
de la huitième est de 22 millimètres.
Les sept trous du doigter par devant ont été percés avec un fer chaud rougi au
feu, et occupent la cinquième, la sixième et la septième phalange : ils sont ronds et
d un diametre de 7 millimètres. Les trois premiers sont distans les uns des autres de
(1) Fig. 18 et 19.
(2) Fig. 19.
(3) Fig. 18.
(4) Fig. 18 et 19.
((65)) FFiigg. .1198-.
(7) F'g- 1
(8) Ibid.
22 millimètres. Le premier des trois, /, est à 27 millimètres au-dessous du noeud
qui le précède; le second est à i4 millimètres au-dessus du noeud qui le suit;
le troisième est à 2 millimètres au-dessous du noeud précédent ; le quatrième est
à 33 millimètres au-dessous du troisième, et à 3 millimètres du noeud qui le
suit ; le cinquième est à 12 millimètres au-dessous du noeud précédent, et le sixième
est à 26 millimètres du noeud suivant. L e septième trou du doigter par derrière
est percé vers le milieu de la quatrième phalange, mais un peu sur le côté droit;
autrement, s’il étoit percé sur la ligne diamétralement opposée aux trous du
devant, vu le grand éloignement où il en est déjà, le pouce de la main droite,
qui doit le boucher, ne l’atteindroit pas facilement.
Nous remarquons ici une chose qu’il est bon d’observer, c’est que, sur la même
ligne où est percé le septième tro u , il y en a eu un percé aussi sur la gauche,
mais qu’on a bouché depuis avec de la cire blanche ; ce qui prouve que, quoique
les Arabes ou les Égyptiens soient dans l’usage de tenir leurs instrumens de la
main droitê, il y a cependant parmi eux quelques personnes qui trouvent plus
commode de le tenir de la main gauche : il est évident que ce trou a été percé
pour quelqu’un qui tenoit son instrument de la main gauche, et qui bouchoit ce
trou avec le pouce de cette main ; car il seroit impossible de le faire avec le pouce
de la main droite. Enfin l’un et l’autre trou est éloigné du noeud qui le précède,
d’une distance de 23 millimètres, et de 63 millimètres de celui qui le suit.
Chacun des bouts du roseau est garni, comme nous l’avons déjà dit, d’une
virole v en cuivre, terminée à son extrémité supérieure par un bourlet. La virole
du haut est large de 26 millimètres; son diamètre est de 27 millimètres. La virole
d’en bas est large de 36 millimètres, et son diamètre est de 21 millimètres.
L ’embouchure a la forme d’un côije arrondi à sa base, ou plutôt d’un sphéroïde
alongé, aplati à un pôle, renflé à son équateur, et simplement aplati à son autre
pôle, sans être alongé. Cette embouchure, avec sa gorge G ( 1 ), est haute de 4 * millimètres
; sa gorge est large de 11 millimètres. L ’orifice supérieur 0 a un diamètre
égal à celui du canal c , lequel est de 20 millimètres. La partie la plus renflée et
la plus large de l’embouchure est d’un diamètre de 36 millimètres.
A r t i c l e IV .
D e la manière de tenir le grand N ây, ainsi que les autres Instrumens de son
espèce; du Doigter ; de la Tablature et de l ’Etendue de ses Sons; de leur
qualité ; de leur effet dans la mélodie.
P o u r jouer du grand nây, on prend l’instrument de la main droite ; on pose
le pouce de cette main sur le trou qui est par derrière ; ensuite on alonge ses doigts
le long du tube par devant jusqu’à ce qu’on atteigne le premier trou avec l’index,
le second avec le grand doigt, et le troisième avec l’annulaire ; puis on pose le
pouce de la main gauche sur la même ligne que celui de la main droite, et plus bas
' (') Fig- ¡9.