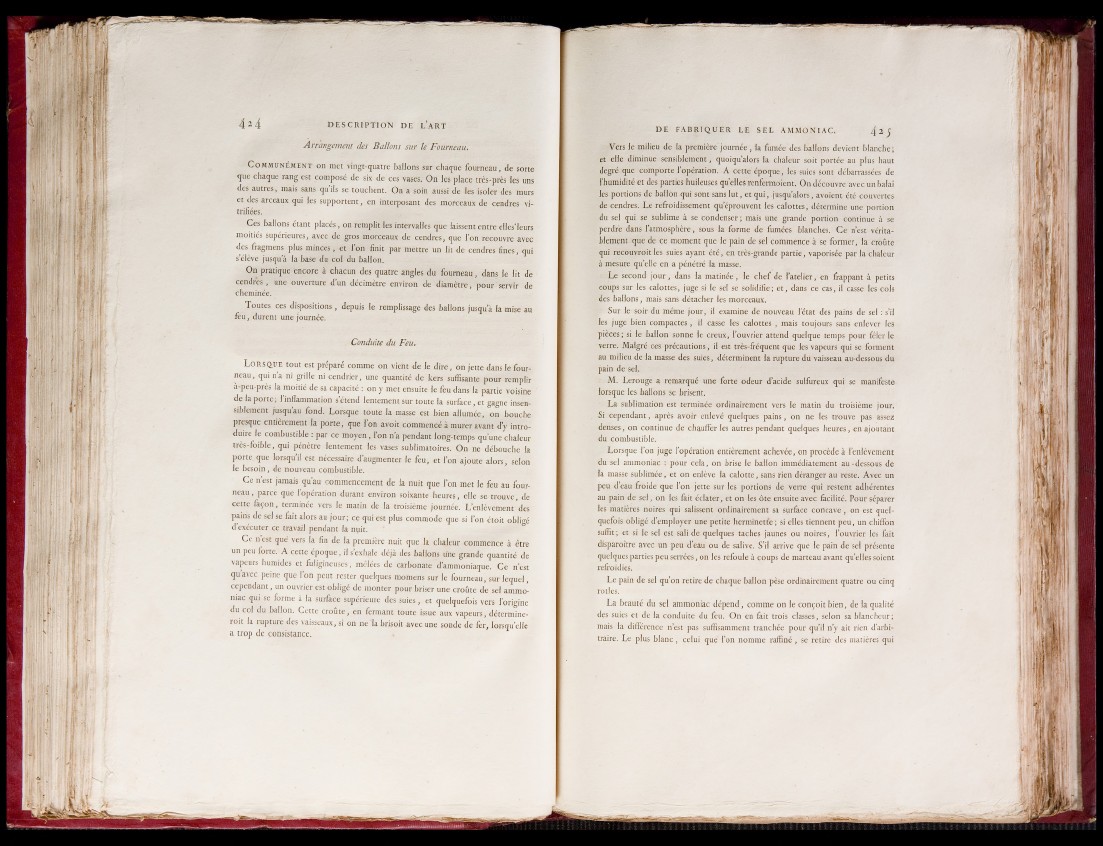
Arrangement des Ballons sur le Fourneau.
C ommunément on met vingt-quatre ballons sur chaque fourneau, de sorte
que chaque rang est composé de six de ces vases. On les place très-près les uns
des autres, mais sans qu ils se touchent. On a soin aussi de les isoler des murs
et des arceaux qui les supportent, en interposant des morceaux de cendres vitrifiées.
Ces ballons étant placés, on remplit les intervalles que laissent entre elles'leurs
moitiés supérieures, avec de gros morceaux de cendres, que l’on recouvre avec
des fragmens plus minces, et l’on finit par mettre un lit de cendres fines, qui
s’élève jusqu’à la base du col du ballon.
On pratique encore à chacun des quatre angles du fourneau, dans le lit de
cendres, une ouverture dun decimetre environ de diamètre, pour servir de
cheminée.
Toutes ces dispositions , depuis le remplissage des ballons jusqu’à la mise au
feu, durent une journée.
Conduite du Feu.
L orsque tout est préparé comme on vient de le dire, on jette dans le fourneau,
qui n’a ni grille ni cendrier, une quantité de kers suffisante pour remplir
a-peu-près la moitié de sa capacité : on y met ensuite le feu dans la partie voisine
de la porte ; l’inflammation s’étend lentement sur toute la surface, et gagne insensiblement
jusqu’au fond. Lorsque toute la masse est bien allumée, on bouche
presque entièrement la porte, que l’on avoit commencé à murer avant d’y introduire
le combustible : par ce moyen, l’on n’a pendant long-temps qu’une chaleur
très-foible, qui pénètre lentement les vases sublimatoires. On ne débouche la
porte que lorsqu’il est nécessaire d’augmenter le feu, et l’on ajoute alors, selon
le besoin, de nouveau combustible.
Ce n’est jamais qu’au commencement de la nuit que l’on met le feu au fourneau,
parce que l’opération durant environ soixante heures, elle se trouve, de
cette façon, terminée vers le matin de la troisième journée. L’enlèvement des
pains de sel se fait alors au jour; ce qui est plus commode que-si l’on étoit obligé
d’exécuter ce travail pendant la nuit.
Ce n’est que vers la fin de la première nuit que la chaleur commence à être
un peu forte. A cette époque, il s’exhale déjà des ballons une grande quantité de
vapeurs humides et fuligineuses, mêlées de carbonate d’ammoniaque. Ce n’est
quavec peine que l’on peut rester quelques momens sur le fourneau, sur lequel,
cependant, un ouvrier est obligé de monter pour briser une croûte de sel ammoniac
qui se forme à la surface supérieure des suies, et quelquefois vers l’origine
du col du ballon. Cette croûte, en fermant toute issue aux vapeurs, détermine-
roit la rupture des vaisseaux, si on ne la brisoit avec une sonde de fer, lorsqu’elle
a trop de consistance.
DE FABRIQUER LE SEL AMMONIAC, 4 ^ 5
Vers le milieu de la première journée, la fumée des ballons devient blanche;
et elle diminue sensiblement, quoiqu’alors la chaleur soit portée au plus haut
degré que comporte l’opération. A cette'époque, les suies sont débarrassées de
l’humidité et des parties huileuses qu’elles renfermoient. On découvre avec un balai
les portions de ballon qui sont sans lut, et qui, jusqu’alors, avoient été couvertes
de cendres. Le refroidissement qu’éprouvent les calottes, détermine une portion
du sel qui se sublime à se condenser ; mais une grande portion continue à se
perdre dans l’atmosphère, sous la forme de fumées blanches. Ce n’est véritablement
que de ce moment que le pain de sel commence à se former, la croûte
qui recouvroit les suies ayant été, en très-grande partie, vaporisée par la chaleur
à mesure qu’elle en a pénétré la masse.
Le second jour, dans la matinée, le chef de l’atelier, en frappant à petits
coups sur les calottes, juge si le sel se solidifie; et, dans ce cas, il casse les cols
des ballons, mais sans détacher les morceaux.
Sur le soir du même jour, il examine de nouveau l’état des pains de sel : s’il
les juge bien compactes , il casse les calottes , mais toujours sans enlever les
pièces; si le ballon sonne le creux, l’ouvrier attend quelque temps pour fêler le
verre. Malgré ces précautions , il est très-fréquent que les vapeurs qui se forment
au milieu de la masse des suies, déterminent la rupture du vaisseau au-dessous du
pain de’sel,
: M. Lerouge a remarqué une forte odeur d’acide sulfureux qui se manifeste
lorsque les ballons se brisent.
La sublimation est terminée ordinairement vers le matin du troisième jour.
Si cependant, après avoir enlevé quelques pains, on ne les trouve pas assez
denses, on continue de chaufferies autres pendant quelques heures, en ajoutant
du combustible.
Lorsque l’on juge l’opération entièrement achevée, on procède à l’enlèvement
du sel ammoniac : pour cela, on brise le ballon immédiatement au-dessous de
la masse sublimée, et on enlève la calotte, sans rien déranger au reste. Avec un
peu d’eau froide que l’on jette sur les portions de verre qui restent adhérentes
au pain de sel, on les fait éclater, et on les ôte ensuite avec facilité. Pour séparer
les matières noires qui salissent ordinairement sa surface concave, on est quelquefois
obligé d’employer une petite herminett'e ; si elles tiennent peu, un chiffon
suffit ; et si le sel est sali de quelques taches jaunes ou noires, l’ouvrier les fait
disparoître avec un peu d’eau ou de salive. S’il arrive que le pain de sel présente
quelques parties peu serrées, on les refoule à coups de marteau avant qu’elles soient
refroidies.
Le pain de sel qu’on retire de chaque ballon pèse ordinairement quatre ou cinq
rôties.
La beauté du sel ammoniac dépend, comme on le conçoit bien, de la qualité
des suies et de la conduite du feu. On en fait trois classes, selon sa blancheur;
mais la diffé rence n’est pas suffisamment tranchée pour qu’il n’y ait rien d’arbitraire.
Le plus blanc, celui que l’on nomme raffiné, se retire des matières qui