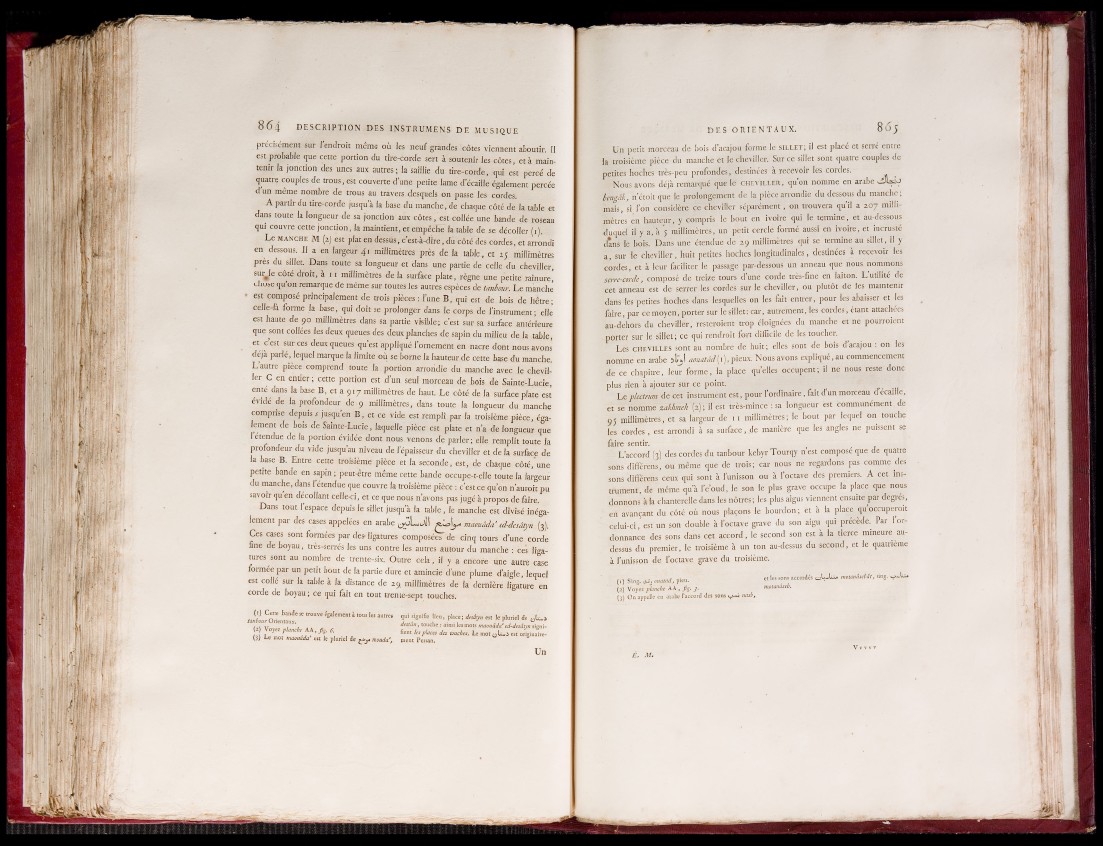
précisément sur i endroit même où les neuf grandes côtes viennent aboutir II
est probable que cette portion du tire-corde sert à soutenir les côtes, et à maintenir
la jonction des unes aux autres; la saillie du tire-corde, qui est percé de
quatre couples de trous, est couverte d’une petite lame d écaillé également percée
d’un même nombre de trous au travers desquels on passe les cordes.
A partir du tire-corde jusqu’à la base du manche, de chaque côté de la table et
dans toute la longueur de sa jonction aux côtes , est collée une bande de roseau
qui couvre cette jonction, la maintient, et empêche la table de se décoller (i).
Le MANCHE M (a j est plat en dessus, c’est-à-dire, du côté des cordes, et arrondi
en dessous. Il a en largeur 4i millimètres près de la table, et 25 millimètres
près du sillet. Dans toute sa longueur et dans une partie de celle du cheviller
surje côté droit, à 11 millimètres de la surface plate, règne une petite rainure]
chose qu’on remarque de même sur toutes les autres espèces de tanbour. Le manche’
* est composé principalement de trois pièces : l’une B, qui est de bois de hêtre;
celleda forme la base, qui doit se prolonger dans Je corps de l’instrument; elle
est haute de 90 millimètres dans sa partie visible; c’est sur sa surface antérieure
que sont collées les deux queues des deux planches de sapin du milieu de la table,
et c est sur ces deux queues qu’est appliqué l’ornement en nacre dont nous avons
déjà paile, lequel marque la limite où se borne la hauteur de cette base du manche.
L’autre pièce comprend toute la ponion arroiidie du manche avec le cheviller
C en entier ; cette portion est d’un seul morceau de bois de Sainte-Lucie,
enté dans la base B, et a 917 millimètres de haut. Le côté de la surface plate est
évidé de la profondeur de-9 millimètres, dans toute la longueur du manche
comprise depuis r jusqu’en B , et ce vide est rempli par la troisième pièce, également
de bois de Sainte-Lucie, laquelle pièce' est plate et n’a de longueur que
1 étendue de la portion évidée dont nous venons de parler; elle remplit toute la
profondeur du vide jusqu’au niveau de l'épaisseur du cheviller et de la surface de
la base B. Entre cette troisième pièce et la seconde, est, de chaque côté, une
petite bande en sapin ; peut-être même cette bande occupe-t-elle toute la largeur
du manche, dans l’étendue que couvre la troisième pièce : c’est ce qu’on n’auroit pu
savoir qu en décollant celle-ci, et ce que nous n’avons pas jugé à propos de faire.
Dans tout l’espace depuis le sillet jusqu’à la table, le manche est divisé inégalement
par des cases appelées en arabe « ù J y maouâda ed-desâtyn (3).
Ces cases sont formées par des-ligatures composées de cinq tours d’une corde
fine de boyau, très-serrés les uns contre les autres autour du manche : ces ligatures
sont au nombre de trente-six. Outre cela, il y a encore une autre case
formée par un peut bout de la partie dure et amincie d’une plume d’aigle, lequel
est colle sur la table à la distance de 29. millimètres de la dernière ligature en
corde de boyau ; ce qui fait en tout trente-sept touches.
H Cette bande se trouve également à tous les autres qui signifie lieu, place; dcsai/n est le pluriel de „ k o tanbour Orientaux. j ... . . . . J . . f u
» . . destan, touche : ainsi les mots maouâda ed-desâtyn sieni-
) oyez p ancie , fig 6. fient f a places des touches. Le mot est originaire-
(3) Le mot maouâda est le pluriel de ¿ yy m o u d a ment Persan.
Un
D E S O R I E N T A U X . 8 6 j
Un petit morceau de bois d’acajou forme le s i l l e t ; il est place et serre entre
la troisième pièce du manche et le cheviller. Sur ce sillet sont quatre couples de
petites hoches très-peu profondes, destinées a recevoir les cordes.
Nous avons déjà remarqué que le c h e v i l l e r , qu’on nomme en arabe -AJUio
bengâk, netoit que le prolongement de la pièce arrondie du dessous du manche;
mais, si l’on considère ce cheviller séparément, on trouvera qu’il a 207 millimètres
en hauteur, y compris le bout en ivoire qui le termine, et au-dessous
duquel il y a, à 5 millimètres, un petit cercle forme aussi en ivoire, et incruste
clans le bois. Dans une étendue de 29 millimètres qui se termine au sillet, il y
a, sur le cheviller, huit petites hoches longitudinales, destinées à recevoir les
cordes, et à leur faciliter le passage par-dessous un anneau que nous nommons
serre-corde, composé de treize tours d’une corde très-fine en laiton. L utilité de
cet anneau est de serrer les cordes sur le cheviller, ou plutôt de les maintenir
dans les petites hoches dans lesquelles on les fait entrer, pour les abaisser et les
faire, par ce moyen, porter sur le sillet; car, autrement, les cordes, étant attachées
au-dehors du cheviller, resteroient trop éloignées du manche et ne pourroient
porter sur le sillet; ce qui rendroit fort difficile de les toucher.
Les c h e v i l l e s sont au nombre de huit; elles sont de bois d acajou . on les
nomme en arabe s ljl aouatâd( 1), pieux. Nous avons expliqué,au commencement
de ce chapitre, leur forme, la place qu’elles occupent; il ne nous reste donc
plus rien à ajouter sur ce point.
Le plectrum de cet instrument est, pour l’ordinaire, fait d un morceau d écaille,
et se nomme zakhmeh '(2) ; il'est très-mince ; sa longueur est communément de
95 millimètres, et sa largeur de 11 millimètres; le bout par lequel on touche
les cordes, est arrondi à sa surface, de manière que les angles ne puissent se
faire sentir.
L’accord (3) des cordes du tanbour kebyr Tourqy n est composé que de quatre
sons différens, ou même que de trois/car nous ne regardons pas comme des
sons différens ceux qui sont à l’unisson ou à 1 octave des premiers. A cet instrument,
de même qu’à l’e’oud, le son le plus grave occupe la place que nous
donnons à la chanterelle dans les nôtres; les plus aigus viennent ensuite par degrés,
en avançant du côté où nous plaçons le bourdon; et à la place qu occuperait
celui-ci, est un son double à l’octave grave du son aigu qui précède. Par (ordonnance
des sons dans cet accord, le second son est a la tierce mineure au-
dessùs du premier, le troisième à un ton au-dessus du second, et le quatrième
à l’unisson de l’octave grave du troisième.
, . „ . et les sons accordés c - L -U ï . motan&sehit, sing. o - U ï .
(1) Sing. OJj ouatai, pieu.
' (2) Voyez plauche A A , fig. 3 . motanâseb.
- (3) On appelle en arabe l’accord des sons nash,