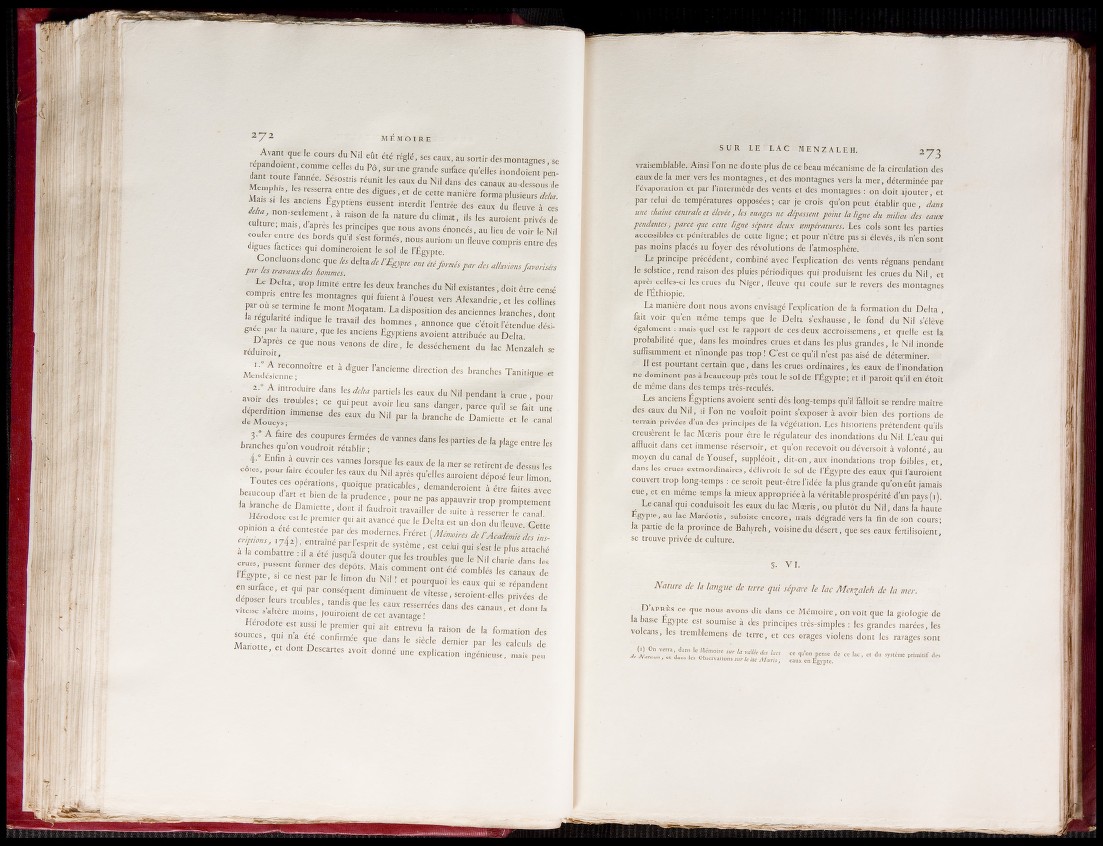
Avant que le cours du Nil eût été réglé, ses eaux, au sortir des montagnes se
répandoient, comme ceiles du Pô, sur une grande surfi.ce qu’e l l e s M B M
dam toute Jannee. Sésostris réunit (es eaux du Nil dans des canaux au-dessous de
M a l Ï l ’s r n c ^ T 3 Cmre ^ ^ ’ 61 de CCtte manière Ma,s s. (es anciens Egyptiens eussent interdit (entrée des eMauxB d uP Mfleeu»ve* à< *c*e*s.
| g | non-seulement , à raison de (a nature du climat, iis les auraient privés de
ture, mais d après (es principes que nous avons énoncés, au lieu de voir le Nil
j SB, deS b° ;ds cfu’iI s ’ e s t ftgï DOUS aUri0ns un fleuve comPris ^tre des
digues factices qui domineroient le sol de (’Egypte.
par les travaux idesn h/o qmUme eMs. delta di l 'ÉgyP" ont été formés par des allumons favorisées
Delta, trop (imité entre les deux branches du Nil existantes , doit être censé
compris entre (es montagnes qui fuient à l’ouest vers Alexandrie, et les collines
iZa eréÎguulâLt tVe irndTiq ue üle tra vail des hoImm deiSsp ,O Saintin°onn dceeS qauned ecn’énteosi tb lr’éatnecnhdeuse> ddéosnit
gnée par la nature, que les anciens Égyptiens avoient attribuée au Delta
réduirok? CC ^ n°US Ven° nS ^ ï j ,C deSséchement du lac Menzaleh se
Mendétenne°m0Ître 1 à digUCr lancienne direction d« hanches Tanitique et
avok° ft w 10dn re dan$ kS ÉÜ PanidS leS eauX du Nil Pendant ,a « u e , pour
voir des troubles; ce qui peut avoir lieu sans danger, parce qu’il se fait une
eaux du N;i par | h Ê de Dam;- e «
b i c h t ^ r ^ f B R I ^ | Ü dC " entre les
4-° Enfin à ouvrir ces vannes lorsque les eaux de la mer se retirent de dessus les
côtes, pour fiure ecouler les eaux du Nil après qu’elles auroient déposé leur limon
Toutes ce, opérations, quoique praticables, demanderoient à être fit,tes avec
beaucoup d art et bien de la prudence, pour ne pas appauvrir trop promu m l
la branche de Damiette, dont il faudroit travailler de'suite à resserL leL an T
Herodote est le premier qui ait avancé que le Delta est un don du fleuve Cet’te
p ion etc contestée par des modernes. Fréret (Mémoires de l'Académie des ins
r r v M l M par,!’esprit de S^ e . est celui qui s’est le plus attaché
om attre il a été jusqua douter que les troubles que le Nil charie dans les
r “ W r * • o n , M com b lé s leT c a n au x d
' * » * ■ " “ P” '« P » » » * ' N i l ! p o u rq u o i l e 1 “ “ ^
d é o o T ' " 9 COnSé1 “ “ ‘ de v l i c s c , ic ro len t - e lle , p r L e de
vviit,ees“se rs, Îalrté.r'éZ mnoisns“, j' o"ui”rdoiiSe n*t 1de cet avanrt'a”ge,!Tte d“ d“ ” «■ « * « h
Hérodote est aussi le premier qui ait entrevu la raison de la formation des
sources, qu, na été confirmée que dans le siècle dernier par les c i de
Mariotte, e, don, D e » , ,« „ o i , donné , « „pllea.ion ¡„pieuse Z £
vraisemblable. Ainsi 1 on ne doute plus de ce beau mécanisme de la circulation des
eaux de la mer vers les montagnes, et des montagnes vers la mer, déterminée par
1 évaporation et par l’intermède des vents et des montagnes : on doit ajouter, et
par celui de températures opposées ; car je crois qu’on peut établir q ue, dans
une chaîne centrale et élevée, les nuages ne dépassent point la ligne du milieu des eaux
pendantes, parce que cette ligne sépare deux températures. Les cols sont les parties
accessibles et pénétrables de cette ligne; et pour n’être pas si élevés, ils n’en sont
pas moins placés au foyer des révolutions de l’atmosphère.
Le principe précédent, combiné avec l’explication des vents régnans pendant
le solstice, rend raison des pluies périodiques qui produisent les crues du N il, et
après celles-ci les crues du Niger, fleuve qui coule sur le revers des montagnes
de l’Éthiopie.
La manière dont nous avons envisagé l’explication de la formation du Delta ,
fait voir qu’en même temps que le Delta s’exhausse, le fond du Nil s’élève
également : mais quel est le rapport de ces deux accroissemens, et quelle est la
probabilité que, dans les moindres crues et dans les plus grandes, le Nil inonde
suffisamment et n inonde pas trop ! C ’est ce qu’il n’est pas aisé de déterminer.
Il est pourtant certain que, dans les crues ordinaires, les eaux de l’inondation
ne dominent pas à beaucoup près tout le sol de l’Égypte; et il paraît qu’il en étoit
de même dans des temps très-reculés.
Les anciens Égyptiens avoient senti dès long-temps qu’il falloit se rendre maître
des eaux du Nil, si Ion ne vouloit point s’exposer à avoir bien des portions de
terrain privées d’un des principes de la végétation. Les historiens prétendent qu’ils
creusèrent le lac Moeris pour être le régulateur des inondations du Nil. L’eau qui
affluoit dans cet immense réservoir, et qu’on recevoit ou déversoit à volonté, au
moyen du canal de Yousef, suppléoit, dit-on, aux inondations trop foibles, et,
dans les crues extraordinaires, délivrait le sol de l’Égypte des eaux qui l’auraient
couvert trop long-temps : ce seroit peut-être l’idée la plus grande qu’on eût jamais
eue, et en même temps la mieux appropriée à la véritable prospérité d’un pays(i).
Le canal qui conduisoit les eaux du lac Moeris, ou plutôt du Nil, dans la haute
Egypte, au lac Maréotis, subsiste encore, mais dégradé vers la fin de son cours;
la partie de la province de Bahyreh, voisine du désert, que ses eaux fertilisoient,’
se trouve privée de culture.
§. VI.
Nature de la langue de terre qui sépare le lac Menzaleh de la mer.
^ D après ce que nous avons dit dans ce Mémoire, on voit que la géologie de
a basse Egypte est soumise à des principes très-simples : les grandes marées, les
vo cans, es tremblemens de terre, et ces orages violens dont les ravages sont
lie ^mNattnromun • eett ddaann5sn Lle*se OOhbeserar0va rt'io ^ns s u^, le lac Moeris, ”ea uqxU 'e°nn Epgeynpstee . de ce iac > et du système primitif des