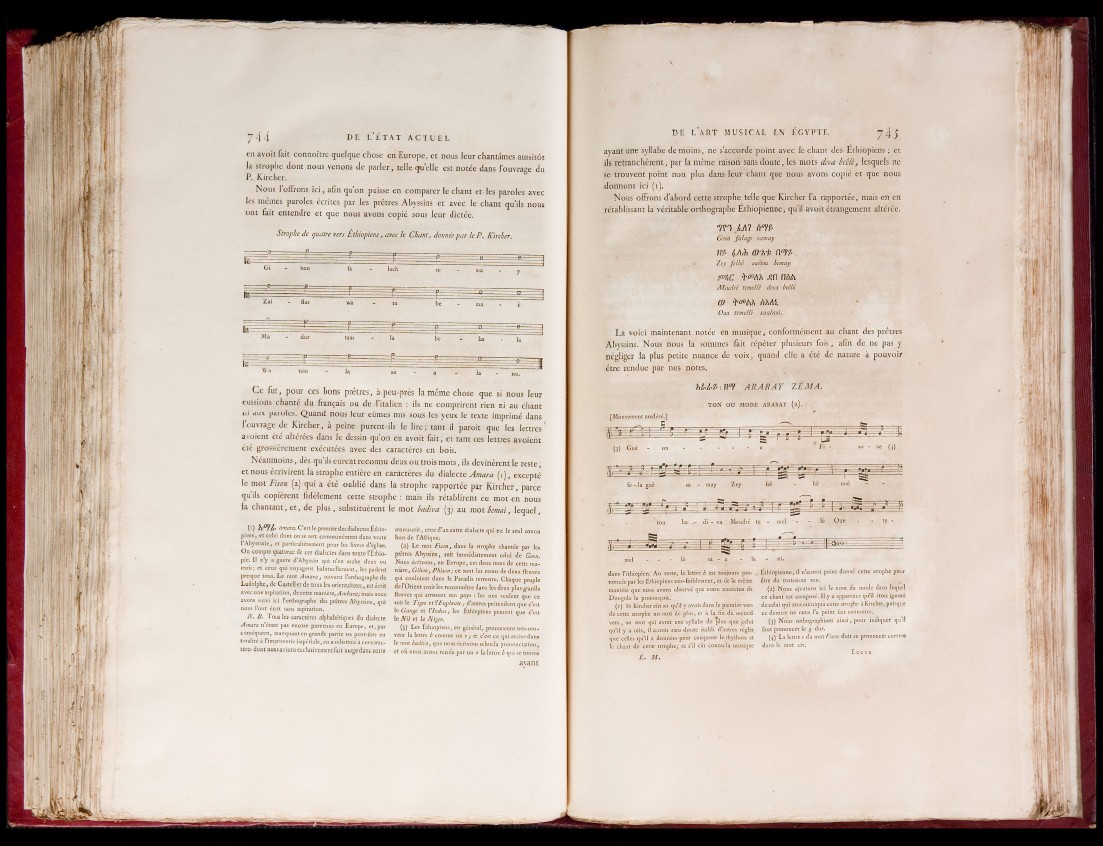
c i l a v o i t fait c o n n o î t r c q u e lq u e c h o s e e n E u r o p e , e t n o u s le u r ch an tâm e s au s s itô t
l a s t ro p h e d o n t n o u s v e n o n s d e p a r l e r , te l le q u e l le e s t n o t é e dans l’o u v r a g e du
P . K ir e h e r .
N o u s l'o ffro n s i c i , a fin q u ’o n p uis se e n c om p a r e r le c h a n t e t les p a ro le s a v e c
le s m êm e s p a ro le s é c r ite s p a r les p rê tre s A b y s s in s e t a v e c le c h a n t q u ’ils n o u s
Ont fa it e n te n d r e e t q u e n o u s a v o n s c o p ié so u s le u r d ic té e .
Strophe de quatre vers Éthiopiens, avec le Chant, donnée par le P. Kireher.
C e f u t , p o u r c e s b o n s p r ê t r e s , à -p eu -p r è s la m êm e c h o s e q u e si n o u s le u r
eu s s io n s ch a n te d u fran ça is o u d e -1 ita lien : ils n e c om p r ir e n t r ie n ni au c h a n t
n i au x p a ro le s . Q u a n d n o u s le u r eûm e s m is sous les y e u x le te x te im p r im é dans
l ’o u v r a g e d e K i r e h e r , à p e in e p u r e n t- ils le l i r e ; ta n t il p a r o ît q u e le s le t tre s
a v o ie n t é té a lté r é e s dans le d essin q u ’o n e n a v o i t f a i t , e t ta n t ce s le t t r e s a v o ie n t
é té g ro s s iè r em en t e x é cu té e s a v e c d e s c a ra c tè r e s e n b o is .
N é a nm o in s , dès q u ’ils eu r e n t r e c o n n u d eu x o u t r o is m o t s , ils d e v in è r e n t le r e s t e ,
e t n o u s é c r iv i r e n t la s t ro p h e e n t iè r e e n c a râ c tè r e s d u d ia le c t e Amara ( i ) , e x c e p té
le m o t Fison (2) q u i a é té o u b lié dans la s t ro p h e r a p p o r té e p a r K i r e h e r , p a r c e
q u ils c o p iè r e n t f id è lem e n t c e t t e s t ro p h e : m ais ils ré ta b lir e n t c e m o t e n n o u s
la c h a n ta n t , e t , d e p lu s , su b s titu è ren t le m o t badiva (3) a u m o t bernai, le q u e l ,
(«) h ° ? i . amara. C ’est le premier des dialectes Éthiopiens,
et celui dont on se sert communément dans toute
l’Abyssinie, et particulièrement pour les livres d’église.
On compte quatorze de ces dialectes dans toute l’Éthio-
pie. II n’y a guère d’Abyssin qui n’en sache deux ou
trois; et ceux qui voyagent habituellement, les parlent
presque tous. Le mot Amara, suivant l’orthographe de
Ludolphe, de Casteliet de tous les orientalistes, est écrit
avec une aspiration, de cette manière, Amhara; mais nous
avons suivi ici l’orthographe des prêtres Abyssins, qui
nous l’ont écrit sans aspiration.
N . B. Tous les caractères alphabétiques du dialecte
Amara n étant pas encore parvenus en Europe, et, par
conséquent, manquant en grande partie ou peut-être en
totalité à l’imprimerie impériale, on a substitué à ces carac-
tères dont nous avions exclusivement fait usage dans notre
manuscrit, ceux d’un autre dialecte qui est le seul connu
hors de l’Afrique.
(2) Le mot Fison, dans la strophe chantée par les
prêtres Abyssins, suit immédiatement celui de Ceon.
Nous écrivons, en Europe, ces deux mots de cette manière,
Gilion, Phison; ce sont les noms de deux fleuves
qui couloient dans le Paradis terrestre. Chaque peuple
de l’Orient croit les reconnoitre dans les deux plus gran’ds
fleuves qui arrosent son pays : les uns veulent que ce
soit le Tigre et YEuphrate; d’autres prétendent que c’est
le Gange et Y Indus ; les Éthiopiens pensent que c’est
le N il et le Niger.
(3) ^es Ethiopiens, en général, prononcent très-souvent
la lettre b comme un vj et c’est ce qui arrive dans
le mot badiva, que nous écrivons selon la prononciation,
et ou nous avons rendu par un v la lettre b qui se trouvé
a y a n t
D E L ART M U S IC A L EN EGY P T E . 7 4 j
ay an t u n e s y llab e de m o in s , n e s’a c c o r d e p o in t a v e c le ch a n t des É th io p ie n s ; e t
ils r e t r a n c h è r e n t , p a r la m êm e ra ison sans d o u t e , les m o t s deva beêlé, le squ e ls ne
se t r o u v e n t p o in t n o n p lu s dans le u r c h a n t q u e n o u s a v o n s c o p ié e t q u e n o u s
d o n n o n s ic i (1). ' • ,
N o u s o ffro n s d ’a b o rd c e t te s t ro p h e te l le q u e K ir e h e r l’a ra p p o r té e , mais e n en
ré tab lis san t la v é r ita b le o r th o g r a p h e E th io p ie n n e , q u ’il a v o i t é tran g em en t a lté ré e .
W f . â A ? 1W Geon jalâge samay
m iMh r w
Zey felhê ouêtou bemay
¡ p l i m nô/h
Meudré temellê deva beêlé
CD hhà'i.
Oua temellê saalani.
L a v o ic i m a in ten an t n o té e en m u s iq u e , c o n fo rm ém e n t au ch a n t des p rê tre s
A b y s s in s . N o u s n o u s là som m e s fa it ré p é te r plus ieurs f o i s , a fin d e n e pas y
n é g lig e r la p lu s p e t it e n u an c e d e v o i x , q u an d e lle a é té d e n a tu re à p o u v o i r
ê tr e r en d u e p a r n o s n o te s .
U°? A R A R A Y Z ÉMA.
TON OU MODE ARARAY (2). '
[Mouvement modéré.] n
(3) Gué so - ne, (4)
fe - la gué
H
ba di - va Meudré te lê Oue
dans l’éthiopien. Au reste, la lettre' b est toujours prononcée
par les Éthiopiens très-foiblement, et de la même
manière que nous avons observé que notre musicien de
Dongola la prononçoit.
(1) Si Kireher eût su qu’il y avoit dans le premier vers
de cette strophe un mot de plus, et à la fin du second
vers, un mot qui avoit une syllabe de plus que celui
qu’il y a mis, il auroit sans doute établi d’autres règles,
que celles qu’il a données pour composer le rhythme et
le chant de cette strophe; et s’il eût connu la musique
Éthiopienne, il n’auroit point donné cette strophe pour
être du ' troisième ton.
(2) Nous ajoutons ici le nom du mode dans lequel
ce chant est composé. Il y a apparence qu’il étoit ignoré
de celui qui communiqua cette strophe à Kireher, puisque
ce dernier ne nous l’a point fait connoitre.
(3) Nous orthographions ainsi, pour indiquer qu il
faut prononcer le g dur.
(4) La lettre s du mot Fison doit se prononcer comme
dans le mot sdn.
Ee-eee