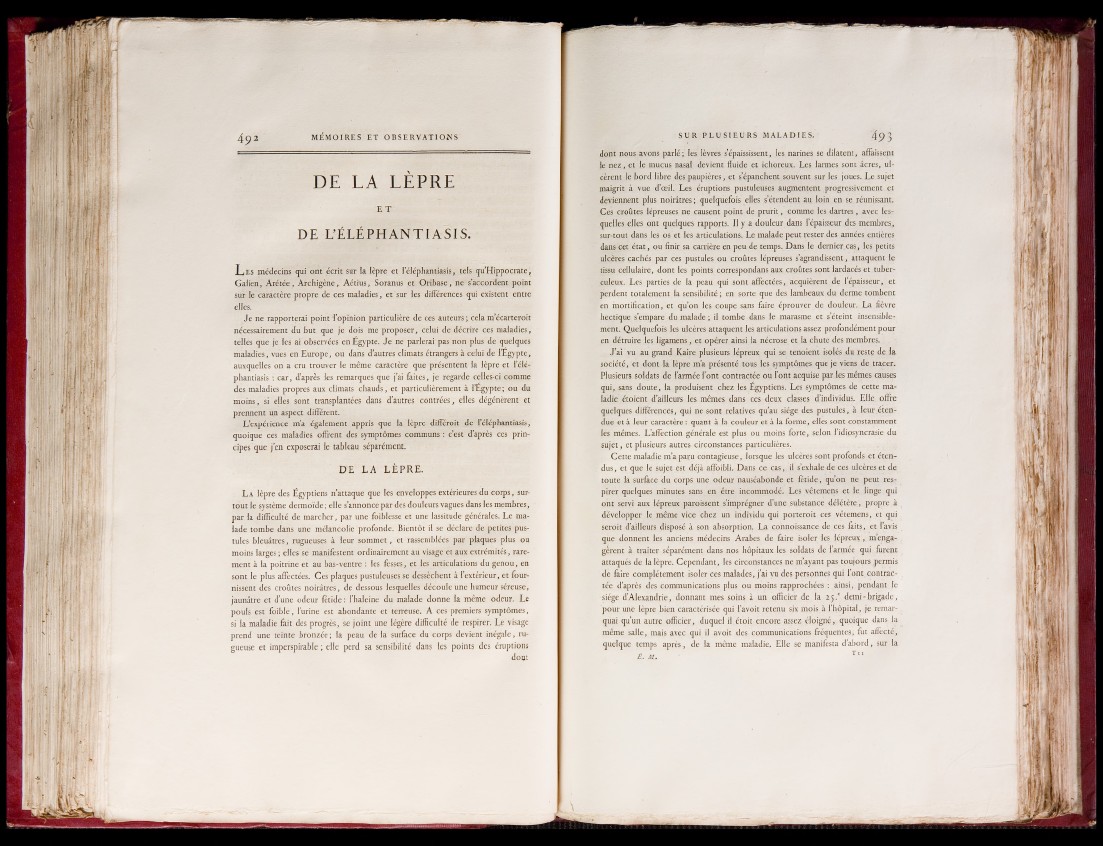
DE LA LÈPRE
E T
DE L’ÉLÉPHANTIASIS.
L es médecins qui ont écrit sur la lèpre et l’éléphantiasis, tels qu’Hippocrate,
Galien, Arétée, Archigène, Aétius, Soranus et Oribase, ne s’accordent point
sur le caractère propre de ces maladies, et sur les différences qui existent entre
elles.
Je ne rapporterai point l’opinion particulière de ces auteurs; cela m’écarteroit
nécessairement du but que je dois me proposer, celui de décrire ces maladies,
telles que je les ai observées en Egypte. Je ne parlerai pas non plus de quelques
maladies, vues en Europe, ou dans d’autres climats étrangers à celui de l’Egypte,
auxquelles on a cru trouver le même caractère que présentent la lèpre et lélé-
phantiasis : car, d’après les remarques que j’ai faites, je regarde celles-ci comme
des maladies propres aux climats chauds, et particulièrement à l’Egypte ; ou du
moins, si elles sont transplantées dans d’autres contrées, elles dégénèrent et
prennent un aspect différent.
L’expérience m’a également appris que la lèpre différoit de l’éléphantiasis,
quoique ces maladies offrent des symptômes communs : c’est d’après ces principes
que j’en exposerai le tableau séparément.
D E L A LÈ PR E .
L a lèpre des Égyptiens n’attaque que les enveloppes extérieures du corps, surtout
le système dermoïde; elle s’annonce par des douleurs vagues dans les membres,
par la difficulté de marcher, par une foiblesse et une lassitude générales. Le malade
tombe dans une mélancolie profonde. Bientôt il se déclare de petites pustules
bleuâtres, rugueuses à leur sommet, et rassemblées par plaques plus ou
moins larges ; elles se manifestent ordinairement au visage et aux extrémités, rarement
à la poitrine et au bas-ventre : les fesses, et les articulations du genou, en
sont le plus affectées. Ces plaques pustuleuses se dessèchent à l’extérieur, et fournissent
des croûtes noirâtres, de dessous lesquelles découle une humeur séreuse,
jaunâtre et d’une odeur fétide : l’haleine du malade donne la même odeur. Le
pouls est foible, l’urine est abondante et terreuse. A ces premiers symptômes,
si la maladie fait des progrès, se joint une légère difficulté de respirer. Le visage
prend une teinte bronzée ; la peau de la surface du corps devient inégale, rugueuse
et imperspirable ; elle perd sa sensibilité dans les points des éruptions
dont
dont nous avons parlé; les lèvres s’épaississent, les narines se dilatent, affaissent
le nez, et le mucus nasal devient fluide et ichoreux. Les larmes, sont âcres, ulcèrent
le bord libre des paupières, et s’épanchent souvent sur les joues. Le sujet
maigrit à vue d’oeil. Les éruptions pustuleuses augmentent progressivement et
deviennent plus noirâtres ; quelquefois elles s’étendent au loin en se réunissant.
Ces croûtes lépreuses ne causent point de prurit, comme les dartres, ayec lesquelles
elles ont quelques rapports. Il y a douleur dans l’épaisseur des membres;,
sur-tout dans les os et les articulations. Le malade peut rester des années entières
dans cet état, ou finir sa carrière en peu de temps. Dans le dernier cas, les petits
ulcères cachés par ces pustules ou croûtes lépreuses s’agrandissent, attaquent le
tissu cellulaire, dont les points correspondans aux croûtes sont lardacés et tuberculeux.
Les parties de la peau qui sont affectées, acquièrent de l’épaisseur, et
perdent totalement la sensibilité; en sorte que des lambeaux du derme tombent
en mortification, et qu’on les coupe sans faire éprouver de douleur. La fièvre
hectique s’empare du malade ; il tombe dans le marasme et s’éteint insensiblement.
Quelquefois les ulcères attaquent les articulations assez profondément pour
en détruire les ligamens, et opérer ainsi la nécrose et la chute des membres.
J’ai vu au grand Kaire plusieurs lépreux qui se tenoient isolés du reste de la
société, et dont la lèpre m’a présenté tous les symptômes que je viens de tracer.
Plusieurs soldats de l’armée l’ont contractée ou l’ont acquise par les mêmes causes
qui, sans doute, la produisent chez les Égyptiens. Les symptômes de cette maladie
étoient d’ailleurs les mêmes dans ces deux classes d’individus. Elle offre
quelques différences, qui ne sont relatives qu’au siège des pustules, à leur.étendue
et à leur caractère : quant à la couleur et à la forme, elles sont constamment
les mêmes. L’affection générale est plus ou moins forte, selon l’idiosyncrasie du
sujet, et plusieurs autres circonstances particulières.
Cette maladie m’a paru contagieuse, lorsque les ulcères sont profonds et étendus,
et que le sujet est déjà affoibli. Dans ce cas, il s’exhale de ces ulcères et de
toute la surface du corps une odeur nauséabonde et fétide, qu’on ne peut respirer
quelques minutes sans en être incommodé. Les vêtemens et le linge qui
ont servi aux lépreux paroissent s’imprégner d’une substance délétère, propre à
développer le même vice chez un individu qui porteroit ces vêtemens, et qui
seroit d’ailleurs disposé à son absorption. La connoissance de ces faits, et l’avis
que donnent les anciens médecins Arabes de faire isoler les lépreux , m’engagèrent
à traiter séparément dans nos hôpitaux les soldats de l’armée qui furent
attaqués de la lèpre. Cependant, les circonstances ne m’ayant pas toujours permis
de faire complètement isoler ces malades, j’ai vu des personnes qui l’ont contractée
d’après des communications plus ou moins rapprochées ; ainsi, pendant le
siège d’Alexandrie, donnant mes soins à un officier de la zy.c demi-brigade,
pour une lèpre bien caractérisée qui l’avoit retenu six mois à l’hôpital, je remarquai
qu’un autre officier, duquel ii.étoit encore assez éloigné, quoique dans la
même salle, mais avec qui il avoit des communications fréquentes, fut affecté,
quelque temps après, de la même maladie. Elle se manifesta d’abord, sur la
É. M.. Ttt