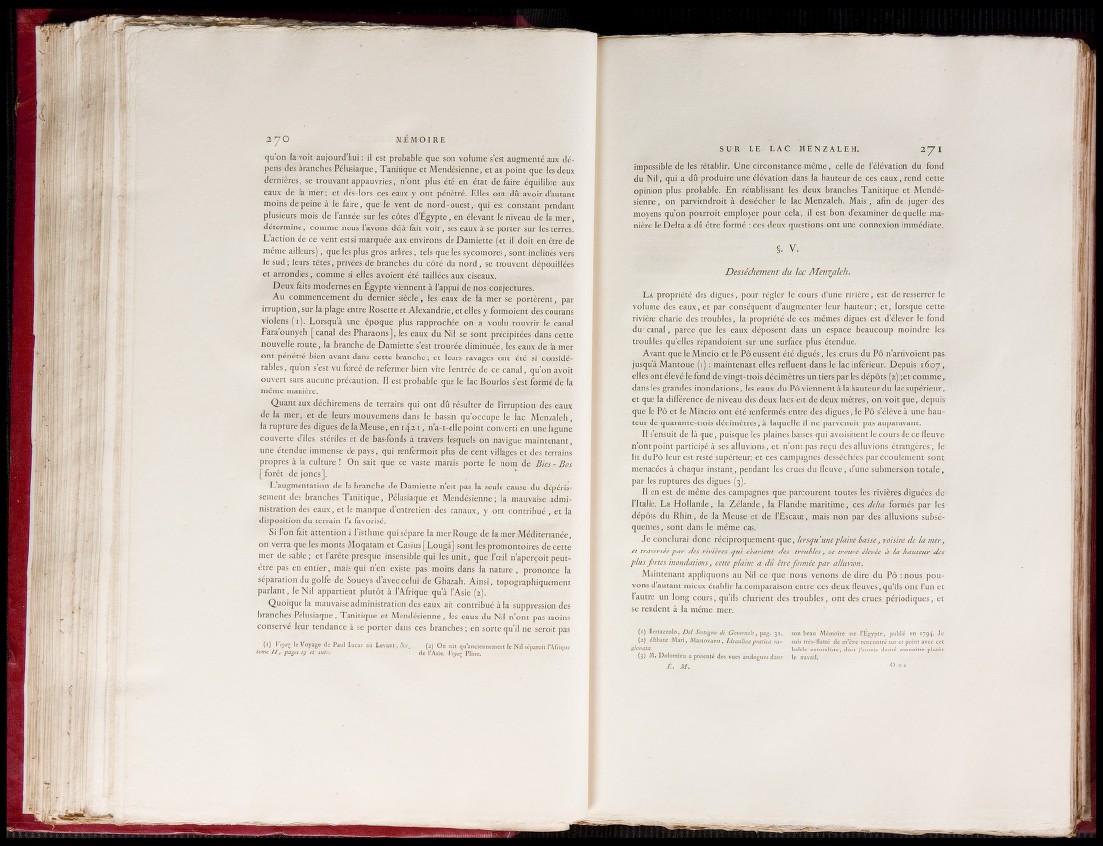
'm l
r a i l
M l mm
i l
IL j
I
II i l
H
1 «H
m i ti
f i
si ï ii
7 ° MEMOIRE
qu’on la voit aujourd’hui : il est probable que son volume s’est augmenté aux dépens
des branches Pélusiaque, Tanitique et Mendésienne, et au point que les deux
dernières, se trouvant appauvries, n’ont plus été en état de faire équilibre aux
eaux de la rrler; et dès-lors ces eaux y ont pénétré. Elles ont dû avoir d’autant
moins de peine à le faire, que le vent de nord-ouest,- qui est constant pendant
plusieurs mois de l’année sur les côtes d’Égypte, en élevant le niveau de la mer,
détermine, comme nous l’avons déjà'fàit voir, ses eaux à se porter sur les terres.
L action de ce vent est si marquée aux environs de Damiette (et il doit en être de
meme ailleurs), que les plus gros arbres, tels que les sycomores, sont inclinés vers
le sud ; leurs têtes, privées de branches du côté du nord, se trouvent dépouillées
et arrondies, comme si elles avoient été taillées aux ciseaux.
Deux faits modernes en Égypte viennent à l’appui de nos conjectures.
Au commencement du dernier siècle, les eaux de la mer se portèrent, par
irruption, sur la plage entre Rosette et Alexandrie, et elles y formoient des courans
violens (i). Lorsqu’à une époque plus rapprochée on a voulu rouvrir le canal
Faraounyeh [canal des Pharaons], les eaux du Nil se sont précipitées dans cette
nouvelle route, la branche de Damiette s’est trouvée diminuée, les eaux de la mer
ont pénétré bien avant dans cette branche ; et leurs ravages ont été si considérables,
qu’on s’est vu forcé de refermer bien vite l’entrée de ce canal, qu’on avoit
ouvert sans aucune précaution. Il est probable que le lac Bourlos s’est formé de la
même manière.
Quant aux déchiremens de terrains qui ont dû résulter de l’irruption des eaux
de la mer, et de leurs mouvemens dans le bassin qu’occupe le lac Menzaleh,
la rupture des digues de la Meuse, en i /¡.a i , n’a-t-elle point converti en une lagune
couverte d îles stériles et de bas-fonds à travers lesquels on navigue maintenant,
une étendue immense de pays, qui renfermoit plus de cent villages et des terrains
propres à la culture ! On sait que ce vaste marais porte le nom de Bies - Bos
[forêt de joncs].
L’augmentation de la branche de Damiette n’est pas la seule cause du dépérissement
des branches Tanitique, Pélusiaque et Mendésienne; la mauvaise administration
des eaux, et le manque d’entretien des canaux, y ont contribué , et la
disposition du terrain l’a favorisé.
Si l’on fait attention à l’isthme qui sépare la mer Rouge de la mer Méditerranée,
on verra que les monts Moqatam et Casius [Lougâ] sont les promontoires de cette
mer de sable ; et l’arête presque insensible qui les unit, que l’oeil n’aperçoit peut-
être pas en entier, mais qui n’en existe pas moins dans la nature , prononce la
séparation du golfe de Soueys d’avec celui de Ghazah. Ainsi, topographiquement
parlant, le Nil appartient plutôt à l’Afrique qu’à l’Asie (2).
Quoique la mauvaise administration des eaux ait contribué à la suppression des
branches Pélusiaque, Tanitique et Mendésienne, les eaux du Nil n’ont pas moins
conservé leur tendance à se porter dans ces branches ; en sorte qu’il ne seroit pas
(■) Voyz le Voyage de Paul Lucas au Levant, & c. (2) On sait qu’anciennement le Nil séparait l’Afrique
tome I I , pages iS et smp. de l’Asie. Koyej Pline.
■■■
impossible de les rétablir. Une circonstance même, celle de l’élévation du fond
du Nil, qui a dû produire une élévation dans la hauteur de ces eaux, rend cette
opinion plus probable. En rétablissant les deux branches Tanitique et Mendésienne,
on parviendroit à dessécher le lac Menzaleh. Mais, afin de juger des
moyens qu’on pourroit employer pour cela, il est bon d’examiner de quelle manière
le Delta a dû être formé : ces deux questions ont une connexion immédiate.
§• V.
Dessèchement du lac Menzaleh.
L a propriété des digues, pour régler le cours d’une rivière, est de resserrer le
volume des eaux, et par conséquent d’augmenter leur hauteur; et, lorsque cette
rivière charie des troubles, la propriété dè ces mêmes digues est d’élever le fond
du- canal, parce que les eaux déposent dans un espace beaucoup moindre les
troubles qu’elles répandoient sur une surface plus étendue.
Avant que le Mincio et le Pô eussent été digués, les crues du Pô n’arrivoient pas.
jusqu’à Mantoue (1) : maintenant elles refluent dans le lac inférieur. Depuis 1607,
elles ont élevé le fond de vingt-trois décimètres un tiers parles dépôts (2) ;et comme,
dans les grandes inondations, les eaux du Pô viennent à la hauteur du lac supérieur,
et que la différence de niveau des deux lacs est de deux mètres, on voit que, depuis
que le Pô et le Mincio ont été renfermés entre des digues, le Pô s’élève à une hauteur
de quarante-trois décimètres, à laquelle il ne parvenoit pas auparavant.
II s’ensuit de là que, puisque les plaines basses qui avoisinent le cours de ce fleuve
n’ont point participé à ses alluvions, et n’ont pas reçu des alluvions étrangères , le
lit duPô leur est resté supérieur; et ces campagnes desséchées par écoulement sont
menacées à chaque instant, pendant les crues du fleuve, d’une submersion totale,
par les ruptures des digues (3).
Il en est de même des campagnes que parcourent toutes les rivières diguées de
l’Italie. La Hollande, la Zélande, la Flandre maritime, ces delta formés par les
dépôts du Rhin, de la Meuse et de l’Escaut, mais non par des alluvions subséquentes,
sont dans le même cas.
Je conclurai donc réciproquement que, lorsqu’une plaine basse, voisine de la mer,
et traversée par des rivières qui charient des troubles, se trouve élevée à la hauteur des
plus fortes inondations, cette plaine a dû être formée par alluvion.
Maintenant appliquons au Nil ce que nous venons de dire du Pô : nous pouvons
d autant mieux établir la comparaison entre ces deux fleuves, qu’ils ont l’un et
1 autre un long cours, qu’ils charient des troubles, ont des crues périodiques, et
se rendent à la même mer.
(1) Bertazzolo, De l Sostegno di Governolo, pag. 31, son beau Mémoire sur l’Egypte, publié en 1794. Je
(-} Abbate Mari, Mantovano, Idraulica pratica ra- suis très-flatté de m’être rencontré sur ce point avec cet
gtottata. habile naturaliste, dont j’aurais désiré connoître plutôt
(3) M. Dolomieu a présente des vues analogues dans le travail.
É . M . 0 ° -