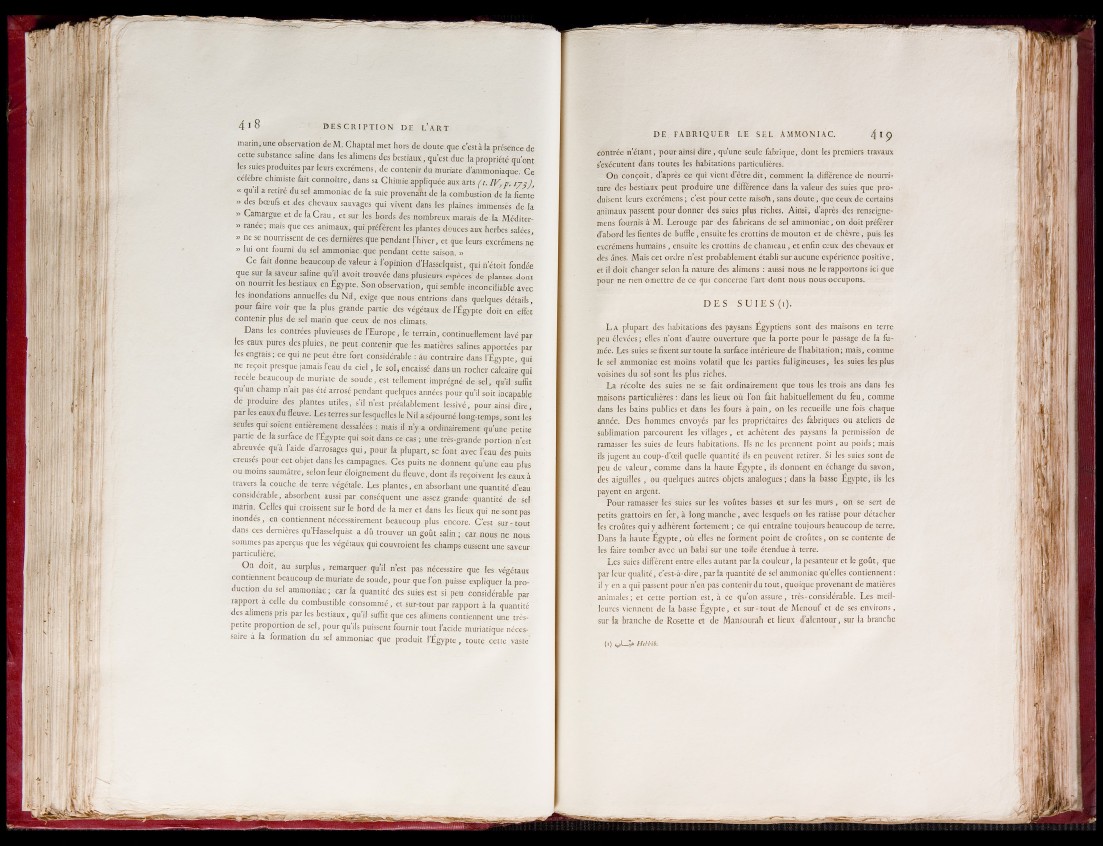
marin, une observation deM. Cliaptal met hors de doute que c’est à la présence de
cette substance saline dans les alimens des bestiaux, qu’est due la propriété qu’ont
lès suies produites par leurs excrémens, de contenir du muriate d'ammoniaque. Ce
célèbre chimiste lait connoître, dans sa Chimie appliquée aux arts (t. IV, p. 171<),
« qu il a retiré du sel ammoniac de la suie provenait de la combustion de la fiente
» des boeufs et .des chevaux sauvages qui vivent dans les plaines immenses de la
» Camargue et de la Crau, et sur les bords des nombreux marais de la Méditer-
» ranée; mais que ces animaux, qui préfèrent les plantes douces aux herbes salées,
» ne se nourrissent de ces dernières que pendant l’hiver, et que leurs excrémens né
» lui ont fourni du sel ammoniac, que pendant cette saison. »
Ce fait donne beaucoup de valeur à l’opinion d’Hasselquist, qui n’étoit fondée
que sur la saveur saline qu’il avoit trouvée dans plusieurs espèces’ de plantes dont
on nourrit les bestiaux en Égypte. Son observation, qui semble inconciliable avec
les inondations annuelles du Nil, exige que nous entrions dans quelques détails,
pour faire voir que la plus grande partie des végétaux de l’Ëgypte doit en effet
contenir plus de sel marin que ceux de nos climats.
Dans les contrées pluvieuses de l’Europe, le terrain, continuellement lavé par
les eaux pures des pluies, ne peut contenir que les matières salines apportées par
les engrais ; ce qui ne peut être fort considérable : au contraire dans l’Égypte, qui
ne reçoit presque jamais l’eau du ciel, le sol, encaissé dans un rocher calcaire qui
recèle beaucoup de muriate de soude, est tellement imprégné de sel, qu’il suffit
qu un champ n ait pas été arrosé pendant quelques années pour qu’il soit incapable
de produire des plantes utiles, s’il n’est préalablement lessivé, pour ainsi dire,,
par les eaux du fleuve. Les terres sur lesquelles le Nil a séjourné long-temps, sont les
seules qui soient entièrement dessalées : mais il n’y a ordinairement qu’une petite
partie de la surface de l’Égypte qui soit dans ce cas ; une très-grande portion n’est
abreuvée qua laide d’arrosages qui, pour la plupart, se font avec l’eau des puits
creusés pour cet objet dans les campagnes. Ces puits ne donnent qu’une eau plus
ou moins saumâtre, selon leur éloignement du fleuve, dont ils reçoivent les eaux à
travers la couche de terre végétale. Les plantes, en absorbant une quantité d’eau
considérable, absorbent aussi par conséquent une assez grande quantité, de sel
marin. Celles qui croissent sur le bord de la mer et dans les lieux qui ne sont pas
inondés, en contiennent nécessairement beaucoup plus encore. C’est sur - tout
dans ces dernières quHasselquist a dû trouver un goût salin ;.car nous ne nous
sommes pas aperçus que les végétaux qui couvroient les champs eussent une saveur
particulière!
On doit, au surplus, remarquer qu’il n’est pas nécessaire que les végétaux
contiennent beaucoup de muriate de soude, pour que l’on puisse expliquer la production
du sel ammoniac ; car la quantité des suies est si peu considérable par
rapport a celle du combustible consommé, et sur-tout par rapport à la quantité
des alimens pris par les bestiaux, qu’il suffit que ces alimens contiennent une très-
petite proportion de sel, pour qu’ils puissent fournir tout l’acide muriatique nécessaire
à la formation du sel ammoniac que produit l’Égypte, toute cette vaste'
DE. FABRIQUER LE SEL AMMONIAC. 4 ! Q
contrée n’étant, pour ainsi dire, qu’une seule fabrique, dont les premiers travaux
s’exécutent dans toutes les habitations particulières.
On conçoit, d’après ce qui vient detre dit, comment la différence de nourriture
des bestiaux peut produire une différence dans la valeur des suies que produisent
leurs excrémens ; c’est pour cette raisoti, sans doute, que ceux de certains
animaux passent pour donner des suies plus riches. Ainsi, d’après des renseigne-
mens fournis à M. Lerouge par des fabricans de sel ammoniac, on doit préférer
d’abord les fientes de buffle, ensuite les crottins de mouton et de chèvre, puis les
excrémens humains, ensuite les crottins de chameau , et enfin ceux des chevaux et
des ânes. Mais cet ordre n’est probablement établi sur aucune expérience positive,
et il doit changer selon la nature des alimens : aussi nous ne le rapportons ici que
pour ne rien omettre de cé qui concerne l’art dont nous nous occupons.
D E S SUI E S (1).
L a plupart des habitations des paysans Égyptiens sont des maisons en terre
peu élevées ; elles n’ont d’autre ouverture que la porte pour le passage de la fumée.
Les suies se fixent sur toute la surface intérieure de l’habitation; mais, comme
le sel ammoniac est moins volatil que les parties fui igincuses, les suies les plus
voisines du sol sont les plus riches.
La récolte des suies ne se fait ordinairement que tous les trois ans dans les
maisons particulières : dans les lieux où l’on fait habituellement du feu, comme
dans les bains publics et dans les fours à pain, on les recueille une fois chaque
année. Des hommes envoyés par les propriétaires des fabriques ou ateliers de
sublimation parcourent les villages, et achètent des paysans la permission de
ramasser les suies de leurs habitations. Ils ne les prennent point au poids; mais
ils jugent au coup-d’oeil quelle quantité ils en peuvent retirer. Si les suies sont de
peu de valeur, comme dans la haute Égypte, ils donnent en échange du savon,
des aiguilles , ou quelques autres objets analogues; dans la basse Égypte, ils les
payent en argent.
Pour ramasser les suies sur les voûtes basses et sur les murs, on se sert de
petits grattoirs en fer, à long manche , avec lesquels on les ratisse pour détacher
les croûtes qui y adhèrent fortement ; ce qui entraîne toujours beaucoup de terre.
Dans la haute Égypte, où elles ne forment point de croûtes, on se contente de
les faire tomber avec un balai sur une toile étendue à terre.
Les suies diffèrent entre elles autant par la couleur, la pesanteur et le goût, que
par leur qualité, c’est-à-dire, par la quantité de sel ammoniac qu’elles contiennent :
il y en a qui passent pour n’en pas contenir du tout, quoique provenant de matières
animales; et cette portion est, à ce qu’on assure, très-considérable. Les meilleures
viennent de la basse Égypte, et sur-tout de Menouf et de ses environs,
sur la branche de Rosette et de Mansourah et lieux d’alentour, sur la branche
(1) c_jl ai& Hel'bâb.