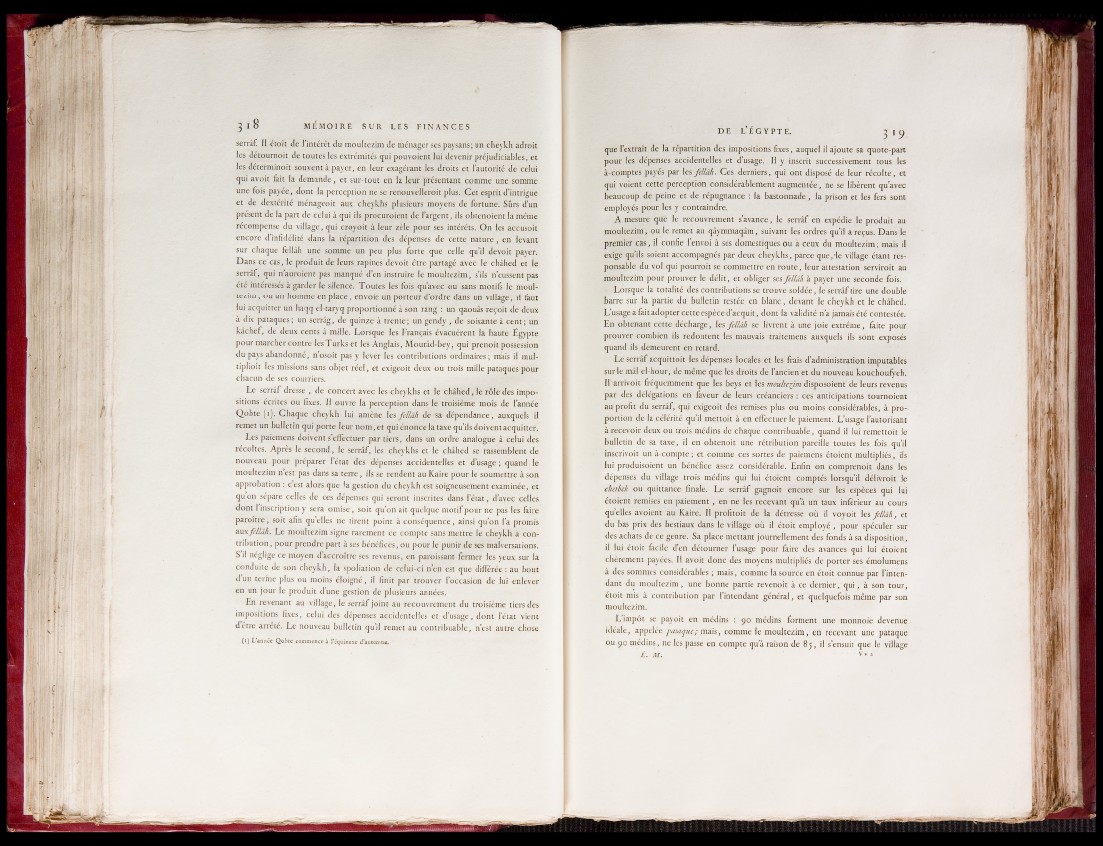
serrâf. Il étoit de l’intérêt du moultezim de ménager ses paysans; un cheykh adroit
les détournoit de toutes les extrémités qui pouvoient lui devenir préjudiciables, et
les déterminoit souvent à payer, en leur exagérant les droits et l’autorité de celui
qui avoit fait la demande, et sur-tout en la leur présentant comme une somme
une fois payée, dont la perception ne se renouvellerait plus. Cet esprit d’intrigue
et de dextérité ménageoit aux cheykhs plusieurs moyens de fortune. Sûrs d’un
présent de la part de celui à qui ils procuraient de l’argent, ils obtenoient la même
récompense du village, qui croyoit à leur zèle pour ses intérêts. On les accusoit
encore d’infidélité dans la répartition des dépenses de cette nature, en levant
sur chaque fellâh une somme un peu plus forte que celle qu’il devoit payer.
Dans ce cas, le produit de leurs rapines devoit être partagé avec le châhed et le
serrâf, qui n’auroient pas manqué d’en instruire le moultezim, s’ils n’eussent pas
été intéressés à garder le silence. Toutes les fois qu’avec ou sans motifs le moultezim,
ou un homme en place, envoie un porteur d’ordre dans un village, il faut
lui acquitter un haqq el-taryq proportionné à son rang : un qaouâs reçoit de deux
à dix pataquès; un serrâg, de quinze à trente; un gendy , de soixante à cent; un
kâchef, de deux cents à mille. Lorsque les Français évacuèrent la haute Égypte
pour marcher contre les Turks et les Anglais, Mourâd-bey, qui prenoit possession
du pays abandonné, n’osoit pas y lever les contributions ordinaires; mais il mul-
tiplioit les missions sans objet réel, et exigeoit deux ou trois mille pataquès pour
chacun de ses courriers.
Le serrâf dresse , de concert avec les cheykhs et le châhed, le rôle des impositions
écrites ou fixes. Il ouvre la perception dans le troisième mois de l’année
Qobte (1). Chaque cheykh lui amène les fellâh de sa dépendance, auxquels il
remet un bulletin qui porte leur nom, et qui énonce la taxe qu’ils doivent acquitter.
Les paiemens doivent s’effectuer par tiers, dans un ordre analogue à celui des
récoltés. Après le second, le serrâf, les cheykhs et le châhed se rassemblent de
nouveau pour préparer l’état des dépenses accidentelles et d’usage ; quand le
moultezim n est pas dans sa terre, ils se rendent au Kaire pour le soumettre à son
approbation : cest alors que la gestion du cheykh est soigneusement examinée, et
quon séparé celles de ces dépenses qui seront inscrites dans l’état, d’avec celles
dont 1 inscription y sera omise, soit qu’on ait quelque motif pour ne pas les faire
paraître, soit afin qu elles ne tirent point à conséquence, ainsi qu’on l’a promis
aux fellâh. Le moultezim signe rarement ce compte sans mettre le cheykh à contribution,
pour prendre part à ses bénéfices, ou pour le punir de ses malversations.
S il néglige ce moyen d’accroître ses revenus, en paraissant fermer les yeux, sur la
conduite de son cheykh, la spoliation de celui-ci n’en est que différée : au bout
dun terme plus ou moins éloigné, il finit par trouver l’occasion de lui enlever
en un jour le produit d’une gestion de plusieurs années.
En revenant au village, le serrâf joint au recouvrement du troisième tiers des
impositions fixes, celui des dépenses accidentelles et d’usage, dont l’état vient
dette arrête. Le nouveau bulletin qu’il remet au contribuable, n’est autre chose
(1) L’année Qobte commence à l’équinoxe d’automne.
que l’extrait de la répartition des impositions fixes, auquel il ajoute sa quote-part
pour les dépenses accidentelles et d’usage. Il y inscrit successivement tous les
à-comptes payés par les fellâh. Ces derniers, qui ont disposé de leur récolte, et
qui voient cette perception considérablement augmentée, ne se libèrent qu’avec
beaucoup de peine et de répugnance ; la bastonnade , la prison et les fers sont
employés pour les y contraindre.
A mesure què le recouvrement s’avance, le serrâf en expédie le produit au
moultezim, ou le remet au qâymmaqâm, suivant les ordres qu’il a reçus. Dans le
premier cas, il confie l’envoi à ses domestiques ou à ceux du moultezim ; mais il
exige qu’ils soient accompagnés par deux cheykhs, parce que ,'Ie village étant responsable
du vol qui pourrait se commettre en route, leur attestation servirait au
moultezim pour prouver le délit, et obliger ses fellâli à payer une seconde fois.
Lorsque la totalité des contributions se trouve soldée, le serrâf tire une double
barre sur la partie du bulletin restée en blanc, devant le cheykh et le châhed.
L’usage a fait adopter cette espèce d’acquit, dont la validité n’a jamais été contestée.
En obtenant cette décharge, les fellâh se livrent à une joie extrême, faite pour
prouver combien ils redoutent les mauvais traitemens auxquels ils sont exposés
quand ils demeurent en retard.
Le serrâf acquittoit les dépenses locales et les frais d’administration imputables
sur le mal el-hour, de même que les droits de l’ancien et du nouveau kouchoufyeh.
Iharrivoit fréquemment que les beys et les moultefim disposoient de leurs revenus
par des délégations en faveur de leurs créanciers : ces anticipations tournoient
au profit du serrâf, qui exigeoit des remises plus ou moins considérables, à proportion
de la célérité qu’il mettoit à en effectuer le paiement. L’usage l’autorisant
à recevoir deux ou trois médins de chaque contribuable, quand il lui remettoit le
bulletin de sa taxe, il en obtenoit une rétribution pareille toutes les fois qu’il
inscrivoit un à-compte; et comme ces sortes de paiemens étoient multipliés, ils
lui produisoient un bénéfice assez considérable. Enfin on comprenoit dans les
dépenses du village trois médins qui lui étoient comptés lorsqu’il délivrait le
chetbeh ou quittance finale. Le serrâf gagnoit encore sur les espèces qui lui
étoient remises en paiement , en ne les recevant qu’à un taux inférieur au cours
qu’elles avoient au Kaire. Il profitoit de la détresse où il voyoit les fellâh, et
du bas prix des bestiaux dans le village où il étoit employé , pour spéculer sur
des achats de ce genre. Sa place mettant journellement des fonds à sa disposition,
il lui étoit facile d’en détourner l’usage pour faire des avances qui lui étoient
chèrement payées. Il avoit donc des moyens multipliés de porter ses émolumens
à des sommes considérables ; mais, comme la source en étoit connue par l’intendant
du moultezim, une bonne partie revenoit à ce dernier, qui, à son tour,
etoit mis à contribution par l’intendant général, et quelquefois même par son
moultezim.
L impôt se payoit en médins : 90 médins forment une monnoie devenue
idéale, appelée pataque; mais, comme le moultezim, en recevant une pataque
ou 90 médins, ne les passe en compte qu’à raison de 85, il s’ensuit que le village
É . m . v » »