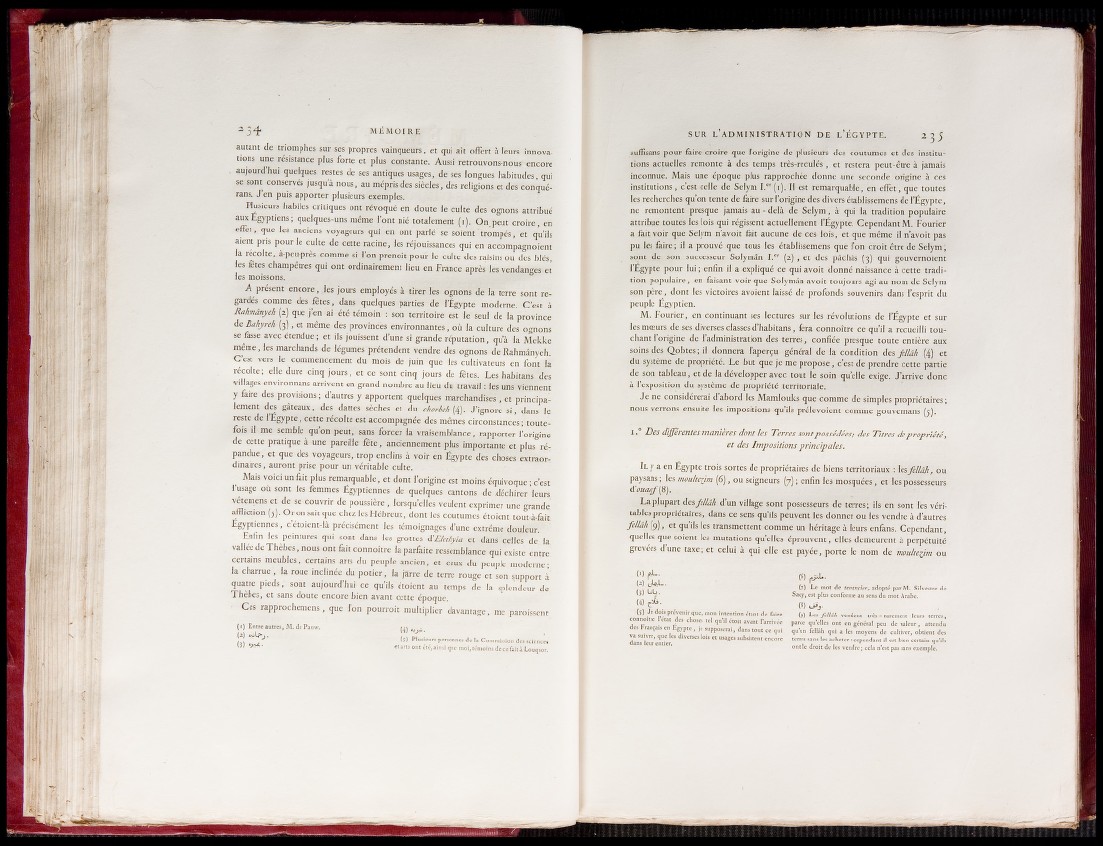
autant de triomphes sur ses propres vainqueurs| et qui ait offert à leurs innovations
une résistance plus forte et plus constante. Aussi retrouvons-nous encore
aujourdhuí quelques restes de ses antiques usages, de ses longues habitudes, qui
se sont conservés jusqu’à nous, au mépris des siècles, des religions et des conqué-
rans. T en puis apporter plusieurs exemples.
Plusieurs habiles critiques ont révoqué en doute le culte des ognons attribué
aux Egyptiens; quelques-uns même l’ont nié totalement (i). On peut croire, en
effet, que les anciens voyageurs qui en ont parlé se soient trompés, et qu’ils
aient pris pour le culte de cette racine, les réjouissances qui en accompagnoient
la récolte, à-peu-près comme si l’on prenoit pour le culte des raisins ou des blés,
les fêtes champêtres qui ont ordinairement lieu en France après les vendanges et
les moissons.
A présent encore, les jours employés à tirer les ognons de la terre sont regardés
comme des fêtes, dans quelques parties de l’Egypte moderne. C ’est à
Rahmânyeh (2) que j’en ai été témoin : son territoire est le seul de la province
de Bahyreh (3), et même des provinces environnantes, où la culture des ognons
se fasse avec étendue; et ils jouissent d’une si grande réputation, qu’à la Mekke
meme, les marchands de légumes prétendent vendre des ognons de Rahmânyeh.
C ’est vers le commencement du mois de juin que les cultivateurs en font la
récolte; elle dure cinq jours, et ce sont cinq jours de fêtes. Les habitans des
villages environnais arrivent en grand nombre au lieu du travail : les uns viennent
y faire des provisions ; d autres y apportent quelques marchandises , et principalement
des gâteaux, des dattes sèches et du chorbeh (4). J’ignore si, dans le
reste de 1 Egypte, cette récolte est accompagnée des mêmes circonstances ;' toutefois
il me semble quon peut, sans forcer la vraisemblance, rapporter l’origine
de cette pratique à une pareille fête, anciennement plus importante et plus répandue,
et que des voyageurs, trop enclins à voir en Egypte des choses extraordinaires,
auront prise pour un véritable culte.
Mais voici un fkit plus remarquable, et dont l’origine est moins équivoque ; c’est
l’usage où sont les femmes Égyptiennes de quelques cantons de .déchirer leurs
vêtemens et de se couvrir de poussière , lorsqu’elles veulent exprimer une grande
affliction (5). Or on sait que chez les Hébreux, dont les coutumes étoient tout-à-fait
Egyptiennes, c étoient-là précisément les témoignages d’une extrême douleur.
Enfin les peintures qui sont dans les grottes d’Elethyia et dans celles de la
vallée de Thèbes, nous ont fait connoître la parfaite ressemblance qui existe entre
certains meubles, certains arts du peuple ancien, et ceux du peuple moderne;
la charrue, la roue inclinée du potier, la jarre de terre rouge et son support à
quatre pieds, sont aujourd’hui ce qu’ils étoient au temps de la splendeur de
Thèbes, et sans doute encore bien avant cette époque.
Ces rapprochemens, que l’on pourrait multiplier davantage, me paraissent
(1) Entre autres, M. de Pauw.
(2)
(3)
(4)
(5) Plusieurs personnes de la Commission des sciences
et arts ont été, ainsi que moi, témoins de cefaîtàLouqsor.
suffisans pour faire croire que l’origine de plusieurs des coutumes et des institutions
actuelles remonte à des temps très-reculés , et restera peut-être à jamais
inconnue. Mais une époque plus rapprochée donne une seconde origine à ces
institutions, c’est celle de Selym I." (1). Il est remarquable, en effet, que toutes
les recherches qu’on tente de faire sur l’origine des divers établissemens de l’Egypte,
ne remontent presque jamais au - delà de Selym, à qui la tradition populaire
attribue toutes les lois qui régissent actuellement l’Egypte. Cependant M. Fourier
a fait voir que Selym n’avoit fkit aucune de ces lois, et que même il n’avoit pas
pu les faire; il a prouvé que tous les établissemens que l’on croit être de Selym;
sont de son successeur Solymân I." (2) , et des pâchâs (3) qui gouvernoient
1 Egypte pour lui; enfin il a expliqué ce qui avoit donné naissance à cette tradition
populaire, en faisant voir que Solymân avoit toujours agi au nom de Selym
son père, dont les victoires avoient laissé de profonds souvenirs dans l’esprit du
peuple Égyptien.
M. Fourier, en continuant ses lectures sur les révolutions de l’Egypte et sur
les moeurs de ses diverses classes d’habitans, fera connoître ce qu’il a recueilli touchant
1 origine de 1 administration des terres, confiée presque toute entière aux
soins des Qobtes; il donnera l’aperçu général de la condition des fellâh (4) et
du système de propriété. Le but que je me propose, c’est de prendre cette partie
de son tableau, et de la développer avec tout le soin qu’elle exige. J’arrive donc
à 1 exposition du système de propriété territoriale.
Je ne considérerai d abord les Mamlouks que comme de simples propriétaires ;
nous verrons ensuite les impositions quils prélevoient comme gouvernans (yj.
1.° Des différentes manières dont les Terres sont possédées; des Titres de propriété,
et des Impositions principales.
Il y a en Egypte trois sortes de propriétaires de biens territoriaux : les fellâh, ou
paysans ; les moulteiim (6), ou seigneurs (7) ; enfin les mosquées, et les possesseurs
A'ouaqf(9>Y
La plupart desfellâh d’un village sont possesseurs de terres; ils en sont les véritables
propriétaires, dans ce sens qu’ils peuvent les donner ou les vendre à d’autres
fellâh (9), et qu’ils les transmettent comme un héritage à leurs enfans. Cependant,
quelles que soient les mutations qu’elles éprouvent, elles demeurent à perpétuité
grevées dune taxe; et celui à qui elle est payée, porte le nom de moulteiim ou
(l) ¡É l («) l ü
IÎ 0UL. Ç- . . , . . 17) mot de tenancier, adopte par M. Silvestre de
S ' Sacy, est plus conforme au sens du mot Arabe.
• I I g f e j j ( 8 ) H
(5) Je dots prévenir que, mon intention étant de faire (9) Les fellâh vendent très - rarement leurs terres,
e e at es c oses te quil étoit avant 1 arrivée parce qu’elles ont en général peu de valeur, attendu
rançais en gypte, je supposerai, dans tout ce qui qu’un fellâh qui a les moyens de cultiver, obtient des
va suivre, que les diverses lois et usages subsistent encore terres sans les acheter : cependant il est bien certain qu’ils
dans leur entier. , . . , , » , ,
ont le droit de les vendre; cela n est pas sans exemple.