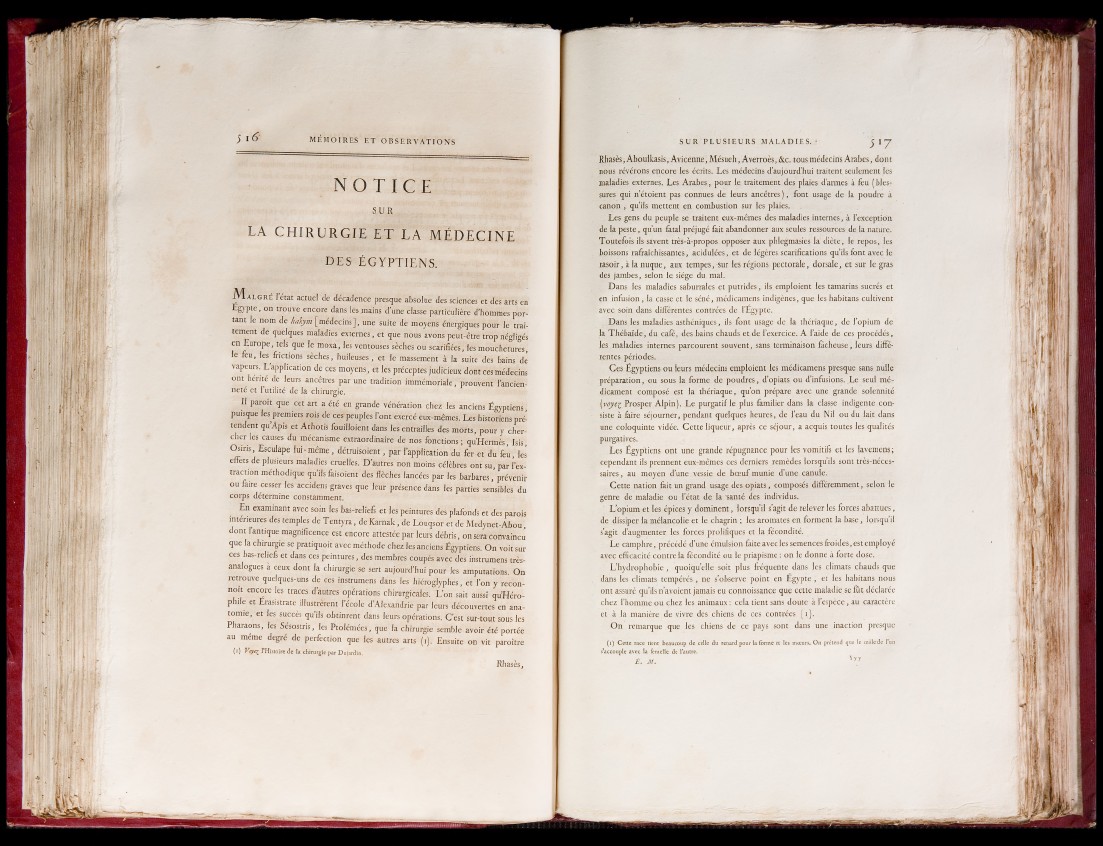
N O T I C E
S U R
LA CHIRURGIE ET LA MEDECINE
DES ÉGYPTIENS.
M a l g r é létat actuel de décadence presque absolue des sciences et dés arts en
Egypte, on trouve encore dans lés mains d’une classe particulière d’hommes portant
le nom de hahym [médecins], une suite de moyens énergiques pour Je traitement
de quelques maladies externes, et que nous avons peut-être trop négligés
en Europe, tels que le moxa, les ventouses sèches ou scarifiées, les mouchetures -,
le feu, les frictions sèches, huileuses, et le massement à la suite des bains de
vapeurs. L application de ces moyens, et les préceptes judicieux dont ces médecins
ont hérité de leurs ancêtres par une tradition immémoriale, prouvent (’ancienneté
et l’utilité de la chirurgie.
Il parott que cet art a été en grande vénération chez les anciens Égyptiens,
puisque les premiers rois de ces peuples l’ont exercé eux-mêmes. Les historiens prétendent
qu’Apis et Athotis fouilloient dans les entrailles des morts, pour y chercher
les causes du mécanisme extraordinaire de nos fonctions; qu’Hermès, Isis,
Osiris, Esculape lui-même, détruisoient, par l’application du fer et du feu, les
effets de plusieurs maladies cruelles. D’autres non moins célèbres ont su, par l’extraction
méthodique qu’ils faisoient des flèches lancées par les barbares, prévenir
ou faire cesser les accidens graves que leur présence dans les parties sensibles du
corps détermine constamment.
En examinant avec soin les bas-reliefs et les peintures des plafonds et des parois
intérieures des temples de Tentyra, de Karnak, de Louqsor et de Medynet-Abou,
dont 1 antique magnificence est encore attestée par leurs débris, on sera convaincu
que la chirurgie se pratiquoit avec méthode chez les anciens Égyptiens. On voit sur
ces bas-reliefs et dans ces peintures, des membres coupés avec des instrumens très-
analogues a ceux dont la chirurgie se sert aujourd’hui pour les amputations. On
retrouve quelques-uns de ces instrumens dans les hiéroglyphes, et l’on y recon-
noît encore les traces, d’autres opérations chirurgicales. L’on sait aussi qu’Héro-
P et Erasistratc illustrèrent l’école d’Alexandrie par leurs découvertes en anatomie,
et les succès qu’ils obtinrent dans leurs opérations. C’est sur-tout sous les
Pharaons, les Sésostris, les Ptolémées, que la chirurgie semble avoir été portée
au même degre de perfection que les autres arts (i). Ensuite on vit paroître
(0 y V I l’Histoire de la chirurgie par Dujardm .
Rhasès,
Rhasès, Aboulkasis, Avicenne, Mésueh, Averroès, &c. tous médecins Arabes, dont
nous révérons encore les écrits. Les médecins d’aujourd’hui traitent seulement les
maladies externes. Les Arabes, pour le traitement des plaies d’armes à feu (blessures
qui n’étoient pas connues de leurs ancêtres ), font usage de la poudre à
canon , qu’ils mettent en combustion sur les plaies.
Les gens du peuple se traitent eux-mêmes des maladies internes, à l’exception
de la peste, qu’un fatal préjugé fait abandonner aux seules ressources de la nature.
Toutefois ils savent très-à-propos opposer aux phlegmasies la diète, le repos, les
boissons rafraîchissantes, acidulées, et de légères scarifications qu’ils font avec le
rasoir, à la nuque, aux tempes, sur les régions pectorale, dorsale, et sur le gras
des jambes, selon le siège du mal.
Dans les maladies saburrales et putrides, ils emploient les tamarins sucrés et
en infusion, la casse et le séné, médicamens indigènes, que les habitans cultivent
avec soin dans différentes contrées de l’Égypte.
Dans les maladies asthéniques, ils font usage de la thériaque, de l’opium de
la Thébaïde, du café, des bains chauds et de l’exercice. A l’aide de ces procédés,
les maladies internes parcourent souvent, sans terminaison fâcheuse, leurs différentes
périodes.
Ces Égyptiens ou leurs médecins emploient les médicamens presque sans nulle
préparation, ou sous la forme de poudres, d’opiats ou d’infusions. Le seul médicament
composé est la thériaque, qu’on prépare avec une grande solennité
(voyez Prosper Alpin). Le purgatif le plus familier dans la classe indigente consiste
à faire séjourner, pendant quelques heures, de l’eau du Nil ou du lait dans
une coloquinte vidée. Cette liqueur, après ce séjour, a acquis toutes les qualités
purgatives.
Les Égyptiens ont une grande répugnance pour les vomitifs et les lavemens;
cependant ils prennent eux-mêmes ces derniers remèdes lorsqu’ils sont très-nécessaires
, au moyen d’une vessie de boeuf munie d’une canule.
Cette nation fait un grand usage des opiats, composés différemment, selon le
genre de maladie ou l’état de la ■santé des individus.
L’opium et les épices y dominent, lorsqu’il s’agit de relever les forces abattues,
de dissiper la mélancolie et le chagrin ; les aromates en forment 1a base, lorsqu’il
s’agit d’augmenter les forces prolifiques et la fécondité.
Le camphre, précédé d’une émulsion faite avec les semences froides, est employé
avec efficacité contre la fécondité ou le priapisme : on le donne à forte dose.
L’hydrophobie , quoiqu’elle soit plus fréquente dans les climats chauds que
dans les climats tempérés, ne s’observe point en Égypte , et les habitans nous
ont assuré qu’ils n’avoient jamais eu connoissance que cette maladie.se fut déclarée
chez l’homme ou chez les animaux : cela tient sans doute à l’espèce, au caractère
et à la manière de vivre des chiens de ces contrées (i ).
On remarque que les chiens de ce pays sont dans une inaction presque
(i) Cette race tient beaucoup de celle du renard pour la forme et les moeurs. On prétend que le mâle’de l’un
s’accouple avec la femelle de l’autre.
t . m . m