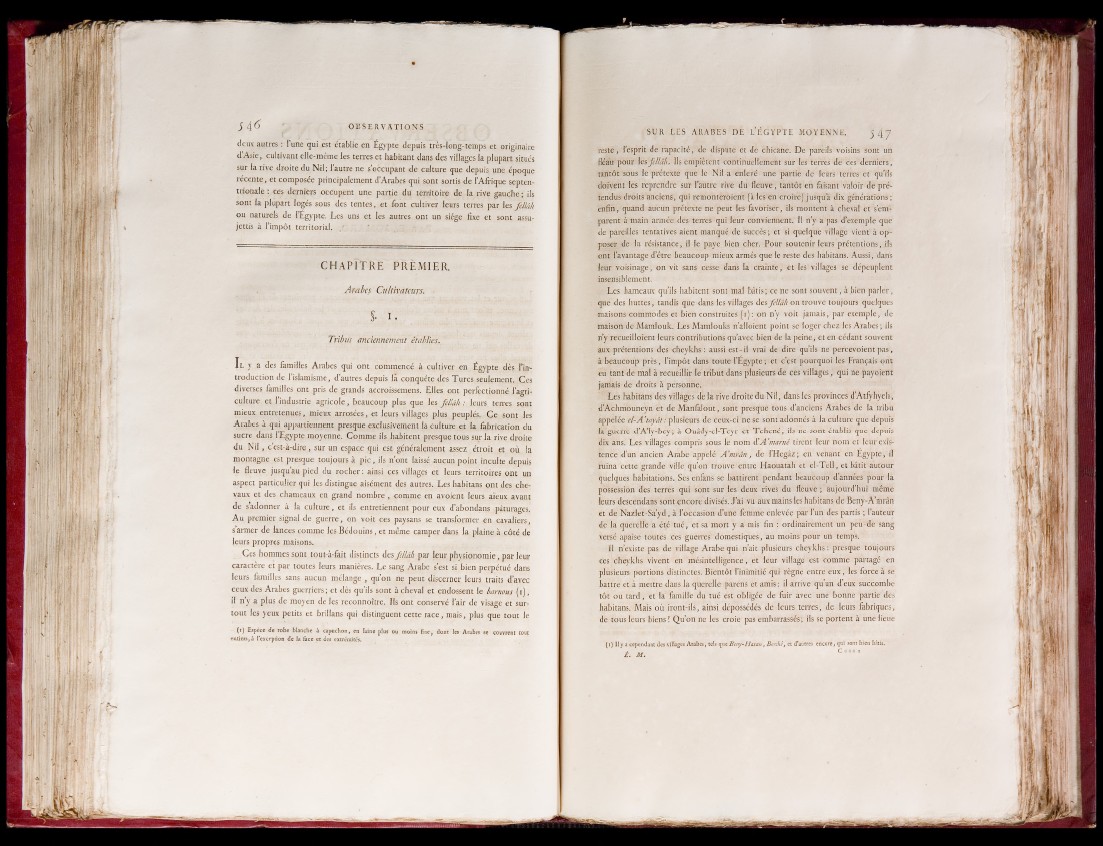
§
I
5 4 6 ” | o b s e r v a t i o n s ,;
deux autres : lune qui est établie en Égypte depuis très-long-temps et originaire
d’Asie, cultivant elle-même les terres et habitant dans des villages la plupart situés
sur la rive droite du Nil ; l’autre ne s’occupant de culture que depuis une époque
récente, et composée principalement d’Arabes qui sont sortis de l’Afrique septentrionale
: ces derniers occupent une partie du territoire de la rive gauche ; ils
sont la plupart logés sous des tentes, et font cultiver leurs terres par les fellah
ou naturels de l’Egypte. Les uns et les autres ont un siège fixe et sont assujettis
à l’impôt territorial. /
C H A P I T R E PREMIER.
Amies Cultivateurs.
.i I •
Tribus anciennement établies.
I l y a des familles Arabes qui ont commencé à cultiver en Êgypte dès l’introduction
de l’islamisme, d’autres depuis là conquête des Turcs seulement. Ces
diverses familles ont pris de grands accroissemens. Elles ont perfectionné l’agriculture
et l’industrie agricole, beaucoup plus que les fellâh : leurs terres sont
mieux entretenues, mieux arrosées, et leurs villages plus peuplés. Ce sont les
Arabes à qui appartiennent presque exclusivement la culture et la fabrication du
sucre dans 1 Egypte moyenne. Comme ils habitent presque tous sur la rive droite
du Nil , cest-à-dire, sur un espace qui est généralement assez étroit et où la
montagne est presque toujours à pic, ils n’ont laissé aucun point inculte depuis
le fleuve jusqu’au pied du rocher : ainsi ces villages et leurs territoires ont un
aspect particulier qui les distingue aisément des autres. Les habitans ont des chevaux
et des chameaux en grand nombre , comme en avoient leurs aïeux avant
de s’adonner à la culture, et ils entretiennent pour eux d’abondans pâturages.
Au premier signal de guerre, on voit ces paysans se transformer en cavaliers,
s armer de lances comme les Bédouins, et même camper dans la plaine à côté de
leurs propres maisons.
Ces hommes sont tout-à-fkit distincts des fellâh par leur physionomie, par leur
caractère et par toutes leurs manières. Le sang Arabe s’est si bien perpétué dans
leurs familles sans aucun mélange , qu’on ne peut discerner leurs traits d’avec
ceux des Arabes guerriers; et dès qu’ils sont à cheval et endossent le larnous (i),
il n’y a plus de moyen de les reconnoître. Ils ont conservé l’air de visage et surtout
les yeux petits et brillans qui distinguent cette race, mais, plus que tout le
• (i) Espèce de robe blanche a capuchon, en laine plus ou moins fine, dont les Arabes se couvrent tout
entiers, à l’exception de la face et des extrémités.
S U R L E S A R A B E S D E L E G Y P T E M O Y E N N E . j 4 7
reste, l’esprit de rapacité, de dispute et de chicane. De pareils voisins sont un
fléau pour les fellâh. Us empiètent continuellement sur les terrés de ces derniers,
tantôt sous le prétexte que le Nil a enlevé tine partie de leurs terres et qu’ils
doivent les reprendre sur l’autre rive du fleuve, tantôt en faisant valoir de prétendus
droits anciens, qui remonteroient (à les en croire) jusqu’à dix générations ;
enfin, quand aucun prétexte ne peut les favoriser, ils montent à cheval et s’emparent
à main armée des terres qui leur conviennent. Il n’y a pas d’exemple que
de pareilles tentatives aient manqué de succès; et si quelque village vient à opposer
de la résistance, il le paye bien cher. Pour soutenir leurs prétentions, .ils
ont l’avantage d’être beaucoup mieux armés que le reste des habitans. Aussi, dans
leur voisinage, on vit sans cesse dans la crainte, et les villages se dépeuplent
insensiblement.
Les hameaux qu’ils habitent sont mal bâtis; ce ne sont souvent, à,bien parler,
que des huttes, tandis que dans les villages desfellâh on trouve toujours quelques
maisons commodes et bien construites (i) : on n’y voit jamais, par exemple, de
maison de Mamlouk. Les Mamiouks n’alloient point se loger chez les Arabes; ils
n’y recueilloient leurs contributions qu’avec bien de la peine, et en cédant souvent
aux prétentions des cheykhs : aussi est-il vrai de dire qu’ils ne percevoient pas,
à beaucoup près, l’impôt dans toute l’Egypte; et c’est pourquoi les Français' ont
eu tant de mal à recueillir le tribut dans plusieurs de ces villages, qui ne payorent
jamais de droits à personne.
Les habitans des villages delà rive droitedu Nil, dans les provinces d’Atfÿhyeh,
d’Achmouneyn et de Manfalout, sont presque tous d’anciens Arabes de la tribu
appelée el-A’tayât: plusieurs de ceux-ci ne se sont adonnés à la culture que depuis
la guerre d’A’ly-bey; à Ouâdy-el-Teyr et Tehené, ils ne sont établis que depuis
dix ans. Les villages compris sous le nom tSIA’marné tirent leur nom et leur existence
d’un ancien Arabe appelé A ’mrân, de l’Hegâz; en venant en Égypte, il
ruina cette grande ville qu’on trouve entre Haouatah et el-Tell, et bâtit autour
quelques habitations. Ses enfans se battirent pendant beaucoup d’années pour la
possession des terres qui sont sur les deux rives du fleuve ; aujourd’hui même
leurs descendans sont encore divisés. J’ai vu aux mains les habitans de Beny-A’mrân
et de Nazlet-Sa’yd, à l’occasion d’une femme enlevée par l’un des partis ; l’auteur
de la querelle a été tué, et sa mort y a mis fin : ordinairement un peu de sang
versé apaise toutes ces guerres domestiques, au moins pour un temps.
Il n’existe pas de village Arabe qui n’ait plusieurs cheykhs : presque toujours
ces cheykhs vivent en mésintelligence, et leur village est comme partagé en
plusieurs portions distinctes. Bientôt l’inimitié qui règne entre eux, les force à se
battre et à mettre dans la querelle parens et amis : il arrive qu’un d’eux succombe
tôt ou tard, et la famille du tué est obligée de fuir avec une bonne partie des
habitans. Mais où iront-ils, ainsi dépossédés de leurs terres, de leurs fabriques,
de tous leurs biens î Qu’on ne les croie pas embarrassés ; ils se portent à une lieue
(i) IIy a cependant des villages Arabes, tels que Beny-Hasan, Berché, et d’autres encore, qui sont bien bâtis.
. C c c c a
É. M.