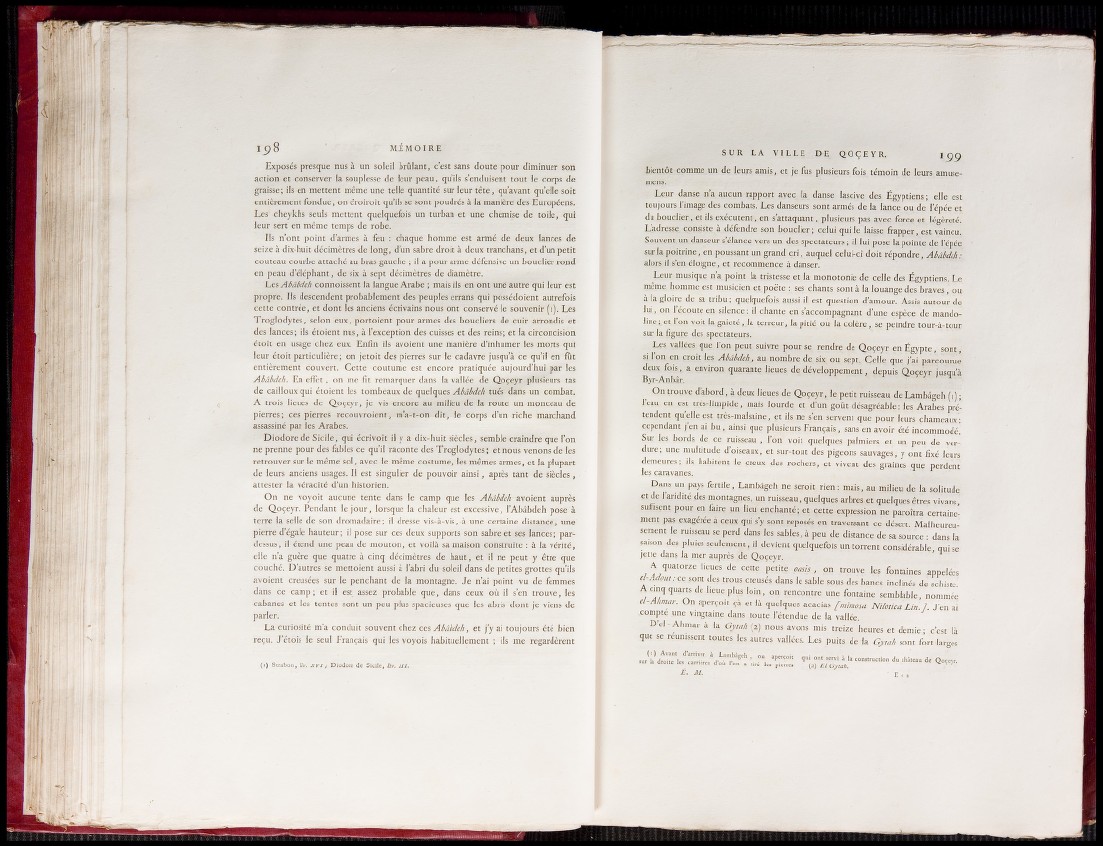
Exposés presque nus à un soleil brûlant, c’est sans doute pour diminuer son
action et conserver la souplesse de leur peau, qu’ils s’enduisent tout le corps de
graisse; ils en mettent même une telle quantité sur leur tête, qu’avant qu’elle soit
entièrement fondue, on croiroit qu’ils se sont poudrés à la manière des Européens.
Les cheykhs seuls mettent quelquefois un turban et une chemise de toile, qui
leur sert en même temps de robe.
Ils n’ont point d’armes à feu : chaque homme est armé de deux lances de
seize à dix-huit décimètres de long, d’un sabre droit à deux tranchans, et d’un petit
couteau courbe attaché au bras gauche ; il a pour arme défensive un bouclier rond
en peau d’éléphant, de six à sept décimètres de diamètre.
Les Abâbdeh connoissent la langue Arabe ; mais ils en ont une autre qui leur est
propre. Ils descendent probablement des peuples errans qui possédoient autrefois
cette contrée, et dont les anciens écrivains nous ont conservé le souvenir (i). Les
Troglodytes, selon eux, portoient pour armes des boucliers de cuir arrondis et
des lances; ils étoient nus, à l’exception des cuisses et des reins; et la circoncision
étoit en usage chez eux. Enfin ils avoient une manière d’inhumer les morts qui
leur étoit particulière; on jetoit des pierres sur le cadavre jusqu’à ce qu’il en fût
entièrement couvert. Cette coutume est encore pratiquée aujourd’hui par les
Abâbdeh. En effet, on me fit remarquer dans la vallée de Qoçeyr plusieurs tas
de cailloux qui étoient les tombeaux de quelques Abâbdeh tués dans un combat.
A trois lieues de Qoçeyr, je vis encore au milieu de la route un monceau de
pierres; ces pierres recouvroient, m’a-t-on dit, le corps d’un riche marchand
assassiné par les Arabes.
Diodore de Sicile, qui écrivoit il y a dix-huit siècles, semble craindre que l’on
ne prenne pour des fables ce qu’il raconte des Troglodytes; et nous venons de les
retrouver sur le même sol, avec le même costume, les mêmes armes, et la plupart
de leurs anciens usages. Il est singulier de pouvoir ainsi, après tant de siècles,
attester la véracité d’un historien.
On ne voyoit aucune tente dans le camp que les Abâbdeh avoient auprès
de Qoçeyr. Pendant le jour, lorsque la chaleur est excessive, l’Abâbdeh pose à
terre la selle de son dromadaire; il dresse vis-à-vis, à une certaine distance, une
pierre d’égale hauteur ; il pose sur ces deux supports son sabre et ses lances ; pardessus,
il étend une peau de mouton, et voilà sa maison construite : à la vérité,
elle n’a guère que quatre à cinq décimètres de haut, et il ne peut y être que
couché. D’autres se mettoient aussi à l’abri du soleil dans de petites grottes qu’ils
avoient creusées sur le penchant de la montagne. Je n’ai point vu de femmes
dans ce camp; et il est assez probable que, dans ceux où il s’en trouve, les
cabanes et les tentes sont un peu plus spacieuses que les abris dont je viens de
parler.
La curiosité m’a conduit souvent chez ces Abâbdeh, et j’y ai toujours été bien
reçu. J’étois le seul Français qui les voyois habituellement ; ils me regardèrent
(i) Strabon, liy, x v i ; Diodore de Sicile, liv. i i i .
S U R L A V I L L E D E Q O Ç E Y R . i p o
bientôt comme un de leurs amis, et je fus plusieurs fois témoin de leurs amuse-
mens.
Leur danse n’a aucun rapport avec la danse lascive des Égyptiens ; elle est
toujours l’image des combats. Les danseurs sont armés de la lance ou de lepée et
du bouclier, et ils exécutent, en s’attaquant, plusieurs pas avec force et légèreté.
Ladresse consiste a defendre son bouclier; celui qui le laisse frapper, est vaincu.
Souvent un danseur s elance vers un des spectateurs ; il lui pose la pointe de l’épée
sur la poitrine, en poussant un grand cri, auquel celui-ci doit répondre, Abâbdeh:
alors il s’en éloigne, et recommence à danser.
Leur musique n’a point la tristesse et la monotonie de celle des Égyptiens. Le
meme homme est musicien et poète : ses chants sont à la louange des braves, ou
a la gloire de sa tribu; quelquefois aussi il est question d’amour. Assis autour de
lui, on 1 écoute en silence: il chante en s’accompagnant d’une espèce de mandoline
;.etl.on voit la gaieté, la terreur, la pitié ou la colère, se peindre tour-à-tour
sur la figure des spectateurs.
Les valjees que 1 on peut suivre pour se rendre de Qoçeyr en Égypte, sont,
si l’on en croit les Abâbdeh , au nombre de six ou sept. Celle que j’ai parcourue
deux fois, a environ quarante lieues de développement, depuis Qoçeyr jusqu’à
Byr-Anbâr.
On trouve d’abord, à deux lieues de Qoçeyr, le petit ruisseau de Lambâgeh (i) ;
leau en est très-limpide, mais lourde et d’un goût désagréable: les Arabes prétendent
qu’elle est très-malsaine, et ils ne s’en servent que pour leurs chameaux;
cependant j en ai bu, ainsi que plusieurs Français, sans en avoir été incommodé.
Sur les bords de ce ruisseau , l’on voit quelques palmiers et un peu de verdure;
une multitude doiseaux, et sur-tout des pigeons sauvages, y ont fixé leurs
demeures; ils habitent le creux des rochers, et vivent des graines que perdent
les caravanes. •
Dans un pays fertile, Lambâgeh ne seroit rien : mais, au milieu de la solitude
et de l’aridité des montagnes, un ruisseau, quelques arbres et quelques êtres vivans,
suffisent pour en faire un lieu enchanté; et cette expression ne paroîtra certainement
pas exageree a ceux qui s’y sont reposés en traversant ce désert. Malheureusement
le ruisseau se perd dans les sables, à peu de distance de sa source : dans la
saison des pluies seulement, il devient quelquefois un torrent considérable, qui se
jette dans la mer auprès de Qoçeyr.
A quatorze lieues de cette petite oasis, on trouve les fontaines appelées
el-Adout: ce sont des trous creusés dans le sable sous des bancs inclinés de schiste.
cinq quarts de lieue plus loin, on rencontre une fontaine semblable, nommée
el-Ahmar. On aperçoit çà et là quelques acacias [mimosa Nilotica Lin. J. J’en ai
compte une vingtaine dans toute l’étendue de la vallée.
D el-Ahmar à la Gytah (2) nous avons mis treize heures et demie; c’est là
que se reunissent toutes les autres vallées. Les puits de la Gytah sont fort larges
c™ ion * <*wr.
Ê.M. E c >