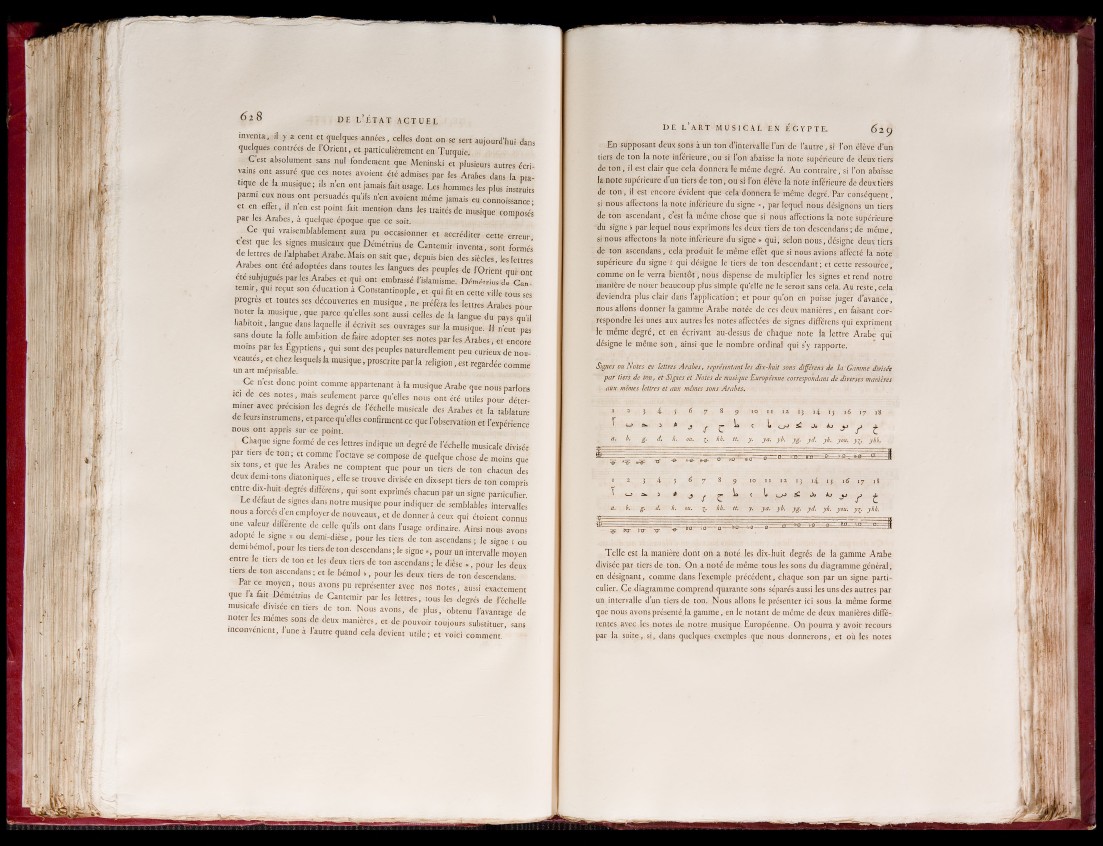
inventa, il y a cent et quelques années, celles dont on se sert aujourd’hui dans
quelques contrées de l’Orient, et particulièrement en Turquie,
C’est absolument sans nul fondement que Meninski et plusieurs autres écrivains
ont assuré que ces notes avoient été admises, par les Arabes dans la pratique
de la musique; ils n’en ont jamais fait usage. Les hommes les plus instruits
parmi eux nous ont persuadés qu’ils n’en avoient même jamais eu connoissance •
et en effet, il n’en est point fait mention dans les traités de musique composés
par les Arabes, à quelque époque que ce soit.
s Ce qui vraisemblablement aura pu occasionner et accréditer cette erreur
cest que les signes musicaux que Démétrius de Cantemir inventa, sont formés
de lettres de l’alphabet Arabe. Mais on sait que, depuis bien des siècles les lettres
Arabes ont été adoptées dans toutes les langues des peuples de l’Orient qui-ont
été subjugués par les Arabes et qui ont embrassé l’islamisme. Démétrius de Cantemir,
qui reçut son éducation à Constantinople, et qui fit en cette ville tous ses
progrès et toutes ses découvertes en musique, ne préféra les lettres Arabes pour
noter la musique, que parce qu’elles sont aussi celles de la langue du pays qu’il
babitoit, langue dans laquelle il écrivit ses ouvrages sur la musique. Il n’eut pas
sans doute la folle ambition de foire adopter ses notes par les Arabes et encore
moins par les Egyptiens, qui sont des peuples naturellement peu curieux de nouveautés,
et chez lesquels la musique, proscrite parla religion, est regardée comme
un art méprisable.
Ce n’est donc point comme appartenant à la musique Arabe que nous parlons
ici de ces notes, mais seulement parce quelles nous ont été utiles pour déterminer
avec précision les degrés de l’échelle musicale des Arabes et la tablature
de leurs mstrumens, et parce qu'elles confirment ce que l’observation et l’expérience
nous ont appris sur ce point.
Chaque signe formé de ces lettres indique un degré de l’échelle musicale divisée
par tiers de ton; et comme l’octave se compose de quelque chose de moins que
six tons, et que les Arabes ne comptent que pour un tiers de ton chacun des
deux demi-tons diatoniques, elle se trouve divisée en dix-sept tiers de ton compris
entre hix-huit degrés différens, qui sont exprimés chacun par un signe particulier.
Le défaut de signes dans notre musique pour indiquer de semblables intervalles
nous a forces d en employer de nouveaux, et de donner à ceux qui étoient connus
une valeur différente de celle qu’ils ont dans l’usage ordinaire. Ainsi nous avons
adopte le signe % ou demi-dièse, pour les tiers de ton ascendans ; le signe t ou
demi-bemol, pour les tiers de ton descendans ; le signe *, pour un intervalle moyen
entre le tiers de ton et les deux tiers de ton ascendans ; le dièse . , pour les deux
tiers de ton ascendans ; et le bémol i., pour les deux tiers de ton descendans.
Par ce moyen, nous avons pu représenter avec nos notes, aussi exactement
que la fait Démétrius de Cantemir par les lettres, tous les degrés de l’échelle
musicale divisée en tiers de ton. Nous avons, de plus, obtenu l’avantage de
noter les memes sons de deux manières, et de pouvoir toujours substituer, sans
inconvénient, l’une à l’autre quand cela devient utile; et voici comment.
En supposant deux sons à un ton d’intervalle l’un de l’autre, si l’on élève d’un
tiers de ton la note inférieure, ou si Ion abaisse la note supérieure de deux tiers
de ton, il est clair que cela donnera le meine degré. Au contraire, si l’on abaisse
la note supeiieure tl un tiers de ton, ou si I on élève la note inférieure de deux tiers
de ton, il est encore évident que cela donnera lé même degré. Par conséquent,
si nous affectons la note inférieure du signe «, par lequel nous désignons un tiers
de ton ascendant, c’est la même chose que si nous affections la note supérieure
du signe i> par lequel nous exprimons les deux tiers de ton descendans ; de même,
si nous affectons la note inférieure du signe . qui, selon nous, désigne deux tiers
de ton ascendans, cela produit le même effet que si nous avions affecté la note
supérieure du signe l qui désigne le tiers de ton descendant ; et cette ressource,
comme on le verra bientôt, nous dispense de multiplier les signes et rend notre
manière de noter beaucoup plus simple qu’elle ne le seroit sans cela. Au reste, cela
deviendra plus clair dans ¡application; et pour qu’on en puisse juger d’avance,
nous allons donner la gamme Arabe notée de ces deux manières, en faisant correspondre
les unes aux autres les notes affectées de signes différens qui expriment
le même degré, et en écrivant au-dessus de chaque note la lettre Arabe qui
désigne le même son, ainsi que le nombre ordinal qui s’y rapporte.
Signes ou Notes en lettres Arabes, représentant les dix-huit sons différens de la Gamme divisée
par tiers de ton, et Signes et Notes de musique Européenne correspondans de diverses manières
. aux mêmes lettres et aux mêmes sons Arabes,
I
îîA 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 ■3 «4 15 16 S I 18
f <_> > £>
/ c L c k < à j
/ t
a. b. S' d. h. ou. 1 hh. tt. y * ya. yb. yg- yd. yh. you. y i- yhh- \
------- ~¿T— rr- - I l
“Hr xf -©- x-e- fit-e- 0 xo
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I 2 13 »4 *5 16 1 7 l 8
. ,T <_> 4> J S £
L c L <
/ t
a. b. 0&. d. h. ou. z- hh. tt. y- ya. yb. yg- yd. yh. you. y i- ybh.
trer txr xr •e- tro ■ a ■ 0 — -VQ—— B — \rQ ■ ■ —. — u— l
Telle est la manière dont on a noté les dix-huit degrés de la gamme Arabe
divisée par tiers de ton. On a noté de même tous les sons du diagramme général,
en désignant, comme dans l’exemple précédent, chaque son par un signe particulier.
Ce diagramme comprend quarante sons séparés aussi les uns des autres par
un intervalle d’un tiers de ton. Nous allons le présenter ici sous la même forme
que nous avons présenté.la gamme, en le notant de même de deux manières différentes
avec les notes de notre musique Européenne. On pourra y avoir recours
par la suite, si, dans quelques exemples que nous donnerons, et où les notes