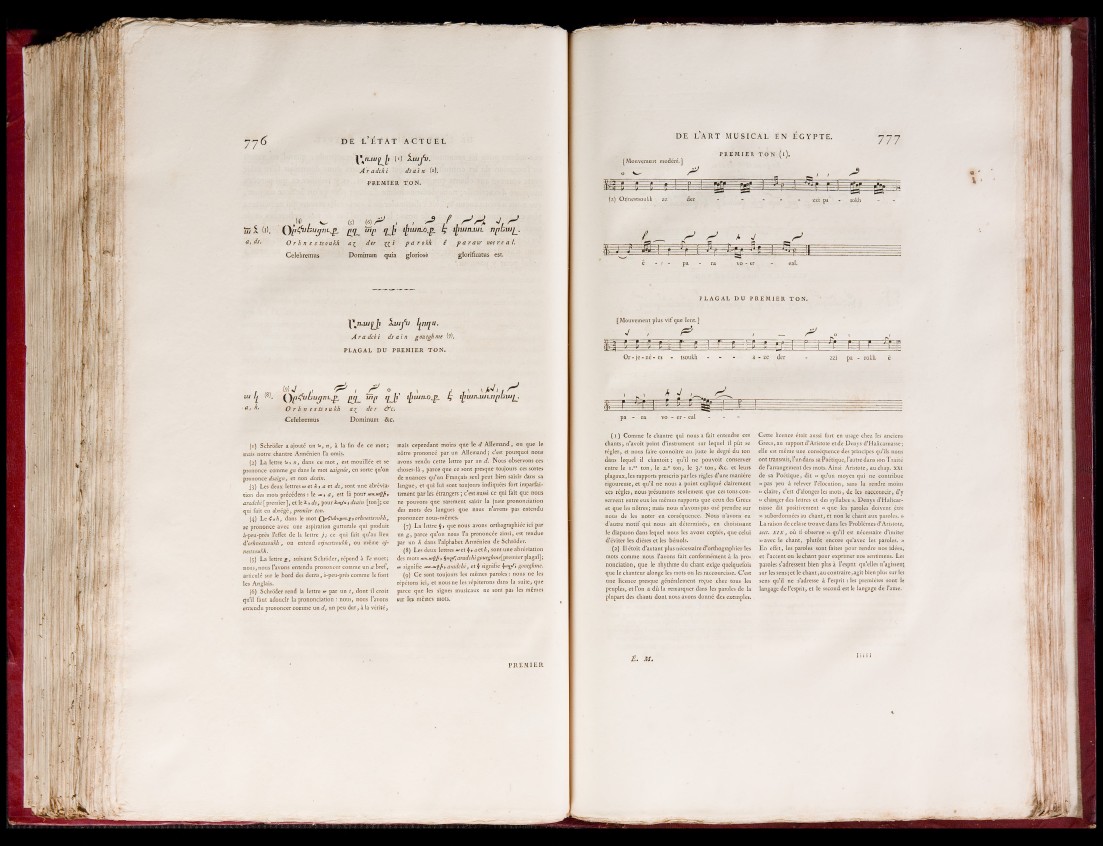
(i) Schröder a ajouté un fc, n, à la fin de ce mot;
mais notre chantre Arménien l’a omis.
{2) La lettre n, dans ce mot, est mouillée et se
prononce comme gn dans le mot saignée, en sorte qu’on
prononce dsaign, et non dsain.
{3) Les deux lettres « et i * a et ds, sont une abréviation
des mots précédens : le ut, a, est là pour oen-uiQjt$
aradchi [premier], et le à » ds, pour à«y‘«» dsain [ton]; ce
qui fait en abrégé, premier ton.
(4î Le<* A, dans le mot »orhnestsoukh,
se prononce avec une aspiration gutturale qui produit
à-peu-près l’effet de la lettre j ; ce qui fait qu’au lieu
d’orhnestsoukh , on entend orjnestsoukh, ou même oj-
nestsoukh.
(5) La lettre j», suivant Schröder, répond à le muet;
nous, nous l’avons entendu prononcer comme un a bref,
articulé sur le bord des dents, à-peu-près comme le font
les Anglais.
(6) Schröder rend la lettre par un t, dont il croit
qu’il faut adoucir la prononciation : nous, nous l’avons
entendu prononcer comme un d, un peu dur, à la vérité,
mais cependant moins que le d Allemand, ou que le
nôtre prononcé par un Allemand ; c’est pourquoi nous
ayons rendu cette lettre par un d. Nous observons ces
choses-là, parce que ce sont presque toujours ces sortes
de nuances qu’un Français seul peut bien saisir dans sa
langue, et qui lui sont toujours indiquées fort imparfaitement
par les étrangers ; c’est aussi ce qui fait que nous
ne pouvons que rarement saisir la juste prononciation
des mots des langues que nous n’avons pas entendu
prononcer nous-mêmes.
(7) La lettre £> que nous avons orthographiée ici par
un g, parce qu’on nous l’a prononcée ainsi, est rendue
par un k dans l'alphabet Arménien de Schrôder.
(8) Les deux lettres « et 4» a et A, sont une abréviation
des mots /««-«/£//, aradchi goué-gA/ne [premier plagal];
ut signifie utu-'u&h aradchi, et k signifie {«'¿/i goueghme.
(o) Ce sont toujours les mêmes paroles : nous ne les
répétons ici, et nous ne les répéterons dans la suite, que
parce que les signes musicaux ne sont pas les mêmes
sur les mêmes mots.
PREMIER
(1) i-UJJCU.
Aradchi dsain (*).
PREMIER TO N .
C a - (4|cî. H (!)w A (i). (ypÇubuijTji-JL p q Ww p È g£f fâè- ijtjw' tuo^ji. MÇ ÊtpÉuiÊruiuMiL . Tipawp.
a,ds. Orhnestsoukh a% der parokh ê par aw noereal.
Celebremus Dominum quia gloriosè glorificatus est.
|\n - tufj i iw ju Ipiqii.
Ara deh i ds a in gou egh me (?).
PLAGAL DU PREMIER TO N .
/ à m m IBIm W ê ë M ê , H
Y 3 nL,& H3 ~ tL Ì ywn-OjL ç* tpwn-WLnpnwjj
1 Orhnestsoukh a^ de r dXc.
Celebremus Dominum &c.
[Mouvement modéré.]
PREMI ER TO N ( i ) .
(2) Orjnestsoukh \ az der zzi pa • rokh
il#
» !
pa - ra vo - er
m
li
P L A G A L DU PREMI ER TON.
[Mouvement plus v if que lent.]'
•j 1 _ W mm ^' 1 r Or - je - né - es - tsoukh a - ze der zzi pa - rokh ê
( 1 ) Comme le chantre qui nous a fait entendre ces
chants, n’avoit point d’instrument sur lequel il pût se
régler, et nous faire connôitre au juste le degré du ton
dans lequel il chantoit ; qu’il ne pouvoit conserver
entre le i.cr ton, le 2.® ton, le 3.® ton, &c. et leurs
plagaux, les rapports prescrits par les règles d’une manière
rigoureuse, et qu’il ne nous a point expliqué clairement
ces règles, nous présumons seulement que ces tons conservent
entre eux les mêmes rapports que ceux des Grecs
et que les nôtres ; mais nous n’avons pas osé prendre sur
nous de les noter en conséquence. Nous n’avons eu
d’autre motif qui nous ait déterminés, en choisissant
le diapason dans lequel nous les avons copiés, que celui
d’éviter les dièses et les bémols.
(2) 11 étoit d’autant plus nécessaire d’orthographier les
mots comme nous l’avons fait conformément à la prononciation,
que le rhythme du chant exige quelquefois
que le chanteur alonge les mots ou les raccourcisse. C ’est
une licence presque généralement reçue chez tous les
peuples, et l’on a dû la remarquer dans les paroles de la
plupart des chants dont nous avons donné des exemples.
Cette licence étoit aussi fort en usage chez les anciens
Grecs, au rapport d’Aristote et de Denys d’H al ica masse;
elle est même une conséquence des principes qu’ils nous
ont transmis, l’un dans sa Poétique, l’autre dans son Traité
de l’arrangement des mots. Ainsi Aristote, au chap. xx 1
de sa Poétique, dit « qu’un moyen qui ne contribue
pas peu à relever l’élocution, sans la rendre moins
3> claire, c’est d’alongerles mots, de les raccourcir, d’y
33 changer des lettres et des syllabes 33. Denys d’Halicar-
nasse dit positivement « que les paroles doivent être
33 subordonnées au chant, et non le chant aux paroles. 33
La raison de cela se trouve dans les Problèmes d’Aristote,
sect. XIX, où il observe « qu’il est nécessaire d’imiter
33 avec le chant, plutôt encore qu’avec les paroles. 33
En effet, les paroles sont faites pour rendre nos idées,
et l’accent ou le chant pour exprimer nos sentimens. Les
paroles s’adressent bien plus à l’esprit qu’elles n’agissen^
sur les sens;et le chant,au contraire,agit bien plus sur les
sens qu’il ne s’adresse à l’esprit : les premières sont le
langage de l’esprit, et le second est le langage de l’ame.
mirai
■ I
l i i i
1 1 1
«
«Miifll
1 1 1 )