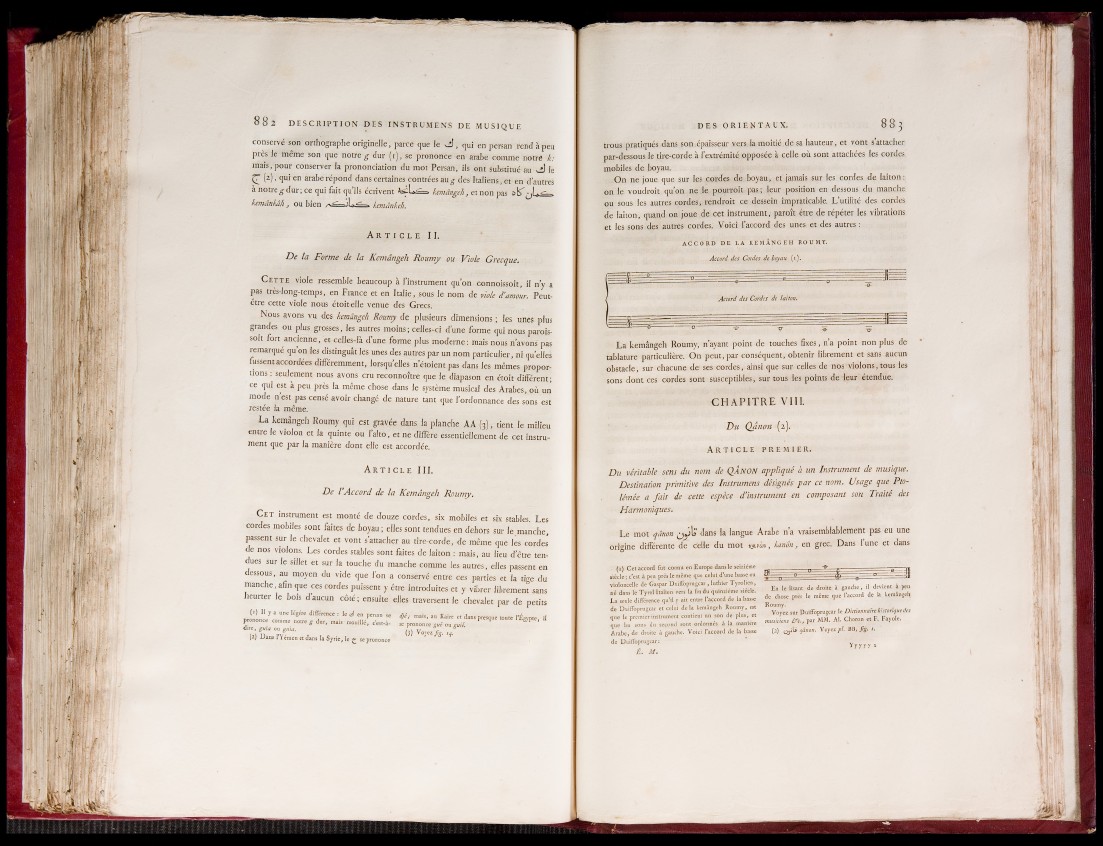
ü
fig ¡IP Ri conservé son orthographe originelle, parce que Je M'\ qui en persan rend à peu
près le même son que notre g dur (1), se prononce en arabe comme notre k:
mais, pour conserver la prononciation du mot Persan, ils ont substitué au J le
^ (2), qui en arabe répond dans certaines contrées au g des Italiens., et en d’autres
à notre g dur ; ce qui fait qu’ils écrivent kemângeh, et non pas e t T .
kemankah , ou bien • il ■ - kcîii/nihih.
A r t i c l e II.
De la Forme de la Kemângeh Roumy ou Viole Grecque.
C e t t e viole ressemble beaucoup à l’instrument qu’on connoissoit, il n’y a
pas très-Iong-temps, en France et en Italie, sous le nom de viole d’amour. Peut-
etre cette viole nous étoit-elle venue des Grecs.
Nous avons vu des kemângeh Roumy de plusieurs dimensions ; les unes plus
grandes ou plus grosses, les autres moins ; celles-ci d’une forme qui nous parois-
soit fort ancienne, et celles-là d’une forme plus moderne: mais nous n’avons pas
remarqué qu’on les distinguât les unes des autres par un nom particulier, ni qu’ellei
fussent accordées différemment, lorsqu’elles n’étoientpas dans les mêmes proportions
: seulement nous avons cru reconnoître que le diapason en étoit différent;
ce qui est à peu près la même chose dans le système musical des Arabes, où un
mode n’est pas censé avoir changé de nature tant que l’ordonnance des sons est
restée la même.
La kemângeh Roumy qui est gravée dans la planche AA (3), tient le milieu
entre le violon et la quinte ou l'alto, et ne diffère essentiellement de cet instrument
que par la maniéré dont elle est accordée.
A r t i c l e III.
De l ’Accord de la Kemângeh Roumy.
C e t instrument est monté de douze cordes, six mobiles et six stables. Les
cordes mobiles sont faites de boyau ; elles sont tendues en dehors sur le manche,
passent sur le chevalet et vont s’attacher au tire-corde, de même que les cordes
de nos violons. Les cordes stables sont faites de laiton : mais, au lieu d'être tendues
sur le sillet et sur la touché du manche comme les autres, elles passent en
dessous, au moyen du vide que l’on a conservé entre ces parties et la tige du
manche afin que ces cordes puissent y être introduites et y vibrer librement sans
heurter Je bois d’aucun côté ; ensuite elles traversent le chevalet par de petits
J l ï l j L r IégêrC di? renCe l£ * « I au Kaire e. dans presque route I’Égypre, il
prononce comme notre g dur, mats mouillé, c’est-à- se prononce gué ou guié. aire, guia ou gnia. , » y . ° b
(2) Dans l’Ycraen et dans la Syrie, le £ se prononce | S‘
trous pratiqués dans son épaisseur vers la moitié.de sa hauteur, et vont s attacher
par-dessous le tire-corde à l’extrémité opposée à celle où sont attachées les cordes
mobiles de boyau.
On ne joue que sur les cordes de boyau, et jamais sur les cordes de laiton:
on le voudroit qu’on ne le pourr.oit pas ; leur position en dessous du manche
ou sous les autres cordes, rendroit ce dessein impraticable. L’utilité des cordes
de laiton, quand on joue de cet instrument, paroît être de répéter les vibrations
et les sons des autres cordes. Voici l’accord des unes et des autres :
A C C O R D DE LA KEMÂNGEH ROUMY.
Accord des Cordes de boyau ( i ).
La kemângeh Roumy, n’ayant point de touches fixes, n a point non plus de
tablature particulière. On peut, par conséquent, obtenir librement et sans aucun
obstacle, sur chacune de ses cordes, ainsi que sur celles de nos violons, tous les
sons dont ces cordes sont susceptibles, sur tous les points de leur étendue.
C H A P I T R E VIII .
Du Qânon (2).
A r t i c l e p r e m i e r .
Du véritable sens du nom de QÀNON appliqué à un Instrument de musique.
Destination primitive des Instrumens désignés par ce nom. Usage que Pto-
lémêe a fait de cette espèce d’instrument en composant son Traité des
Harmoniques.
Le mot qânon dans la langue Arabe n’a vraisemblablement pas eu une
origine différente de celle du mot «ya«, kanôn, en grec. Dans 1 une et dans
h ) Cet accord fut connu en Europe dans le seizième
siècle ; c’est à peu près le même que celui d’une basse ou
violoncelle de Gaspar Duiffoprugcar , luthier Tyrolien,
né dans le Tyrol Italien vers la fin du quinzième siècle.
La seule différence qu’il y ait entre l’accord de la basse
de Duiffoprugcar et celui delà kemângeh Roumy, est
que le premier instrument contient un son de plus, et
que les sons du second sont ordonnes a la maniéré
Arabe, de droite à gauche. Voici l’accord de la basse
de Duiffoprugcar:
É. M.
En le lisant de droite à gauche, il devient à peu
de chose près le même que l’accord de la kemângeh
Roumy.
Voyez sur Duiffoprugcar \t Dictionnaire historique des
musiciens ¿Tir., par MM. Al. Choron et F. Fayole.
(2) qânon. Voyez p l . BB, f ig . r.
Y y y y y 2,