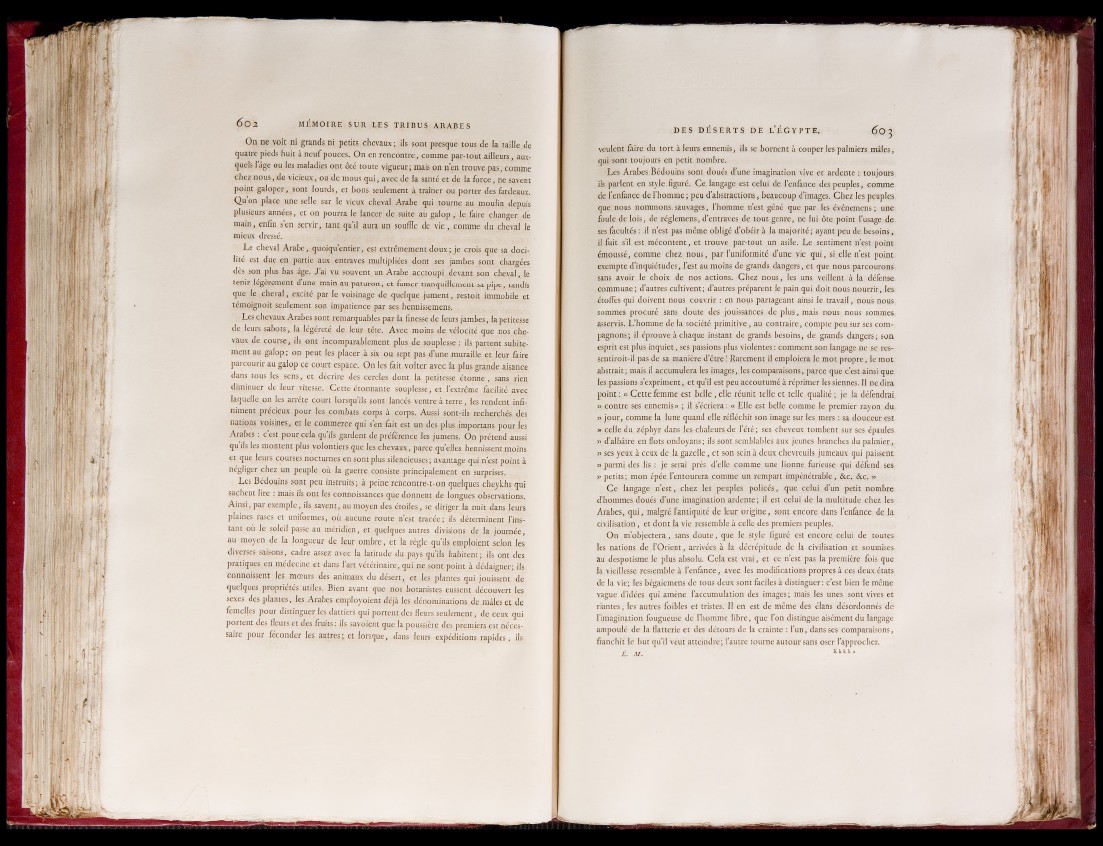
On ne Voit ni grands ni petits chevaux; ils sont presque tous de la taille de
quatre pieds huit à neuf pouces. On en rencontre, comme par-tout ailleurs, auxquels
1 âge ou les maladies ont ôté toute vigueur; mais on n’en trouve pas; comme
chez nous, de vicieux, ou de mous qui, avec de la santé et de la force, ne savent
point galoper, sont lourds, et bons seulement à traîner ou porter des fardeaux.
Quon place une selle sur le vieux cheval Arabe qui tourne au moulin depuis
plusieurs années, et on pourra le lancer de suite au galop , le faire changer dé
main, enfin s’en servir, tant qu’il aura un souffle de vie , comme du cheval le
mieux dressé.
Le cheval Arabe, quoiqu’entier, est extrêmement doux; je crois que sa docilité
est due en partie aux entraves multipliées dont ses jambes sont chargées
des, son plus bas âge. Jai vu souvent un Arabe accroupi devant son cheval, le
tenir légèrement d’une main au paturon, et fumer tranquillement sa pipe, tandis
que le cheval, excité par le voisinage de quelque jument, restoit immobile et
témoignoit seulement son impatience par ses hennissemens.
Les chevaux Arabes sont remarquables par la finesse de leurs jambes, la petitesse
de leurs sabots, la légéreté de leur tête. Avec moins de vélocité que nos chevaux
de course, ils ont incomparablement plus de souplesse: ils partent subitement
au galop ; on peut les placer à six ou sept pas d’une muraille et leur faire
parcourir au galop ce court espace. On les fait volter avec la plus grande aisance
dans tous les sens, et décrire des cercles dont la petitesse étonne , sans rien
diminuer de leur vitesse. Cette étonnante souplesse, et l’extrême facilité avec
laquelle on les arrête court lorsqu’ils sont lancés ventre à terre, les rendent infiniment
précieux pour les combats corps a corps. Aussi sont-ils recherchés des
nations voisines, et le commerce qui s’en fait est un des plus ¡mportans pour les
Arabes : cest pour cela qu’ils gardent de préférence les jumens. On prétend aussi
qu ils les montent plus volontiers que les chevaux, parce qu’elles hennissent moins
et que leurs courses nocturnes en sont plus silencieuses; avantage qui n’est point à
négliger chez un peuple où la guerre consiste principalement en surprises.
Les Bédouins sont peu instruits ; à peine rencontre-t-on quelques cheykhs qui
sachent lire . mais ils ont les connoissances que donnent de longues observations.
Ainsi, par exemple, ils savent, au moyen des étoiles, se diriger la nuit dans leurs
plaines rases et uniformes, ou aucune route n’est tracée; ils déterminent l’ins-
ïant ou le soleil passe au méridien, et quelques autres divisions de la journée,
au moyen de la longueur de leur ombre, et la règle qu’ils emploient selon les
diveises saisons, cadre assez avec la latitude du pays qu’ils habitent; ils ont des
pratiques en médecine et dans l’art vétérinaire, qui ne sont point à dédaigner; ils
connoissent les moeurs des animaux du désert, et les plantes qui jouissent de
quelques propriétés utiles. Bien avant que nos botanistes eussent découvert les
sexes des plantes, les Arabes employoient déjà les dénominations de mâles et de
femelles pour distinguer les dattiers qui portent des fleurs seulement, de ceux qui
portent des fleurs et des fruits: ils savoient que la poussière des premiers est nécessaire
pour féconder les autres; et lorsque, dans leurs expéditions rapides, ils
veulent faire du tort à leurs ennemis, ils se bornent à couper les palmiers mâles,
qui sont toujours en petit nombre.
Les Arabes Bédouins sont doués d’une imagination vive et ardente : toujours
ils parlent en style figuré. Ce langage est celui de l’enfance des peuples, comme
de l’enfânee de l’homme; peu d’abstractions, beaucoup d’images. Chez les peuples
que nous nommons.sauvages, l’homme n’est gêné que par les événemens; une
foule de lois, de réglemens, d’entraves de tout genre, ne lui ôte point l’usage de
ses facultés : il n’est pas même obligé d’obéir à la majorité ; ayant peu de besoins,
il fuit s’il est mécontent, et trouve par-tout un asile. Le sentiment n’est point
émoussé, comme chez nous, par l’uniformité d’une vie qui, si elle n’est point
exempte d’inquiétudes, l’est au moins de grands dangers, et que nous parcourons
sans avoir le choix de nos actions. Chez nous, les uns veillent à la défense
commune ; d’autres cultivent ; d’autres préparent le pain qui doit nous nourrir, les
étoffes qui doivent nous couvrir : en nous partageant ainsi le travail, nous nous
sommes procuré sans doute des jouissances de plus, mais nous nous sommes
asservis. L’homme de la société primitive, au contraire, compte peu sur ses compagnons;
il éprouve à chaque instant de grands besoins, de grands dangers; son
esprit est plus inquiet, ses passions plus violentes : comment son langage ne se res-
sentiroit-il pas de sa manière d’être î Rarement il emploiera le mot propre, le mot
abstrait; mais il accumulera les images, les comparaisons, parce que c’est ainsi que
les passions s’expriment, et qu’il est peu accoutumé à réprimer les siennes. Il ne dira
point : « Cette femme est belle , elle réunit telle et telle qualité ; je la défendrai
» contre ses ennemis» ; il s’écriera : « Elle est belle comme le premier rayon du
» jour, comme la lune quand elle réfléchit son image sur les mers : sa douceur est
» celle du zéphyr dans les chaleurs de l’été; ses cheveux tombent sur ses épaules,
» d’albâtre en flots ondoyans; ils sont semblables aux jeunes branches du palmier,
» ses yeux à ceux de la gazelle, et son sein à deux chevreuils jumeaux qui paissent
» parmi des lis : je serai près d’elle comme une lionne furieuse qui défend ses
» petits; mon épée l’entourera comme un rempart impénétrable, &c. &c. »
Ce langage n’est, chez les peuples policés, que celui d’un petit nombre
d’hommes doués d’une imagination ardente; il est celui de la multitude chez les
Arabes, qui, malgré l’antiquité de leur origine, sont encore dans l’enfance de la
civilisation, et dont la vie ressemble à celle des premiers peuples.
On m’objectera , sans doute, que le style figuré est encore celui de toutes
les nations de l’Orient, arrivées à la décrépitude de la civilisation et soumises
au despotisme le plus absolu. Cela est vrai, et ce n’est pas la première fois que
la vieillesse ressemble à l’enfànce, avec les modifications propres à ces deux états
de la vie; les bégaiemens de tous deux sont faciles à distinguer: c’est bien le même
vague d’idées qui amène l’accumulation des images ; mais les unes sont vives et
riantes, les autres foibles et tristes. Il en est de même des élans désordonnés de
l’imagination fougueuse de l’homme libre, que l’on distingue aisément du langage
ampoulé de la flatterie et des détours de la crainte : l’un, dans ses comparaisons,
franchit le but qu’il veut atteindre; l’autre tourne autour sans oser l’approcher.
É . M K t k t a