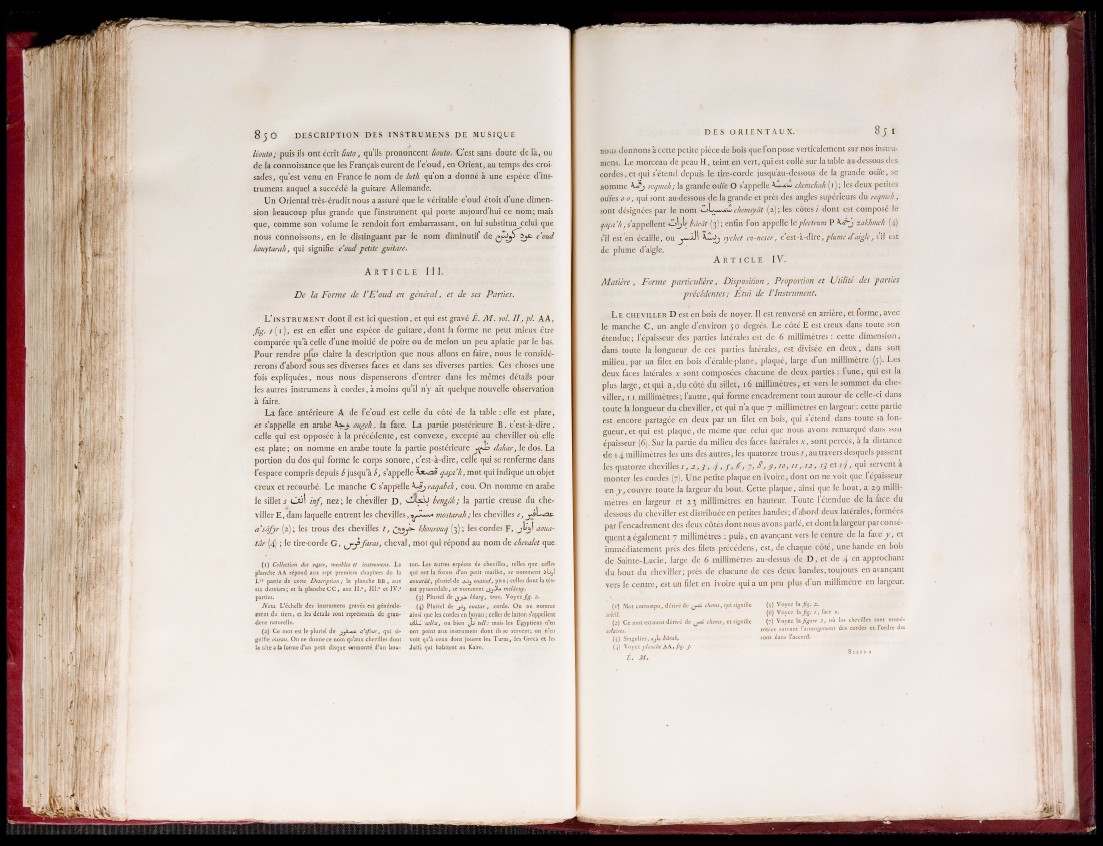
léouto; puis ils ont écrit Uuto, qu’ils prononcent liouto. C’est sans doute de là, ou
de la connoissance que les Français eurentde l’e’oud, en Orient, au temps des croisades,
qu’est venu en France le nom de luth qu’on a donné à une espèce d’instrument
auquel a succédé la guitare Allemande.
Un Oriental très-érudit nous a assuré que le véritable e’oud étoit d’une dimension
beaucoup plus grande que l’instrument qui porte aujourd’hui ce nom; mais
que, comme son volume le rendoit fort embarrassant, on lui substitua celui que
nous connoissons, en le distinguant par le nom diminutif de e’oud
kouytarah, qui signifie e’oud petite guitare.
A r t i c l e III.
De la Forme de VE’oud en général, et de ses Parties.
L ’ in s t r um e n t dont il est ici question, et qui est gravé E . M . vol. I I , pl. A A ,
fig. 1 ( 1 ), est en effet une espèce de guitare, dont la forme ne peut mieux être
comparée qu’à celle d’une moitié de poire ou de melon un peu aplatie par le bas.
Pour rendre plus claire la description que nous allons en faire, nous le considérerons
d’abord sous ses diverses faces et dans ses diverses parties. Ces choses une
fois expliquées, nous nous dispenserons d’entrer dans les mêmes détails pour
fes autres instrumens à cordes, à moins qu’il n’y ait quelque nouvelle observation
à faire.
La face antérieure A de l’e’oud est celle du côté de la table : elle est plate,
et s’appelle en arabe ougeh, la face. La partie postérieure B , c’est-à-dire ,
celle qui est opposée à la précédente, est convexe, excepté au cheviller où elle
est plate ; on nomme en arabe toute la partie postérieure dahar, le dos. La
portion du dos qui forme le corps sonore, c’est-à-dire, celle qui se renferme dans
l’espace compris depuis b jusqu’à l , s’appelle qaça’h, mot qui indique un objet
creux et recourbé. Le manche C s’appelle raqabeh, cou. On nomme en arabe
le sillets Oül inf, nez; le cheviller D, bertgâk; la partie creuse du cheviller
E, dans laquelle entrent les chevilles, mostarah ; les chevilles e,
a’sâfyr (2); les trous des chevilles t , Cyyj*- khourouq (3); les cordes F, aoua-
târ (4) ; le tire-corde G, ^yÿforas, cheval, mot qui répond au nom de chevalet que
(1) Collection des vqpes, meubles et instrumens. La
planche AA répond aux sept premiers chapitres de la
l . re partie de cette Description ; la planche BB , aux
six derniers; et la planche C C , aux II.*, III.® et IV.®
parties.
Nota. L’échelle des instrumens gravés est généralement
du tiers, et les détails sont représentés de grandeur
naturelle.
(2) Ce mot est le pluriel de jjyum a'sfbur, qui signifie
oiseau. On ne donne ce nom qu’aux chevilles dont
la tête a la forme d’un petit disque surmonté d’un bouton.
Les autres espèces de chevilles, telles que celles
qui ont la forme d’un petit maillet, se nomment ib j l
aouatâd, pluriel de o-jj ouatad, pieu ; celles dont la tête
est pyramidale, se nomment melâouy.
(3) Pluriel de ÿjd* hharq, trou. Voyez fig. 2.
(4) Pluriel de ouatar, corde. On ne nomme
ainsi que les cordes en boyau ; celles de laiton s’appellent
t£ILC 'salha, ou bien Jj tell : mais les Egyptiens n’en
ont point aux instrumens dont ils se servent; on n’en
voit qu’à ceux dont jouent les Turcs, les Grecs et les
Juifs qui habitent au Kaire..
I f i i ! f i t i ï 1 M'ii'l-iïnous
donnons a cette petite pièce de bois que l’on pose verticalement sur nos instrumens.
Le morceau de peau H , teint en vert, qui est collé sur la table au-dessous des
cordes, et qui s’étend depuis le tire-corde jusqu’au-dessous de la grande ouïe, se
nomme reqmeh; la grande ouïe O s’appelle AL<uj chemchah (i) ; les deux petites
ouïes 0 0, qui sont au-dessous de la grande et près des angles supérieurs du reqmeh,
sont désignées par le nom >-jL— chemsyât (2) ; les côtes i dont est composé le
qo(a’h, s’appellent dbjjl bârât (3); enfin l’on appelle 1 tplectmm P Kè-j zakhrtieh (4)
s’il est en écaille, ou àibJj rychet cn-ncser, c’est-à-dire, plume daigle, s il est
dé plume d’aigle.
A r t i c l e IV.
Matière, Forme particulière, Disposition, Proportion et Utilité des parties
précédentes ; Etui de l ’Instrument.
L e c h e v i l l e r D est en bois de noyer. Il est renversé en arrière, et forme, avec
le manche C , un angle d’environ 50 degrés. Le côté E est creux dans toute son
étendue; l’épaisseur des parties latérales est de. 6 millimètres : cette dimension,
dans toute la longueur de ces parties latérales, est divisée en deux, dans son
milieu, par un filet en bois d’érable-plane, plaqué, large d’un millimètre (5). Les
deux faces latérales x sont composées chacune de deux parties : lune, qui est la
plus large, et qui a, du côté du sillet, 16 millimètres, et vers le sommet du cheviller,
11 millimètres; l’autre, qui forme encadrement tout autour de celle-ci dans
toute la longueur du cheviller, et qui n’a que 7 millimètres en largeur: cette partie
est encore partagée en deux par un filet en bois, qui setend dans toute sa longueur,
et qui est plaqué, de même que celui que nous avons remarqué dans son
épaisseur (6). Sur la partie du milieu des faces latérales x, sont percés, à la distance
de 14 millimètres les uns des autres, les quatorze trous t, au travers desquels passent
les quatorze chevilles 1, 2, y , 4 > J > 6> 7> & 1 S> I0>11 > 12 > !3 et r/i > S11* servent a
monter les cordes (7). Une petite plaque en ivoire, dont on ne voit que l’épaisseur
en y , couvre toute la largeur du bout. Cette plaque, ainsi que le bout, a 29 millimètres
en largeur et 23 millimètres en hauteur. Toute letendue de la face du
dessous du cheviller est distribuée en petites bandes ; d abord deux- latérales, formées
par l’encadrement des deux côtés dont nous avons parle, et dont la largeur pai conséquent
a également 7 millimètres : puis, en avançant vers le centre de la face y , et
immédiatement près des filets précédens, est, de chaque cote, une bande en bois
de Sainte-Lucie, large de 6 millimètres au-dessus de D, et de 4 en approchant
du bout du cheviller; près de chacune de ces deux bandes, toujours en avançant
vers le centre, est un filet en ivoire qui a un peu plus d’un millimètre en largeur.
(1) Mot corrompu, dérivé de j-tS chenu, qui signifie (5) Voyez la fig. 2.
soleil. (6) Voyez la fig. 1 , face x.
(2) Ce mot est aussi dérivé de jutti clients, et signifie (7) Voyez la figure 2, où les chevilles sont numesolaires.
rotées suivant l’arrangement des cordes et-l’ordre des
(3) Singulier, ojb bârah, sons dans 1 accord.
(4) V oyez planche A A , fig- J