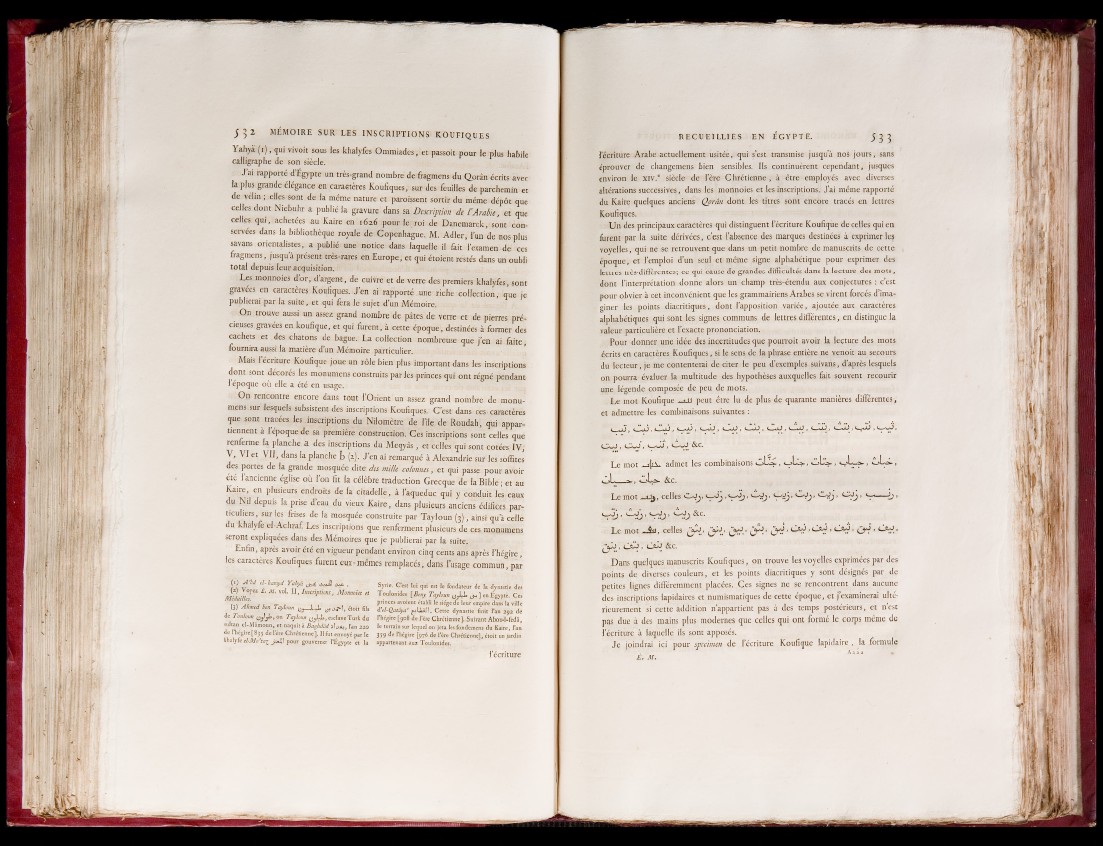
Yahyâ (i), qui vivoit sous les khalyfes Ommiades, et passoit pour le plus habile
calligraphe de son siècle.
J’ai rapporté d’Égypte un très-grand nombre de fragmens du Qorân écrits avec
la plus grande élégance en caractères Koufiques, sur des feuilles de parchemin et
de vélin ; elles sont de la même nature et paroissent sortir du même dépôt que
celles dont Niebuhr a publié la gravure dans sa Description de l ’Arabie, et que
celles qui, achetées au Kaire en 1626 pour le roi de Danemarck,sont conservées
dans la bibliothèque royale de Copenhague. M. Adler, l’un de nos plus
savans orientalistes, a publié une notice dans laquelle il fait l’examen de ces
fragmens, jusqu’à présent très-rares en Europe, et qui étoient restés dans un oubli
total depuis leur acquisition.
Les monnoies d’or, d’argent, de cuivre et de verre des premiers khalyfes, sont
gravées en caractères Koufiques. J’en ai rapporté une riche collection, que je
publierai par la suite, et qui fera le sujet d’un Mémoire.
On trouve aussi un assez grand nombre de pâtes de verre et de pierres précieuses
gravées en kouftque, et qui furent, à cette époque, destinées à former des
cachets et des chatons de bague. La collection nombreuse que j’en ai faite,
fournira aussi la matière dun Mémoire particulier.
Mais l’écriture Koufique joue un rôle bien plus important dans les inscriptions
dont sont décorés les monumens construits par les princes qui ont régné pendant
l’époque où elle a été en usage.
On rencontre encore dans tout l’Orient un assez grand nombre de monu-
mens sur lesquels subsistent des inscriptions Koufiques. C’est dans ces-caractères
que sont tracées les inscriptions du Nilomètre de l’île de Roudah, qui appartiennent
à l’époque de sa première construction. Ces inscriptions sont celles que
rçnferme la planche a des inscriptions du Meqyâs , et celles qui sont cotées IV,
V, VI et VII, dans la planche b (2). J’en ai remarqué à Alexandrie sur les soffites
des portes de la grande mosquée dite des mille colonnes, et qui passe pour avoir
été l’ancienne église où l’on fit la célèbre traduction Grecque de la Bible ; et au
Kaire, en plusieurs endroits de la citadelle, à l’aqueduc qui y conduit les eaux
du Nd depuis la prise d’eau du vieux Kaire, dans plusieurs anciens édifices particuliers,
sur les frises de la mosquée construite par Tayloun (3), ainsi qu’à celle
du khalyfè el-Achraf. Les inscriptions que renferment plusieurs de ces monumens
seront expliquées dans des Mémoires que je publierai par la suite.
Enfin, après avoir été en vigueur pendant environ cinq cents ans après l’hégire,
les caractères Koufiques furent eux-mêmes remplacés, dans l’usage commun, par
( 0 4 td el-hamyd Yahyâ ^-2 *JL ^ . Syrie. C e « lui qui e« le fondateur de la dynastie des
Médaillé! “ ^ imcripùom, Monnaies et Toulonides [Beny Tayloun 0 jI ... ,. , , „ , , princes avoient établi le siège de lxeu r^ em ]p eirne Édgaynps tlba. vCileles (3) Ahmed ben Tayloun tu — L X ¡¿ .v f'l, étoit fils d’el-Qatâya' çslLaJI. Cette dynastie finit l’an 292 de
de Touloun aJJ=, ou Tayloun (jjL L , csciaveTurk du l’hégire [908 de I’ère Chrétienne], Suivant Abou-I-fedâ,
isau ltla’hné geilr-eM [8â3m^5o duen ,l^’èerte nCahqruéitti eàn Bnaeg],h dIIâ fdu ts teonêvjo,y lé’a pna 2r2 le0 3le5 9te drrea iln’h séugrir lee q[9u7e6l odne jle’ètare l eCsh froéntdieenmneen]s, édtuo itK uanir eja, rfdainn khalyfc el-Mo'ta^ Jx»II pour gouverner l’Egypte et la appartenant aux Toulonides.
l’écriture Arabe actuellement usitée, qui s’est transmise jusqu’à nos jours, sans
éprouver de changemens bien sensibles. Ils continuèrent cependant, jusques
environ le xiv.' siècle de l’ère Chrétienne, à être employés avec diverses
altérations successives, dans les monnoies et les inscriptions. J’ai même rapporté
du Kaire quelques anciens Qorân dont les titres sont encore tracés en lettres
Koufiques.
Un des principaux caractères qui distinguent l’écriture Koufique de celles qui en
furent par la suite dérivées, c’est l’absence des marques destinées à exprimer les
voyelles, qui ne se retrouvent que dans un petit nombre de manuscrits de cette
époque, et l’emploi d’un seul et même signe alphabétique pour exprimer des
lettres très-différentes; ce qui cause de grandes difficultés dans la lecture des mots,
dont l’interprétation donne alors un champ très-étendu aux conjectures : c’est
pour obvier à cet inconvénient que les grammairiens Arabes se virent forcés d’imaginer
les points diacritiques, dont l’apposition variée, ajoutée aux caractères
alphabétiques qui sont les signes communs de lettres différentes, en distingue la
valeur particulière et l’exacte prononciation.
Pour donner une idée des incertitudes que pourroit avoir la lecture des mots
écrits en caractères Koufiques, si le sens de la phrase entière ne venoit au secours
du lecteur, je me contenterai de citer le peu d’exemples suivans, d’après lesquels
on pourra évaluer la multitude des hypothèses auxquelles fait souvent recourir
une légende composée de peu de mots.
Le mot Koufique ■ peut être lu de plus de quarante manières différentes;
et admettre les combinaisons suivantes :
I j , 1 " r i , *■ „ r i , ( j j , l_~L> , JL> , < , j j , S - L u , < JL J , ,
(JXJ , GuJ , , CvjJ &C.
Le mot -«[< v admet les combinaisons , <_>Lwa-, ««juâ.,
- -1. -w. ,_,L* &c.
Le mot -jJj, celles C-Uj, <— , c-'J;. cLjj, v-’Jj. ----J j,
0 J3 , , o J j , LOj &c.
Le mot ■ As, celles ( ÿ i ’ <3H’ ÿ l ’ ’ *■"*£* ’ ’
L.”/v J, CsL• , L j û )•• &c.
Dans quelques manuscrits Koufiques, on trouve les voyelles exprimées par des
points de diverses couleurs, et les points diacritiques y sont désignés par de
petites lignes différemment placées. Ces signes ne se rencontrent dans aucune
des inscriptions lapidaires et numismatiques de cette époque, et j’examinerai ultérieurement
si cette addition n’appartient pas à des temps postérieurs, et n’est
pas due à des mains plus modernes que celles qui ont formé le corps meme de
l’écriture à laquelle ils sont apposés.
Je joindrai ici pour specimen de l’écriture Koufique lapidaire , la formule
' t ’ ‘ ,j A a a a » m m.