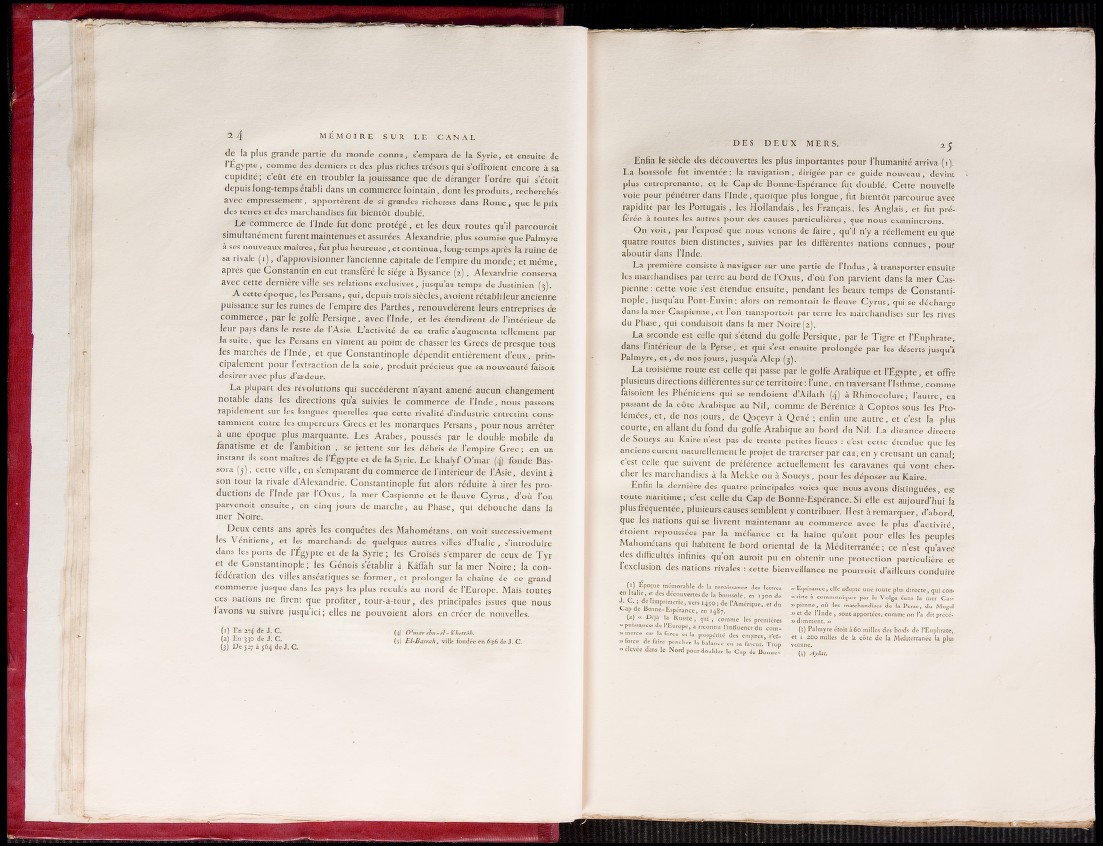
tle la plus grande partie du monde connu, s’empara de la Syrie, et ensuite de 1 Egypte, comme des derniers et des plus riches trésors qui s’offroient encore à sa
cupidité; c’eût été en troubler la jouissance que de déranger l’ordre qui s’étoit
depuis long-temps établi dans un commerce lointain, dont les produits, recherchés
avec empressement, apportèrent de si grandes richesses dans Rome, que le prix
des terres et des marchandises fut bientôt doublé.
Le commerce de llnde fut donc protégé, et les deux routes qu’il parcourait
simultanément furent maintenues et assurées. Alexandrie, plus soumise que Palmyre
à ses nouveaux maîtres, fut plus heureuse, et continua, long-temps après la ruine de
sa rivale (i), d’approvisionner l’ancienne capitale de l’empire du monde; et même,
après que Constantin en eut transféré le siège à Bysance (2), Alexandrie conserva
avec cette dernière ville ses relations exclusives, jusqu’au temps de Justinien (3).
A cette epoque, les Persans, qui, depuis trois siècles, avoient rétabli leur ancienne
puissance sur les ruines de l’empire des Partîtes, renouvelèrent leurs entreprises de
commerce, par le golfe Persique, avec l’Inde, et les étendirent de l’intérieur de
leur pays dans le reste de 1 Asie. L’activité de ce trafic s’augmenta tellement par
la suite, que les Persans en vinrent au point de chasser les Grecs de presque tous
les marches de lln de , et que Constantinople dépendit entièrement d’eux, principalement
pour I extraction de la soie, produit précieux que sa nouveauté fàisoit
desirer avec plus d’ardeur.
La plupart des révolutions qui succédèrent n’ayant amené aucun changement
notable dans les directions qu’a suivies le commerce de l’Inde, nous passons
rapidement sur les longues querelles que cette rivalité d’industrie entretint constamment
entre les empereurs Grecs et les monarques Persans, pour nous arrêter
à une époque plus marquante. Les Arabes, poussés par le double mobile du
fanatisme et de 1 ambition , se jettent sur les débris de l’empire Grec ; en un
instant ils sont maîtres de l’Egypte et de la Syrie. Le khalyf O ’mar (4) fonde Bas-
so ra (5) ; cette ville, en s emparant du commerce de l’intérieur de l’Asie, devint à
son tour la rivale d’Alexandrie. Constantinople fut alors réduite à tirer les productions
de 1 Inde par 1 Oxus, la mer Caspienne et le fleuve Cyrus, d’où l’on
parvenoit ensuite, en cinq jours démarché, au Phase, qui débouche dans la
mer Noire.
Deux cents ans après les conquêtes des Mahométans, on voit successivement
les Vénitiens, et les marchands de quelques autres villes d’Italie, s’introduire
dans les ports de l’Egypte et de la Syrie ; les Croisés s’emparer de ceux de Tyr
et de Constantinople; les Génois s’établir à Kâffkh sur la mer Noire; la confédération
des villes anséatiques se former, et prolonger la chaîne de ce grand
commerce jusque dans les pays les plus reculés au nord de l’Europe. Mais toutes
ces nations ne firent que profiter, tour-à-tour, des principales issues que nous
lavons vu suivre jusqu’ici; elles ne pouvoient alors en créer de nouvelles.
(1) En 274 de J. C .
(2) En 330 de J. C .
(3) D e 527 à 564 de J. C .
(4) O ’mar ebn- e l - Khettâb.
(5) El-Basrah, v ille fondée en 636 de J. C.
Enfin le siècle des découvertes les plus importantes pour l’humanité arriva (1).
La boussole fut inventée; la navigation, dirigée par ce guide nouveau, devint
plus entreprenante, et le Cap de Bonne-Espérance fut doublé. Cette nouvelle
voie pour pénétrer dans lln d e , quoique plus longue, fut bientôt parcourue avec
rapidité par les Portugais, les Hollandais, les Français, les Anglais, et fut préférée
à toutes les autres pour des causes particulières, que nous examinerons.
On voit, par l’exposé que nous venons de faire, qu’il n’y a réellement eu que
quatre routes bien distinctes, suivies par les différentes nations connues, pour
aboutir dans l’Inde.
La première consiste a naviguer sur une partie de l’inclus, à transporter ensuite
les marchandises par terre au bord de l’O xus, d’où l’on parvient dans la mer Caspienne
: cette voie s’est étendue ensuite, pendant les beaux temps de Constantinople,
jusqu’au Pont-Euxin ; alors on remontoit le fleuve Cyrus, qui se décharge
dans la mer Caspienne, et l’on transportoit par terre les marchandises sur les rives
du Phase, qui conduisoit dans la mer Noire (2).
La seconde est celle qui s’étend du golfe Persique, par le Tigre et l’Euphrate,
dans l’intérieur de la Perse, et qui s’est ensuite prolongée par les déserts jusqu’à
Palmyre, e t , de nos jours, jusqu’à Alep (3).
La troisième route est celle qui passe par le golfe Arabique et l’Egypte, et offre
plusieurs directions différentes sur ce territoire : l’une, en traversant l’Isthme, comme
faisoient les Phéniciens qui se rendoient d’Ailath (4) à Rhinocolure; l’autre, en
passant de la cote Arabique au Nil, comme de Bérénice à Coptos sous les Pto-
lémées, et, de nos jours, de Qoçeyr à Qené ; enfin une autre, et c’est la plus
courte, en allant du fond du golfe Arabique au bord du Nil. La distance directe
de Soueys au Kaire nest pas de trente petites lieues : c’est cette étendue que les
anciens eurent naturellement le projet de traverser par eau, en y creusant un canal;
cest celle que suivent de préférence actuellement les caravanes qui vont chercher
les marchandises à la Mekke ou à Soueys, pour les déposer au Kaire.
Enfin la dernière des quatre principales voies que nous avons distinguées, est
toute maritime; c’est celle du Cap de Bonne-Espérance. Si elle est aujourd’hui la
pi us fréquentée, plusieurs causes semblent y contribuer. II est àremarquer, d’abord,
que les nations qui se livrent maintenant au commerce avec le plus d’activité,
étoient repoussées par la méfiance et la haine qu’ont pour elles les peuples
Mahométans qui habitent le bord oriental de la Méditerranée ; ce n’est qu’avec
des difficultés infinies qu’on aurait pu en obtenir une protection particulière et
1 exclusion des nations rivales : cette bienveillance ne pourrait d’ailleurs conduire
en h l l ^ T d ' e r d " ’ 0raWe ^ 1 7 “ “ ? “ Ü IehreS ” EsPéran“ > ^ ^ o p .e une route plus directe, qui con-
en lu i , r et_des découvertes de la boussole, en .300 de »siste à communiquer par le V olga dans la mer Cas-
C in 'd » n ImPr™ tn e , vers 1450; de l'Amerique, et du » p ien n e , où les marchandises de la Perse, du M ogol
, , , TV'11'5 1 T “ - " ’ en » e t de l’In d e , sont apportées, comme on l’a dit précc-
' 7 “ ,a “ Kussie > qui . comme les premières » demment. »
É B j B W \ 1rEur0pe’f * r0COnnu ñnfluen« d u corn- (3) Palmyre étoit à 60 milles des bords de l’Euphrate,
, , , IOrce " la, Pr°spérité des empires, s’ef- et à 200 milles de la côte de la Méditerranée la plus
» force de faire pencher la balance en sa faveur. Trop voisine.
» elevee dans le Nord pour doubler le Cap de Bonne- (4) Aylat.