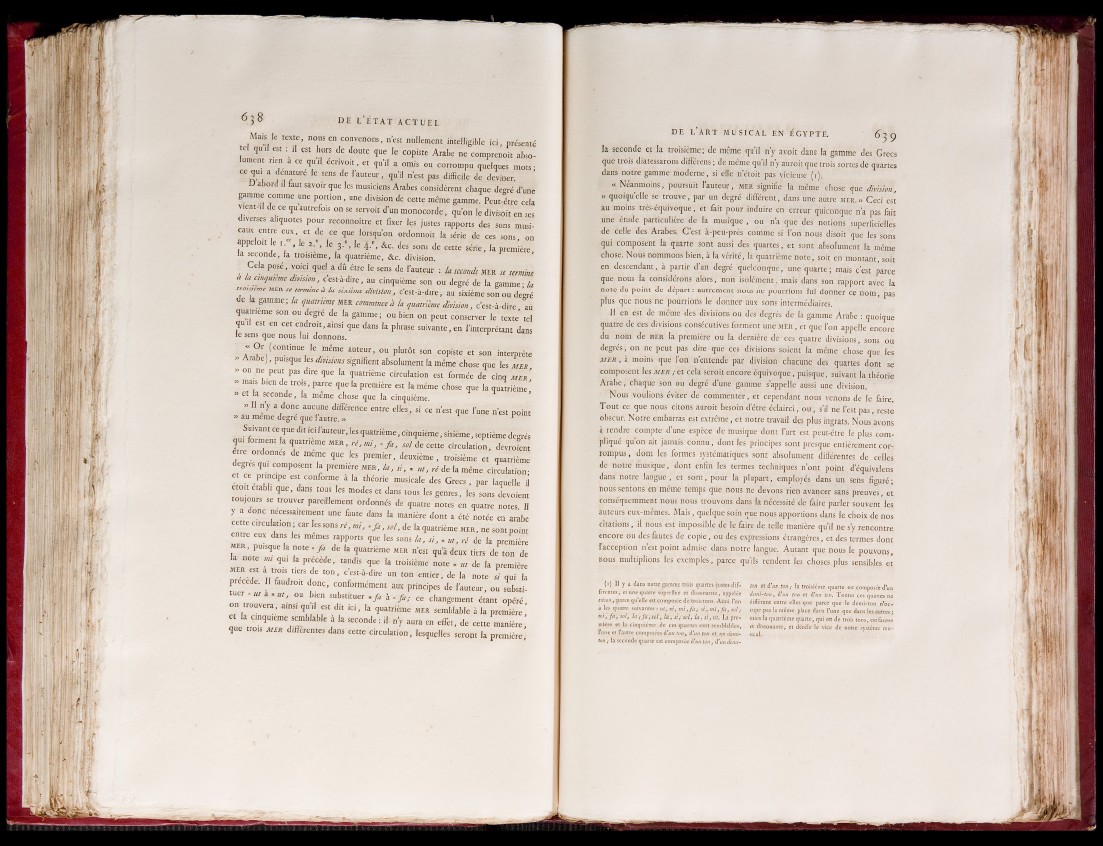
Mais le texte, nous en convenons, n’est nullement intelligible ici, présenté
tel quii est : i l est hors de doute que le copiste Arabe ne comprenoit absolument
rien a ce qud écrivait, et qu’il a omis ou corrompu quelques mots-
C€^ “. a j » g le sens de lauteur . n’est pas difficile de deviner.
0rd 1faut savoir que ,es musiciens Arabes considèrent chaque degré d’une
gamme comme une portion, une division de cette même gamme. Peut-être cela
vient-il de ce quautrefois on se servoit d’un monocorde, qu’on le divisoit en ses
diverses ahquotes pour reconnoître et fixer les justes rapports des sons musicaux
entre eux, et de ce que lorsqu’on ordonnoit la série de ces sons on
r 01t; ’ i ’ le -2'C’ Je,3' ' ’ 16 W Ì &C' des sons de cette série> Ja première,
la seconde, la troisième, la quatrième, &c. division.
f .C eìa P ° f é ’ voici qUel a dÛ étre ,e sens de lauteur : ^ seconde mer « termine
a la cinquième division, cest-à-dire, au cinquième son ou degré de la gamme - la
troisième mer r, termine à la sixième division, c’est-à-dire, au sixième son ou degré
de la gamme; la quatrième mer commence à la quatrième division, c’est-à-dire aü
quatrième son ou degre de la gamme ; ou bien on peut conserver le texte tel
qui est en cet endroit, ainsi que dans la phrase suivante, en l’interprétant dans
le sens que nous lui donnons.
g Or (continue le même auteur, ou plutôt son copiste et son interprète
» Arabe), puisque les divisions signifient absolument la même chose que les m e r
» on ne peut pas dire que la quatrième circulation est formée de cinq m e r
y> mais bien de trots, parce que la première est lantèrne chose que la quatrième’’
» et la seconde, la même chose que la cinquième.
» II n’y a donc aucune différence entre elles;, si ce n’est que l’une n’est point
» au meme degre que 1 autre. »
Suivant ce que dit icil’auteur, les quatrième, cinquième, sixième, septième degrés
qui forment la quatrième m er, | | f f j g l soi de cette circulation, devrofent
etre ordonnes de meme que les premier, deuxième, troisième et quatrième
degres qu, composent la première m er, la, s i, . u t, ré de la même circulation-
e ce principe est conforme à la théorie musicale des G recs, par laquelle ii
etaÎ>1‘ qUe> dans tous les modes « dans tous les genres, les sons devoient
toujours se trouver pareillement ordonnés de quatre notes en quatre notes II
y a donc nécessairement une faute dans la manière dont a été notée en arabe
cette circulation; car les sons ré, mi, «fa, sol, de la quatrième m er, ne sont point
entre eux dans les memes rapports que les sons la , s i, « u i.r ê de la première
MER, puisque la note « fa de la quatrième mer n’est qu’à deux tiers de ton de
la note j g qui la précède, tandis que la troisième note , de la première
■7 wBm? “ *• * » * * • 9 * » »■!«, * i . ■
p ecede. Il ft.d ro i, donc, confonnénien, u , p r â d p « Je fauteur, ou lu ta i-
uer * ut a * ur, ou bien substituer . f a à « fa ; , ce changement étant opéré,
on trouvera, ainsi qud est dit ici, la quatrième mer semblable à la première
et la cinquième semblable à la seconde : il n’y aura en effet, de cette manière,’
que trois m e r différentes dans cette circulation, lesquelles seront la première
la seconde et la troisième ; de meme qu il n’y avoit dans la gamme des Grecs
que trois diatessarons differens ; de meme qu’il n’y auroit que trois sortes de quartes
dans notre gamme moderne, si elle n’étoit pas vicieuse (i).
«Néanmoins, poursuit l’auteur, m e r signifie la même chose que division,
» quoiqu’elle se trouve, par un degré différent, dans une autre m e r . » Ceci est
au moins très-équivoque, et fait pour induire en erreur quiconque n’a pas fait
une étude particulière de la musique , ou n’a que des notions superficielles
de celle des Arabes. C’est à-peu-près comme si l’on nous disoit que les sons
qui composent la quarte sont aussi des quartes, et sont absolument la même
chose. Nous nommons bien, à la vérité, la quatrième note, soit en montant, soit
en descendant, à partir d un degré quelconque, une quarte ; mais c’est parce
que nous la considérons alors, non isolément, mais’dans son rapport avec la
note du point de départ: autrement nous ne pourrions lui donner ce nom, pas
plus que nous ne pourrions le donner aux sons intermédiaires.
Il en est de même des divisions ou des degrés de la gamme Arabe : quoique
quatre de ces divisions consécutives forment une m e r , et que l’on appelle encore
du nom de m e r la première ou la dernière de ces quatre divisions, sons ou
degrés, on ne peut pas dire que ces divisions soient la même chose que les ji
m e r , à moins que l’on n’entende par division chacune des quartes dont se
composent les m e r ; et cela seroit encore équivoque, puisque, suivant la théorie
Arabe, chaque son ou degré d’une gamme s’appelle aussi une division.
Nous voulions éviter de commenter, et cependant nous venons de le faire.
Tout ce que nous citons auroit besoin d’être éclairci, ou, s’il ne l’est pas, reste
obscur. Notre embarras est extrême, et notre travail des plus ingrats. Nous avons
à rendre compte- d’une espèce de musique dont l’art est peut-être le plus compliqué
quon ait jamais connu, dont les principes sont presque entièrement corrompus
, dont les formes systématiques sont absolument différentes de celles
de notre musique, dont enfin les termes techniques n’ont point d’équivalens
dans notre langue, et sont, pour la plupart, employés dans un sens figuré;
nous sentons en même temps que nous ne devons rien avancer sans preuves, et
conséquemment nous nous trouvons dans la nécessité de faire parler souvent" les
auteurs eux-mêmes. Mais, quelque soin que nous apportions dans le choix de nos
citations, il nous est impossible de le faire de telle manière qu’il ne s’y rencontre
encore ou des fautes de copie, ou des expressions étrangères, et des termes dont 1 acception nest point admise dans notre langue. Autant que nous le pouvons,
nous multiplions les exemples, parce qu’ils rendent les choses plus sensibles et
(1) II y a dans notre gamme trois quartes «justes différentes,
et une quarte superflue et dissonante, appelée
triton, parce qu’elle est composée de trois tons. Ainsi l’on
a les quatre suivantes : ut, ré, mi, fa ; ré, mi, fa, sol;
mi, fa, sol, la; fa, sol, la, si; sol, la, si, ut. La première
et la cinquième de ces quartes l’une et l’autre composées sont semblables, d’un ton, d'un ton et un demi-
ton; la seconde quarte est composée d’un ton, d’un detniton
et d’un ton ; la troisième quarte est composée d’un
demi-ton, d’un ton et d’un ton. Toutes ces quartes ne
diffèrent entre elles que parce que le dem i-ton n’occupe
pas la même place dans l’une que dans les autres ;
mais la quatrième quarte, qui est de trois tons, est fausse
seitc adli.ssonante, et décèle le vice de notre système mu