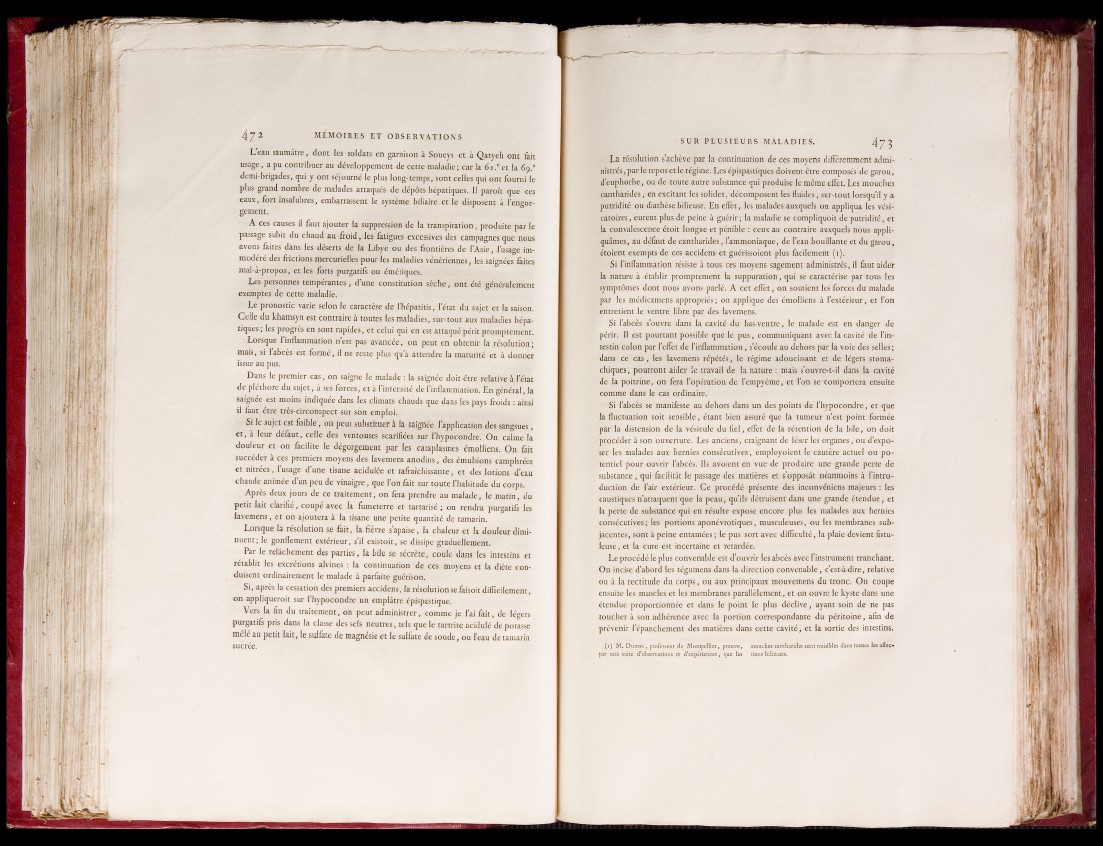
Leau saumâtre, dont les soldats en garnison à Soueys et à Qatyeh ont fait
usage, a pu contribuer au développement de cette maladie ; car la 6 1if et la 69.'
demi-brigades, qui y ont séjourné le plus long-temps, sont celles qui ont fourni le
plus grand nombre de malades attaqués de dépôts hépatiques. Il paroît que ces
eaux, fort insalubres, embarrassent le système biliaire et le disposént à l’engorgement.
A ces causes il faut ajouter la suppression de la transpiration, produite par le
passage subit du chaud au froid, les fatigues excessives des campagnes que nous
avons faites dans les déserts de la Libye ou des frontières de l’Asie, l’usage immodéré
des frictions mercurielles pour les maladies vénériennes, les-saignées faites
mal-à-propos, et les forts purgatifs ou émétiques.
Les personnes temperantes, d une constitution sèche, ont été généralement
exemptes de cette maladie.
Le pronostic varie selon le caractère de l’hépatitis, l’état du sujet et la saison.
Celle du khamsyn est contraire à toutes les maladies, sur-tout aux maladies hépatiques
; les progrès en sont rapides, et celui qui en est attaqué périt promptement.
Lorsque 1 inflammation n’est pas avancée, on peut en obtenir la résolution;
mais, si Iabcès est formé, il ne reste plus qu’à attendre la maturité et à donner
issue au pus.
Dans le premier cas, on saigne le malade ; la saignée doit être relative à l’état
de plethore du sujet, a ses forces, et à i intensité de l’inflammation. En général, la
saignée est moins indiquée dans les climats chauds que dans les pays froids : ainsi
il faut être très-circonspect sur son emploi.
Si le sujet est foible, on peut substituer à la saignée l’application des sangsues,
et, à leur défaut, celle des ventouses scarifiées sur l’hypocondre. On calme la
douleur et on facilite le dégorgement par les cataplasmes émolliens. On fait
succéder a ces premiers moyens des lavemens anodins, des émulsions camphrées
et nitrées, 1 usage d’une tisane acidulée et rafraîchissante, et des lotions d’eau
chaude animée d’un peu de vinaigre, que l’on fait sur toute l’habitude du corps.
Après deux jours de ce traitement, on fera prendre au malade, le matin, du
petit lait clarifié, coupé avec la fùmeterre et tartarisé ; on rendra purgatifs les
lavemens, et on ajoutera à la tisane une petite quantité de tamarin.
Lorsque la résolution se frit, la fièvre s’apaise, la chaleur et la douleur diminuent;
le gonflement extérieur, s’il existoit, se dissipe graduellement.
Par le relâchement des parties, la bile se secrete, coule dans les intestins et
rétablit les excrétions alvines : la continuation de ces moyens et la diète conduisent
ordinairement le malade à parfaite guérison.
Si, après la cessation des premiers accidens, la résolution se fàisoit difficilement,
on appliqueroit sur l’hypocondre un emplâtre épispastique.
Vers la fin du traitement, on peut administrer, comme je l’ai fait, de légers
purgatifs pris dans la classe des sels neutres, tels que le tartrite acidulé de potasse
mêlé au petit lait, le sulfate de magnésie et le sulfate de soude, ou l’eau de tamarin
sucrée.
La résolution s’achève par la continuation de ces moyens différemment administrés
, par le repos et le régime. Les épispastiques doivent être composés de garou,
d’euphorbe, ou de toute autre substance qui produise le même effet. Les mouches
cantharides, en excitant les solides, décomposent les fluides, sur-tout lorsqu’il y a
putridité ou diathèse bilieuse. En effet, les malades auxquels on appliqua les vési-
catoires, eurent plus de peine à guérir; la maladie se compliquoit de putridité, et
la convalescence étoit longue et pénible : ceux au contraire auxquels nous appliquâmes,
au définit de cantharides, l’ammoniaque, de l’eau bouillante et du garou,
étoient exempts de ces accidens et guérissoient plus facilement (1).
Si l’inflammation résiste à tous ces moyens sagement administrés, il faut aider
la nature à établir promptement la suppuration, qui se caractérise par tous les
symptômes dont nous avons parlé. A cet effet, on soutient les forces du malade
par les médicamens appropriés; on applique des émolliens à l’extérieur, et l’on
entretient le ventre libre par des lavemens.
Si l’abcès s’ouvre dans la cavité du bas-ventre, le malade est en danger de
périr. 11 est pourtant possible que le pus, communiquant avec la cavité de l’intestin
colon par l’effet de l’inflammation, s’écoule au dehors par la voie des selles;
dans ce cas, les lavemens répétés, le régime adoucissant et de légers stomachiques
, pourront aider le travail de la nature : mais s’ouvre-t-il dans la cavité
de la poitrine, on fera l’opération de l’empyème, et l’on se tomportera ensuite
comme dans le cas ordinaire.
Si l’abcès se manifeste au dehors dans un des points de l’hypocondre, et que
la fluctuation soit sensible, étant bien assuré que la tumeur n’est point formée
par la distension de la vésicule du fiel, effet de la rétention de la bile, on doit
procéder à son ouverture. Les anciens, craignant de léser les organes, ou d’exposer
les malades aux hernies consécutives, employoient le cautère actuel ou potentiel
pour ouvrir l’abcès. Ils avoient en vue de produire une grande perte de
substance, qui facilitât le passage des matières et s’opposât néanmoins à l’introduction
de l’air extérieur. Ce procédé présente des inconvéniens majeurs : les
caustiques n’attaquent que la peau, qu’ils détruisent dans une grande étendue, et
la perte de substance qui en résulte expose encore plus les malades aux hernies
consécutives; les portions aponévrotiques, musculeuses, ou les membranes sub-
jacentes, sont à peine entamées ; le pus sort avec difficulté, la plaie devient fistu-
leuse, et la cure est incertaine et retardée.
Le procédé le plus convenable est d’ouvrir les abcès avec l’instrument tranchant.
On incise d’abord les tégumens dans la direction convenable, c’est-à-dire, relative
ou à la rectitude du corps, ou aux principaux mouvemens du tronc. On coupe
ensuite les muscles et les membranes parallèlement , et on ouvre le kyste dans une
étendue proportionnée et dans le point le plus déclive, ayant soin de ne pas
toucher à son adhérence avec la portion correspondante du péritoine, afin de
prévenir l’épanchement des matières dans cette cavité, et la sortie des intestins.
(1) M . D um as, professeur de M ontpellier, prouve, mouches cantharides sont nuisibles dans toutes Iesaffeo
par une suite d’observations et d’expériences, que les tions bilieuses.